
Auteur : Masliaev Alexandre , publié : 04/2017, https://habr.com/ru/post/403225/
Le printemps est une saison intéressante, et il faut la célébrer comme il se doit. Un profond et lourd débat en plusieurs épisodes sur la nature de l’information est, à mon avis, une excellente façon de fêter le printemps sur GeekTimes.
Je m’excuse d’avance pour la quantité de texte. Le sujet est extrêmement complexe, multiforme et remarquablement négligé. J’aimerais pouvoir tout condenser en un court article, mais cela donnerait inévitablement un travail bâclé avec des lacunes logiques béantes, des questions floues et des intrigues inachevées. Je propose donc au public respecté de faire preuve d’un peu de patience, de s’installer confortablement et de profiter d’une immersion calme et réfléchie dans des questions qui ont toujours été considérées comme « personne ne le sait ».
Table of Contents
Introduction
En ce moment, alors que ce texte est écrit, une situation plutôt amusante s’est créée. La société est rapidement entrée dans l’ère de l’information, mais la base idéologique utilisée pour comprendre ce qui se passe est restée, au mieux, héritée des débuts de l’ère industrielle. Il n’existe actuellement aucun moyen communément accepté d’intégrer le concept d’« information » dans notre vision du monde de manière à ce que le résultat obtenu ne contredise pas les phénomènes que nous observons de manière évidente et omniprésente.
Nous avons plutôt bien appris à extraire des informations, à les stocker, à les transmettre, à les traiter et à les utiliser. Pour être juste, il faut noter que nous savons tous très bien ce qu’est l’information. Mais cette connaissance est implicite. La connaissance implicite est une compréhension évidente, qui convient bien à une consommation interne, mais qui est insatisfaisante pour une utilisation collective productive.
Les tâches de la philosophie de l’information :
- Trouver et éliminer les obstacles qui empêchent la conversion de l’« information » de la connaissance implicite à la connaissance explicite.
- Former un système métaphysique dans lequel pourraient s’intégrer de manière organique et cohérente les processus informationnels qui font déjà partie de notre quotidien.
Dans la suite de mon exposé, je partirai du principe que la philosophie est avant tout un outil qui façonne les appareils conceptuels et les règles de leur utilisation. Cela diffère un peu de ce que l’on entend généralement par le mot « philosophie ». On considère que la philosophie doit apporter des réponses aux questions sur l’existence des choses et clarifier certaines lois les plus générales de l’organisation du monde. Pourtant, il arrive que, avant de commencer à réfléchir sur l’organisation du monde, il ne soit pas superflu de développer un langage apte à rendre ces réflexions non pas d’emblée dépourvues de sens.
C’est précisément la tâche de former un langage, et non la recherche de vérités, qui constituerala base de la méthode, que je m’efforcerai de suivre dans la suite du récit. Afin de démontrer clairement cette méthode, je donnerai plusieurs exemples, y compris dans des domaines connexes de la philosophie :
- Existe-t-il un Dieu ?
La question n’est pas méthodiquement correcte (selon la base appliquée de la méthode). La formulation correcte est :De quelle manière faut-il réfléchir à Dieu pour que ces réflexions aient un sens ? - Existe-t-il des lois objectives qui régissent le monde ?
Formulation correcte :Comment parler de l’existence des lois de l’univers de manière à ce que cela ne soit pas une perte de temps ? - Qu’est-ce qui est primordial : la matière ou la conscience ?
Formulation correcte :Comment parler de la primauté, de la matière et de la conscience de manière à ce que ce qui est dit ne soit pas un divertissement absurde ? - Qu’est-ce que l’information ?
Formulation correcte :Comment faut-il réfléchir à l’information pour que ces réflexions aient du sens ?
Partons du principe que la philosophie de l’information doit devenir cet outil linguistique adéquat répondant à nos besoins, qui nous permettra de ne pas nous retrouver dans une impasse logique chaque fois que l’on aborde la nature de l’information, de la conscience, de la gestion, de la formation des systèmes, de la complexité et d’autres sujets actuellement entourés de nombreux mythes.
Pour illustrer de manière concrète la puissance de l’approche instrumentale, il est pertinent de faire la suivante illustration historique. Il y a longtemps, la question de savoir si la Terre tourne autour du Soleil ou si le Soleil tourne autour de la Terre était un dilemme très débattu. Cela allait même jusqu’à ce que des violences physiques soient couramment exercées sur les opposants idéologiques. Aujourd’hui, ayant appris à réfléchir sur le mouvement et compris que le point clé de ces réflexions est le choix de la position de l’observateur, nous avons la possibilité, dans nos réflexions sur l’organisation de notre système planétaire, d’utiliser à notre convenance le système héliocentrique, et dans nos affaires quotidiennes – le système géocentrique. Lorsque nous disons que le Soleil se lève à l’est et se couche à l’ouest, nous sous-entendons implicitement que le Soleil se déplace, bien que, du point de vue du système héliocentrique, cela soit faux. La différence entre ce qui était et ce qui est devenu réside uniquement dans le fait que nous avons acquis un appareil conceptuel qui nous permet de réfléchir de manière plus adéquate sur le mouvement. La capacité de traduire les réflexions dans un cadre constructif, et ainsi de concilier des positions opposées, n’est pas la seule fonction utile de l’approche instrumentale. Une autre fonction tout aussi utile est la fermeture forcée de ces problèmes pour lesquels il s’avère qu’il n’existe pas de moyens de réflexion non dénués de sens.
L’approche instrumentale à la philosophie a bien sûr ses limites. En particulier, la question de savoir comment distinguer les raisonnements productifs des raisonnements contre-productifs doit rester ouverte et sujette à discussion. On peut certes insister sur la cohérence logique ou sur l’utilité pratique. Mais ces deux critères sont assez flous. Il me semble qu’on ne peut que espérer que la discussion sur l’utilité des choses est généralement beaucoup plus simple et productive que celle sur l’existence de ce dont l’existence ne peut être ni confirmée ni réfutée. Après tout, l’utilité est justement ce qui permet le mieux d’organiser un vote par les pieds.
Je ne veux en aucun cas dire que l’approche instrumentale est mon invention. Elle est décrite dans un grand nombre de textes philosophiques et est utilisée de manière productive dans encore plus de cas. Cette chose, qui est en somme évidente, a dû être mise en avant dans l’introduction simplement parce que si l’on n’y accorde pas d’attention au préalable, beaucoup de ce qui sera exposé par la suite semblera quelque peu étrange et parfois contradictoire. La spécificité de la tâche est telle que, pour la résoudre, il est impossible de rester dans les limites des vérités élémentaires et des constructions logiques habituelles. Je le répète : nous ne chercherons pas des Vérités-avec-une-grande-majuscule éternelles et immuables, mais nous essaierons simplement de trouver un langage dont les raisonnements sur l’information, les systèmes et la gestion ne nous plongeront pas à chaque instant dans une impasse logique.
Brève histoire de la question
Cette section n’a pas pour but de présenter de manière systématique l’histoire de la pensée philosophique mondiale. L’objectif est simplement d’inscrire les réflexions qui suivent dans un contexte existant, sans lequel elles ne peuvent être comprises ni acceptées.
Intrigue première : matérialisme vs. idéalisme
Les matérialistes considéraient et considèrent que seule la réalité physique existe « véritablement » (selon l’expression de Démocrite, « atomes et vide »). Par conséquent, ce que nous avons la possibilité d’observer comme des idées n’est en réalité qu’un mouvement qui se produit d’une manière mystérieuse, pour ainsi dire, des atomes dans le vide. Ce en quoi peut consister cette particularité de la « manière spéciale » n’est généralement pas précisé, et lorsqu’on tente tout de même d’éclaircir cette question, on cite maladroitement, au mieux, un manuel scolaire de physique.
Les idéalistes ont toujours pensé et pensent que seules les idées existent « réellement », tandis que ce que nous percevons comme la réalité physique brute qui nous entoure n’est qu’une illusion ou le résultat de la magie.
Les arguments en faveur et en défaveur de ces points de vue sont nombreux, variés et tous extrêmement faibles, même si au 20ème siècle, les matérialistes ont expérimenté des millions de fois que si une personne est enfermée et affamée, elle cesse de penser à des idées et commence à penser à la nourriture.
Il existe une opinion (notamment exprimée par Merab Mamardashvili dans « Introduction à la philosophie ») selon laquelle les véritables philosophes n’ont jamais sérieusement considéré la question de savoir ce qui est primordial, la conscience ou la matière. Si l’on aborde ce que l’on appelle le « problème fondamental de la philosophie » d’un point de vue instrumental, comme je l’ai décrit dans l’introduction, une chose intéressante se révèle immédiatement. Pour que soit discutée l’existence de la matière sans impliquer la présence de la conscience, même sous la forme d’un observateur implicite, ou pour que l’on puisse raisonner sur le fonctionnement de la conscience sans sa réalisation matérielle, il faudrait pouvoir se retrouver dans une situation d’absence de conscience ou dans une situation d’absence de matière. Or, ni l’un ni l’autre n’est possible, et par conséquent, aucune réflexion sur la causalité première ne peut avoir de sens. Ainsi, la question appliquée à la causalité première…«Comment faut-il raisonner sur… ?»reçoit une réponse«Aucun»..
Pour nos objectifs, le résultat le plus précieux et utile du débat entre matérialistes et idéalistes peut sans doute être reconnu dans la formulation même de la question de l’existence des entités matérielles et immatérielles. En particulier, la distinction entre les choses étendues (res extensa) et les choses pensantes (res cogitans), introduite par René Descartes, s’est révélée très utile et productive. Tant que l’humanité, dans ses activités pratiques, était concentrée sur l’étude et la création des choses étendues d’un côté, et sur la manipulation des choses pensantes de l’autre, la séparation du monde ne posait pas de problèmes particuliers et n’était qu’un cas théorique qu’il faudrait un jour résoudre. Avec l’avènement de l’ère des technologies de l’information, nous avons appris à créer des choses matérielles (res extensa) entièrement destinées à manipuler des entités immatérielles (res cogitans), et par conséquent, la fusion qualitative de ces mondes séparés est devenue une tâche sans laquelle la philosophie de l’information ne pourra pas se passer.
Intrigue deux : la recherche des fondements d’une connaissance fiable.
La recherche de fondements pour une connaissance fiable traverse toute la philosophie européenne comme un fil rouge. Du point de vue de l’utilité pratique, ce thème s’est avéré le plus fructueux, fournissant la base de la méthode scientifique et, par conséquent, engendrant toute cette merveille technologique dont nous avons la possibilité de profiter.
L’idée centrale qui sous-tend l’argumentation est celle de la réalité objective, perçue par un sujet percevant. Chaque fois qu’il est question de l’existence de quelque chose dans la réalité objective, il est nécessaire, pour respecter la rigueur méthodologique, de définir le sujet qui perçoit cette réalité.
Le thème du « sujet percevant » a été largement exploré par la tradition philosophique existante et pourrait servir de bon point de départ pour la philosophie de l’information, s’il n’y avait pas deux points essentiels :
- Le sujet percevant est un être passif. Il perçoit la réalité objective, acquiert une connaissance fiable.information) d’elle, mais dans les réflexions sur ce que représente l’information, la notion de sujet percevant ne peut pas être un point de départ, car elle inclut déjà la notion d’information. En réalité, « information » s’avère être un concept par lequel nous avons sauté pour aller plus loin. Il va donc falloir creuser un peu plus profondément, et construire la subjectologie non pas à partir du sujet percevant, mais à partir de quelque chose d’autre. En particulier, nous allons bientôt introduiresujet agissant de manière ciblée, qui ne se contente pas de « refléter » la réalité objective, mais qui vit à l’intérieur, et l’information n’est pas nécessaire pour rien (pour « refléter »), mais pour une raison quelconque.objectif.En mettant de côté le thème des « objectifs du sujet » et en considérant la présence d’objectifs comme quelque chose d’évident et non discuté, il est impossible de parler du sens de l’information. Et une information dépourvue de sens n’est pas de l’information.
- Le sujet percevant est une créature infiniment seule. Tout le monde qui entoure le sujet percevant est pour lui une réalité objective. Même les objets avec lesquels le sujet percevant devine son affinité essentielle ne sont pour lui ni des sujets, ni des objets, mais des objets dont il s’efforce d’obtenir une connaissance fiable. Du point de vue de la philosophie de l’information, un tel tableau du monde, à la fois cohérent et triste, s’avère complètement inacceptable, car il ne suppose pas la communication entre les sujets. Pour qu’il y ait communication, il faut au moins deux sujets, alors que dans cette vision du monde, divisée en deux parties – le sujet percevant et la réalité perçue – le sujet est, par définition, seul. Nous serons simplement contraints de nous éloigner de l’ancienne et réconfortante conception du sujet percevant pensant (et donc existant). Essayons de ne pas nous perdre.
Ayant perdu la méthode habituelle de déduction des fondements d’une connaissance fiable à partir du concept de « sujet percevant », nous serons contraints de trouver un substitut adéquat. Dans le cas contraire, le système métaphysique résultant sera dépourvu de justification et, par conséquent, ne sera pas exploitable.
Intrigue trois : déterminisme vs. libre arbitre
Il se trouve qu’en ce qui concerne la base philosophique de la connaissance scientifique (épistémologie), la réalité objective est organisée de telle manière qu’il n’y a pas de place pour la libre volonté. Au maximum, il y a le hasard (en particulier, l’incertitude quantique), à partir duquel la libre volonté ne peut de toute façon pas être déduite. Mais, d’un autre côté, pour la philosophie morale (axiologie), le fait de l’existence de la libre volonté est une condition nécessaire. En outre, l’existence de la liberté de volonté peut être assez facilement déduite directement de « je pense, donc je suis », ce qui ajoute une certaine piquant, puisque la base de la connaissance scientifique n’est pas non plus déduite de nulle part, mais du même fait primordial, de « je pense, donc je suis ».
En résumé, nous allons tenter de nous sortir de cette véritable antinomie en nous débarrassant de la passivité du sujet percevant. En agissant dans le monde, le sujet deviendra inévitablement une partie de celui-ci, ce qui nous permettra d’avoir du déterminisme dans les aspects sur lesquels le sujet n’a pas d’influence, tout en conservant la liberté de volonté dans la nature et les résultats de son activité.
Le problème du « déterminisme vs. libre arbitre » est une bonne occasion de parler de la nature de la causalité, car le déterminisme est une prédisposition, dictée par la rigueur des liens de cause à effet.
En réfléchissant à un sujet agissant de manière intentionnelle, il est impossible (et même inutile) d’ignorer la discussion sur la manière dont il se fait que des relations de cause à effet existent dans notre monde.
Intrigue quatre : la machine de Turing
Dans la seconde moitié du 20e siècle, les philosophes ont eu à leur disposition un jouet fascinant : la machine de Turing, capable d’effectuer tout calcul réalisable. Étant donné que l’activité du cerveau est considérée comme un traitement de l’information, c’est-à-dire un calcul, il en résulte que soit un calculateur Turing-complet peut être enseigné à penser de manière totalement humaine, soit il faut admettre qu’il existe un composant secret inexploré dans la pensée, et alors… les réflexions mènent inévitablement à la mystique. Soit à la mystique traditionnelle (Dieu), soit à la mystique non traditionnelle (champs d’information), soit à la pseudoscience (tentative de s’accrocher à l’incertitude quantique).
La mystique est une tentative d’expliquer l’incompréhensible par ce qui est manifestement inconnaissable. C’est de la pure tromperie. Nous ne ferons pas cela. Mais nous prouverons également que l’irréalisabilité de la pensée humaine par un calculateur Turing-complet est une réalité. Pour cela, il nous suffira d’apprendre à raisonner de manière un peu plus adéquate sur l’information et son traitement.
Chapitre 1. Dualisme
Métaphore « livre »
L’examen d’un livre, d’un livre en papier ordinaire, cet objet encore très répandu dans notre quotidien, nous aidera à ressentir comment le matériel et l’idéal s’entrelacent en un tout.
D’un certain point de vue, un livre est un objet matériel. Il a une masse, un volume, occupe un certain espace (par exemple, sur une étagère). Il possède des propriétés chimiques. En particulier, il brûle assez bien.
D’un autre point de vue, un livre est un objet immatériel. C’est de l’information. En parlant d’un livre, on peut évoquer l’intrigue et les relations entre les personnages (s’il s’agit de fiction), la véracité des faits exposés (s’il raconte des événements réels), la profondeur du traitement du sujet et d’autres aspects qui n’ont certainement ni masse ni propriétés chimiques.
Prenons par exemple la tragédie de William Shakespeare « Hamlet ». Imaginez que vous tenez ce livre dans votre main. Évidemment, vous tenez un objet matériel. L’intrigue de « Hamlet » ne peut pas être saisie physiquement. Le livre n’est pas très épais, sa masse n’est pas très grande. Les pages ont une odeur agréable. On pourrait faire une analyse chimique et découvrir que cet objet est principalement composé de cellulose avec des traces d’encre, de colle et d’autres substances. Dans un état solide. Sur le plan matériel, il ne diffère guère d’un roman de gare qui se trouve à côté sur l’étagère. Mais il est évident qu’il y a en cet objet quelque chose au-delà des atomes. Essayons de le trouver. Prenons un microscope et regardons. Nous verrons un entrelacement de fibres de bois collées et leur adhérence à des morceaux de peinture. Prenons un microscope plus puissant, et nous verrons beaucoup de choses intéressantes. Mais tout cela n’aura aucun rapport avec « être ou ne pas être », ni avec l’idée de vengeance pour trahison et meurtre. Peu importe combien nous explorons la composante matérielle du livre, nous ne trouverons pas la composante informationnelle. Juste des atomes et du vide. Pourtant, il est tout à fait juste de dire que dans « Hamlet », il y a à la fois une intrigue, des personnages et le célèbre « être ou ne pas être ». Et pour découvrir cela, il n’est pas nécessaire de prendre un microscope. Il suffit d’ouvrir le livre et de commencer à lire. Ce qui est intéressant, c’est que, d’un point de vue informationnel, la couche matérielle s’efface au point que peu importe si le livre est fait de papier ou, disons, de parchemin. Après tout, on peut lire « Hamlet » sur l’écran d’un e-reader, et là, il n’y a certainement aucune fibre de bois avec des morceaux de peinture collés dessus.
Ainsi, nous avons deux manières d’aborder le livre « Hamlet » : une approche matérialiste, où l’on voit tout sauf l’idée, et une approche idéaliste, où les entrelacs des fibres ne comptent pas, mais où les entrelacs de l’intrigue sont essentiels. Et pourtant, l’objet reste le même. La différence réside uniquement dans notre propre approche. C’est-à-dire dans ce que nous comptons en faire – peser ou lire. Si nous comptons peser, alors nous avons devant nous un objet totalement matériel, et si nous comptons lire, alors nous avons devant nous une essence totalement immatérielle.
Une question légitime se pose : peut-on trouver un moyen de regarder ce sujet de manière à voir simultanément ses deux aspects ? Oui, c’est possible et nécessaire, mais je ne peux pas dire que ce soit simple. C’est très compliqué. Cela demande des efforts considérables et l’utilisation d’un véritable arsenal d’outils et de techniques, dont je vais essayer de parler plus loin. C’est d’autant plus important que les méthodes de fusion de l’objectif et du subjectif en un tout constituent la base métaphysique de la philosophie de l’information. Mais avant de s’atteler à la fusion des aspects de la réalité, il sera utile de prendre conscience de la profondeur du problème.
La totalité de la réalité physique
Le concept de « matériel » peut être défini de différentes manières. Par exemple :
- Tout ce qui existe objectivement. C’est précisément cette interprétation qui est utilisée, directement ou indirectement, par les classiques du matérialisme. Par exemple, Lénine écrivait que l’existence objective est une fonction de la matière. Pour la philosophie de l’information, une telle approche n’est pas valable, principalement parce qu’elle matérialise immédiatement les entités informationnelles ou les prive de leur droit à l’existence objective. Dans le premier cas, nous tombons dans le piège de la réification (nous parlerons de son inadmissibilité plus bas), et dans le second cas, nous nous retrouvons dans une impasse face à des phénomènes simples et facilement observables. Par exemple, essayez d’ajouter une fin heureuse à « Hamlet » de manière à ce qu’il ne cesse pas d’être « Hamlet ». Ou, comme alternative, changez le millième chiffre du nombre « pi ». Dans les deux cas, ce sont des entités idéales, mais quelque chose de irrésistiblement puissant les maintient dans la réalité objective.
- Tout ce qui diffère du psychique et du spirituel. Une telle définition n’est pas valable, car nous ne savons pas encore ce que sont le psychique et le spirituel. C’est-à-dire l’information. À ce stade du récit, nous ne savons pas encore raisonner sur l’information, et par conséquent, nous ne pouvons pas prendre de décisions sur ce qui constitue une entité informationnelle et ce qui ne l’est pas.
- Tout ce qui existe dans l’espace physique. C’est-à-dire ce que Descartes a défini comme « res extensa ». Les corps sont étendus. Si l’on examine de près ce que la physique étudie, on peut facilement comprendre que toutes les entités qu’elle décrit sont, d’une manière ou d’une autre, liées à cet espace physique tridimensionnel qui nous est si familier. En parlant de masse, il est impossible de s’abstraire de son emplacement. En parlant de champ, il est impossible d’échapper à la discussion sur la répartition de ses caractéristiques dans l’espace. En parlant d’énergie, il est impossible de ne pas mentionner ce dont cette énergie dispose concrètement – un objet matériel (quelque chose de localisé dans l’espace, ne serait-ce qu’en tant que fonction d’onde) ou un champ, qui ne peut également être pensé en dehors de l’espace. Il y a une certaine tentation de se lier non seulement à l’espace, mais aussi au temps, mais nous ne le ferons pas, ne serait-ce que parce qu’il existe en physique une belle branche, la statique, qui se passe merveilleusement bien du concept de « temps ».
Ainsi, la localisation dans l’espace physique comme moyen d’identification univoque de la matérialité d’un objet.
L’espace physique est une chose omniprésente. Tout ce avec quoi nous interagissons autour de nous s’y trouve. Tout simplement parce qu’il est, par définition, autour de nous. L’espace est infini dans toutes les directions et n’a pas de ruptures sur lesquelles nous pourrions tomber.
Où que vous alliez, où que vous regardiez, à quoi que vous touchiez – tout cela se trouve dans un espace physique infini, tant en largeur qu’en profondeur. Même si des choses comme la téléportation ou, disons, les voyages entre les mondes devenaient une réalité, cela ne changerait rien. Une brique téléportée doit toujours occuper une place dans l’espace pour exister après être arrivée « de nulle part ». Quelle que soit l’histoire que nous inventons, peu importe à quel point nous faisons galoper notre imagination, dans tous les cas, si cette histoire concerne des objets matériels, notre espace physique omniprésent y est toujours présent.
Même lorsque l’on parle de la courbure de l’espace ou du fait qu’il a en réalité plus de dimensions que trois, cela ne change rien. On précise simplement les propriétés de cette « grille » dans laquelle nous devons localiser l’existence des objets. Ce fait amusant issu de la théorie de la relativité, selon lequel le « pas de la grille » dépend de la vitesse de l’observateur, n’est qu’une correction dans la méthode d’utilisation de cette « grille », sans remettre en question sa nécessité dans aucun cas particulier.
Ainsi, il ne nous reste plus qu’à reconnaître que la réalité matérielle est totale, et qu’il n’existe aucun moyen d’en échapper. Il n’y a pas de failles, et ce n’est pas parce que nous ne les avons pas encore trouvées, mais parce que tout effet nouvellement découvert, aussi fantastique et incroyable soit-il au départ, fait inévitablement partie de cette même réalité. Les miracles n’existent pas, non pas parce que nous sommes des matérialistes bornés et obtus, mais parce que le terme « miracle » est un concept qui se contredit lui-même.
La totalité de la réalité informationnelle
Une réflexion sur la totalité de la réalité matérielle ne serait pas complète si elle n’était pas complétée par une réflexion tout aussi valable sur le fait que nous ne vivons pas dans une réalité matérielle, mais dans une réalité informationnelle, dont nous ne pouvons pas nous échapper d’un pas, ni d’un demi-pas.
Le monde est composé de choses que nous connaissons et de choses que nous ne connaissons pas. Nous ne pouvons opérer qu’avec les choses dont nous avons au moins une certaine idée. Ce dont nous ne savons absolument rien se trouve entièrement en dehors de notre monde. En apprenant quelque chose, nous acquérons des éléments à l’intérieur de notre monde. Nous élargissons les frontières de notre monde. Quoi que nous considérions comme un sujet connaissant, le simple fait qu’il s’engage dans la connaissance (l’élargissement des frontières du connu) implique que le monde de ce sujet est limité. Concernant les choses qui se trouvent à l’intérieur du monde du sujet, celui-ci peut penser (s’il est, bien sûr, pensant). En revanche, il ne peut penser aux choses qui se trouvent au-delà des limites de son monde. Il n’a tout simplement aucune idée à leur sujet. Ce qui est intéressant, c’est que la frontière même de ce qui est pensable est également impensable. Comme l’a justement noté Ludwig Wittgenstein dans son « Tractatus logico-philosophicus », pour penser la frontière, il faut penser aux choses des deux côtés de celle-ci, alors que les choses de l’autre côté de la frontière du pensable sont, par définition, impensables. Ainsi, tout ce dont nous pouvons penser est déjà devenu de l’information.
Supposons qu’il s’agisse d’une brique. Elle existe. Mais elle n’existe pour nous que si les circonstances ont fait qu’elle a réussi à devenir une information pour nous. Par exemple, nous l’avons vue. Ou nous avons trébuché dessus dans l’obscurité. Ou quelqu’un nous en a parlé. En fin de compte, nous connaissons le concept de « brique », et c’est pourquoi toutes les briques sont présentes dans notre monde, y compris celles avec lesquelles nous ne nous familiariserons jamais personnellement de notre vivant.
On ne peut dire que ceci sur ce qui se trouve au-delà de notre monde :
- Il existe sans aucun doute. Dans toute réflexion sur l’existence, la question clé est « où ? », et dans ce cas, la réponse à cette question est étonnamment simple et exhaustive : au-delà de ce qui est pensable.
- Il est inépuisable. C’est-à-dire que tant qu’il existe un sujet connaissant, le fait de son fonctionnement témoigne sans équivoque que ce qui se trouve au-delà de sa pensée n’a pas encore été épuisé.
- Il n’a aucune propriété en dehors du fait d’exister et du fait d’être inépuisable. Toute propriété ne peut être attribuée qu’à ce qui est pensable (l’attribution de propriétés est une forme de pensée). Tenter d’attribuer une quelconque propriété à ce qui est impensable introduit immédiatement une contradiction interne dans le raisonnement. En réalité, même les propriétés d’existence et d’inépuisabilité ne sont pas dérivées d’une connaissance de ce qui, par définition, est inconnaissable, mais des propriétés du sujet.
Je l’appelle un concept.scaphandre d’informationTout ce que nous avons est déjà devenu pour nous une information obtenue des parois internes de notre scaphandre informationnel. Toute notre pensée (et seulement la pensée, rien d’autre) qui formule des hypothèses sur le monde extérieur se trouve à l’intérieur du scaphandre, et le seul moyen par lequel nous pouvons agir sur la réalité extérieure, indéniablement existante et inépuisable, est de fournir des efforts (naturellement, des efforts informationnels) sur les parois internes de notre scaphandre.
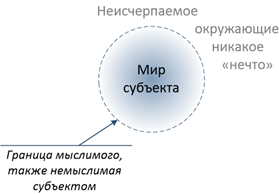
L’image est un peu effrayante. Cela pourrait même provoquer une crise de claustrophobie. En réalité, il n’y a rien de terrifiant dans ce concept, si l’on se rappelle à temps que tout ce que nous savons, apprécions, aimons, à quoi nous aspirons, et même tout ce que nous détestons se trouve à l’intérieur de notre scaphandre informationnel. Le monde tel que nous le connaissons.
Ainsi, la réalité informationnelle est également totale, et nous ne savons rien de ce qui n’est pas information. Ne serait-ce que parce que toute connaissance est une information que nous possédons. Naturellement, à l’intérieur de la combinaison informationnelle.
Il convient de noter tout de suite que les réflexions sur la limitation de l’amené peuvent sembler, à première vue, un ensemble de banalités dépourvu de sens. Elles n’ont vraiment pas de sens que si l’on considère l’être pensant et existant comme un cas unique. En revanche, si l’on a au moins deux êtres, les domaines de l’amené deviennent plus d’un, et il s’avère que :
- Dans le domaine de l’intersection des mondes, les êtres se comprennent, et c’est dans ce domaine (et seulement dans ce domaine) que la communication entre eux est possible.
- On peut supposer qu’il est théoriquement possible que les mondes de deux êtres différents coïncident complètement, mais il est probablement réaliste de s’attendre à découvrir un tel phénomène uniquement pour des êtres créés artificiellement.
- Du point de vue de tout être, le monde de tout autre être apparaît comme un sous-ensemble de son propre monde. Un être n’est pas capable de cerner la frontière de son propre monde, mais la limitation du monde d’un autre être lui est facilement perceptible. Par exemple, pour les humains et les chiens, des concepts tels que « nourriture », « douleur », « joie », « intéressant », « jeu » et un grand nombre d’autres sont communs, mais il est évident pour nous que la situation « je ne peux pas me souvenir du mot de passe de mon e-mail » se situe entièrement en dehors du monde du chien. L’illusion de l’infinité de son propre monde, combinée à l’évidence de la limitation des autres êtres, constitue un terreau fertile pour toutes les théories de supériorité, sans exception.
- Aucune créature ne peut rien savoir de la partie du monde d’un autre être qui se trouve en dehors de son propre monde. On ne peut que supposer que cette partie existe. Ou n’existe pas. Rien n’est certain. On ne peut rien affirmer sur ce qui se trouve au-delà de ce qui est pensable.
- Toute activité d’un être, justifiée par des considérations qui dépassent le cadre du monde d’un autre être, apparaît à cet autre être comme une activité inconsciente. Par exemple, en observant les relations étranges entre les chiens dans un parc canin, nous avons tendance à considérer ce qui se passe comme une manifestation d’instincts. Mais si l’on y réfléchit bien, même notre propre activité (y compris la plus consciente) peut être attribuée à des manifestations d’instincts. Le concept d’« instinct » est l’un de ces « béquilles » mentales par lesquelles nous essayons de donner un aspect scientifique à des raisonnements sur ce que nous ne comprenons pas.
- Les êtres qui n’ont pas d’intersection entre leurs mondes apparaissent les uns aux autres comme des phénomènes inanimés de la nature. Cela ne signifie bien sûr en aucun cas que tout ce que nous considérons comme inanimé est animé. Le « si » dans l’autre sens ne fonctionne pas.

L’image de l’interaction des mondes que nous voyons ici, nous, les humains, ne pouvons pas l’observer, car une partie essentielle se trouve en dehors de notre monde humain. Les chiens ne peuvent pas non plus l’observer pour la même raison. Peut-être qu’un chat pourrait observer une image similaire, mais en tenant compte, bien sûr, du fait qu’il n’observe pas entièrement ni le monde humain ni le monde canin. Si vous avez pensé que j’avais tort de représenter le monde du chien par un cercle de la même taille que celui du monde humain, cela signifie simplement que vous n’avez pas encore pleinement compris qu’il est impossible d’affirmer quoi que ce soit sur des choses qui se trouvent en dehors des limites de ce qui est pensable.
Les réflexions sur les créatures et les mondes dans lesquels elles vivent sont utiles non seulement en elles-mêmes (elles en découlent des conclusions très précieuses), mais aussi comme moyen de pratiquer l’application du concept de scaphandre informationnel. Ce même concept qui implique que la réalité informationnelle est totale, et que nous ne pouvons pas en sortir.
La totalité de l’indivisibilité des réalités
Ainsi, nous avons obtenu deux réalités totales : la réalité physique et la réalité informationnelle. On pourrait penser que deux, c’est trop. On aimerait les réduire à une seule. Par exemple, se rallier aux matérialistes et tenter de prouver que tout se réduit à la matière. Ou aux idéalistes, pour tout ramener à la conscience.
Regardez l’image :
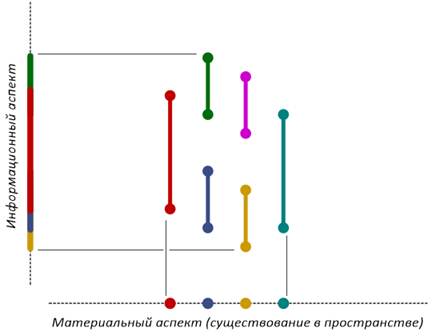
Comme pour toute schématisation, l’image présentée ne doit pas être interprétée trop littéralement. C’est simplement une visualisation pour faciliter la compréhension. Supposons que l’objet représenté sur l’image soit le livre « Hamlet » dans toute sa plénitude et son unité indissoluble. Mais imaginez que nous avons oublié comment voir cette chose telle que nous la voyons maintenant, et que nous ne pouvons étudier que des projections. Si nous étudions l’aspect matériel (c’est-à-dire la projection sur l’axe horizontal), nous voyons des atomes. Et lorsque nous passons à l’axe vertical, nous voyons une autre projection – les entrelacs de l’intrigue, mais dans ce cas, l’aspect matériel échappe à notre considération. Il devient perpendiculaire à nous. Bien sûr, cela peut nous donner l’illusion que le monde est divisé entre le monde des choses, que nous acquérons sur l’axe horizontal, et le monde des idées, que nous acquérons sur l’axe vertical. Mais ce n’est, bien sûr, qu’une illusion. Le monde est un. Les différences ne surgissent que parce que nous ne sommes pas capables de saisir l’objet dans toute sa plénitude.
En principe, on pourrait se passer de l’image. La totale indivisibilité des réalités découle automatiquement du fait que les deux réalités considérées :
a) total
b) différents
En réalité, il existe un certain nombre d’objets dont la composante informationnelle ne nous intéresse pas, et c’est pourquoi, en réfléchissant à leur sujet, nous ne prenons en compte que l’aspect matériel. Par exemple, quand j’ai soif, je m’intéresse à l’aspect matériel de l’eau que je m’apprête à boire. Et quand je dois calculer la longueur de l’hypoténuse à partir des deux côtés, je ne cherche même pas à retrouver ce fameux manuel de géométrie dans lequel j’ai étudié le théorème de Pythagore. Il n’est pas toujours nécessaire d’essayer de voir chaque objet dans toute sa complexité. C’est trop coûteux. Il faut être prêt à accepter que, dans la grande majorité des situations, un point de vue unilatéral est exactement ce qu’il faut. Cependant, en pratiquant ce point de vue unilatéral, il est toujours important de bien comprendre sur quelle « axe » (informationnel vertical ou matériel horizontal) nous nous trouvons.
L’image, bien sûr, est à la fois illustrative et belle, mais il ne peut s’empêcher de susciter la curiosité : l’une des axes n’est-elle pas le descendant d’un autre axe ? Il ne peut pas être que, jadis, au commencement des temps, deux échelles aient émergé simultanément. D’abord, logiquement, quelque chose d’unique aurait dû apparaître, puis le second aurait dû se cristalliser à partir de celui-ci. Nous retombons ainsi dans le piège du discours sur les causes premières. Il a été mentionné précédemment qu’il n’existe pas de manière productive de raisonner sur la primauté de la matière et de la conscience, et donc laissons l’approche instrumentale nous permettre de ne pas aborder cette question.
Ainsi, il ne nous reste rien d’autre à faire que de nous avouer honnêtement qu’il est pertinent de parler de deux réalités – la matérielle et l’immatérielle. La manière dont elles s’entrelacent est une question à part, et nous allons apprendre à la résoudre. Pour l’instant, il nous suffit de comprendre que l’aspect immatériel n’existe pas sans le matériel, tandis que le matériel, sans l’idéal, se trouve entièrement dans le domaine de l’impensable « quelque chose ».
Réification
La réification est une erreur logique qui se produit lorsque nous oublions que la projection que nous examinons est une projection sur un « axe » informationnel, et que nous attribuons aux éléments de cette projection des propriétés qui ne se rencontrent que chez les éléments de la projection matérielle. La raison en est que notre expérience d’interaction avec des objets matériels est incomparablement plus riche que notre expérience d’interaction avec des pensées, des idées, des concepts. Nos yeux se tournent vers le monde matériel. Les sons que nous entendons proviennent d’objets matériels. Les choses que nous touchons sont matérielles. Par conséquent, en réfléchissant à un objet immatériel, nous essayons si souvent de le visualiser devant notre esprit, de « toucher » l’argumentation en termes de solidité, de comprendre ce que ce qui nous a été dit « dégage comme odeur ».
La réification est une erreur logique si répandue qu’il n’est même pas habituel d’en discuter. En russe, il n’existe même pas de mot pour cela, et dans différents textes, ce problème est désigné par des termes variés. Par exemple, dans la traduction que j’ai de la « Critique de la raison pure » d’Immanuel Kant, ce concept est désigné par le terme « hypostase ». L’article correspondant dans la version russophone de Wikipédia était absent au moment de la rédaction de ce texte.
Ce qui se passe lors de la réification peut être illustré par cette image :

Au lieu d’apprendre à travailler avec des concepts abstraits, nous enveloppons l’aspect informationnel dans la réalité matérielle et obtenons des choses concrètes, visuelles et facilement assimilables. Rien de bon ne peut en résulter lorsque l’existence d’un objet est attribuée à une totalité dans laquelle cet objet n’existe pas.
Le principal moyen à utiliser pour éviter la réification est de s’habituer, lors de nos réflexions sur l’existence des objets, à prêter immédiatement attention à ce queoù exactementL’objet existe. Donc, où est-il ?a lieuSi l’on parvient à lier clairement un objet à un espace physique, on peut affirmer sans hésitation qu’il s’agit d’un objet matériel (c’est-à-dire d’une projection de l’objet dans la réalité matérielle). En revanche, si, en répondant à la question « où ? », on doit se contorsionner et donner des réponses étranges, il s’agit probablement d’un aspect informationnel.
Un peu de pratique :
- Où est ma chaise ? Juste sous moi. Il y a une claire ancrage dans l’espace. Par conséquent, considérer cette chaise spécifique comme un objet matériel n’est en rien une réification.
- Où se trouve le nombre 2 ? C’est une question étrange. En principe, il peut être n’importe où. Tout dépend de la manière dont on utilise une règle. On pourrait bien sûr devenir fou et supposer qu’il existe quelque part, derrière de hauts murs, un dépôt de vérités mathématiques, où se trouverait l’étalon du nombre 2, mais cela n’est même pas drôle. Dans un moment de désespoir, on pourrait même avancer que le nombre 2 n’existe « en réalité », mais cela deviendrait très bizarre. Nous pouvons trouver la solution correcte de l’équation « x+x=4 », mais ce que nous avons trouvé, selon notre hypothèse, n’existe « en réalité » pas. Bien sûr, le nombre 2 existe, et on peut même dire où. Précisément entre les nombres 1 et 3 dans la série des nombres naturels. Pour la chaise sur laquelle je suis assis, le contenant est l’espace physique, et pour le nombre 2, le contenant est la série naturelle. Toute autre tentative de placer le nombre 2 quelque part (par exemple, dans un « monde d’idées ») donnera certes une visualisation agréable, mais n’aura aucun sens. La série naturelle (et alors, qu’elle soit aussi une abstraction ?) est suffisante pour répondre à la question « où existe-t-il ? » en ce qui concerne le nombre 2.
- Où se trouve ma maison ? Je peux donner deux réponses correctes :
- Il y a une adresse. Des coordonnées géographiques précises. Si l’on parle de la maison dans ce sens, nous avons un objet matériel qui nécessite parfois des réparations avec des outils tout aussi matériels : un marteau, un tournevis, une spatule et d’autres équipements de bricolage.
- Ma maison est là où je suis aimé et attendu. Ce qui est intéressant, c’est qu’un tel endroit n’a pas nécessairement besoin d’avoir des coordonnées géographiques. Si je suis aimé et attendu sur un forum en ligne, alors c’est aussi ma maison. La réponse s’est détachée de l’espace physique, et il est donc possible de constater que dans ce cas, il s’agit d’une projection d’un objet sur un axe informationnel.
- Où se trouve Wikipédia ? Il y a certainement des centres de données avec des serveurs où cette chose est hébergée. Mais pour la grande majorité d’entre nous, il est peu probable que nous ayons un jour à chercher Wikipédia là-bas. Il est beaucoup plus simple et rapide de la trouver à l’adresse « ru.wikipedia.org ». Il me semble que cette ligne de caractères ressemble très peu à des coordonnées spatiales.
- Où se trouve « Hamlet » ? Là, sur l’étagère. Oui, bien sûr, mais ce n’est qu’une moitié de la vérité. Il y a d’autres exemplaires. De plus, si en ce moment une des stations de radio diffuse une adaptation radiophonique de « Hamlet » (ce qui n’est pas impossible), alors on peut capter « Hamlet » avec une antenne.de n’importe quel point de l’espace, dans laquelle on peut capter un signal. «N’importe quel point de l’espace» n’est en aucun cas une localisation spatiale.
- Les objets matériels se trouvent dans l’espace physique. D’accord. Mais où se trouve cet espace physique lui-même ? Il ne peut pas se trouver en lui-même. Peut-être dans un espace de niveau supérieur ? Peut-être, mais cette affirmation ne résout pas le problème, car la question « où se trouve cet espace hypothétique de niveau supérieur ? » se pose immédiatement. La seule option honnête est de reconnaître que l’espace physique est une abstraction. Si vous avez eu l’impression que j’ai ici prouvé la primauté de l’idéal par rapport au matériel, c’est en vain. Je rappelle que la question de la primauté est complètement dépourvue de sens, car il n’existe pas et ne peut exister de situation dans laquelle elle pourrait être discutée de manière productive.
- Existe-t-il Harry Potter ? Et si oui, où ? Oui, il existe. Dans l’intrigue du conte de Harry Potter. C’est l’une des figures centrales. On peut dire qu’il en est le personnage principal, bien que les avis puissent diverger à ce sujet. Mais physiquement, bien sûr, il n’existe nulle part.
- Existe-t-il un Dieu ? Et si oui, où se trouve-t-il ? La réponse naïve d’un enfant « sur un nuage » est évidemment fausse, et presque tout croyant le confirmera. Il semble qu’aucune réponse à peu près valable à cette question (« dans les âmes des croyants », « partout où se fait le bien », etc.) ne ressemble vraiment à une localisation spatiale. Les mystiques de l’Antiquité comprenaient apparemment que le désir de réifier Dieu serait extrêmement fort, et c’est pourquoi ils ont introduit dans les religions qu’ils créaient une interdiction explicite de toute tentative de représenter Dieu sous une forme corporelle. Le judaïsme et l’islam ont réussi à maintenir cette interdiction, mais le christianisme, en raison de certaines de ses caractéristiques, n’a pas pu éviter de glisser vers une réification incontrôlée de Dieu. Cependant, le judaïsme et l’islam n’ont pas complètement échappé à la réification de Dieu. Dans ces deux religions, Dieu est secrètement réifié dans les textes de leurs écritures sacrées. Chez les juifs, cela s’exprime de manière particulièrement marquée par leur drôle de « B-r » et chez les musulmans, par leur relation incroyablement respectueuse envers les exemplaires du Coran et la direction vers La Mecque.
Le sujet de la «réification» mérite d’être abordé en détail, car le thème de «l’information» est l’un de ceux qui est le plus déformé par la réification. Nous sommes tellement habitués à «transmettre» l’information de bouche à oreille, à «la stocker» sur un disque, à «la garder» dans notre tête, à «la traiter» sur un ordinateur, qu’elle nous apparaît comme une sorte de «substance fine» qui se condense quelque part, qui est conservée ailleurs, qui voyage d’un point à un autre dans l’espace. C’est une métaphore si forte et évidente qu’il nous est même difficile d’imaginer comment on pourrait se passer de cette réification grossière. Revenons une fois de plus à notre exemple avec le livre. Si l’information est une sorte de substance fine qui se condense à l’intérieur du livre, alors dans l’imprimante qui l’a fabriqué, il doit y avoir des dispositifs qui injectent cette «substance fine» dans le produit. Mais nous savons exactement comment les livres sont fabriqués. De plus, nous savons exactement comment sont fabriquées les machines qui produisent des livres. Rien, à part le placement des molécules d’encre sur les fibres du papier, n’est fait par l’imprimante. Aucune «substance fine» n’existe tout simplement. Si nous voulons apprendre à parler de l’information de manière utile, nous devons absolument apprendre à en parler sans recourir à la réification.
Les conclusions du chapitre
La première tâche à laquelle la philosophie de l’information doit faire face est d’éliminer les pièges logiques les plus sournois qui empêchent d’engager un dialogue productif sur l’existence des entités immatérielles, à savoir :
- d’un discours absurde sur la primauté de la matière ou de la conscience ;
- sous-détermination du concept de « matière » ;
- habitudes de réification, qui vident immédiatement de tout sens les réflexions sur l’immatériel.
L’objet modèle « livre » introduit au début du chapitre permet non seulement de jouer avec la distinction entre les aspects matériel et immatériel de la réalité, mais donne également quelques indices sur la manière dont ces aspects peuvent s’unir en un tout cohérent.
Concepts et notions fondamentales :
- Le monde matérielcomme le monde des choses qui existent dans l’espace physique.
- Monde immatérielcomme le monde des choses dont la localisation dans l’espace physique est une erreur logique.
- Réificationcomme une erreur logique consistant à attribuer une existence matérielle à des choses immatérielles.
- Réception.«où existe-t-il ?», permettant de comprendre rapidement quelle facette de la réalité est en discussion. Si la conversation porte sur une chose qui existe dans l’espace physique, alors cette chose est matérielle. Si la chose n’a pas de place dans l’espace, alors elle est immatérielle. En particulier, la combinaison informationnelle mentionnée dans ce chapitre est une construction mentale, et donc tenter de tracer une frontière entre le pensable et l’impensable quelque part dans l’espace est déjà en soi une erreur logique.
- Scaphandre d’informationsujet – l’ensemble de tout ce qui peut être pensé par le sujet.
Chapitre 2. L’existence de l’information
Signaux et contextes
Nous devons apprendre à nous débarrasser de l’illusion selon laquelle l’information se trouve dans les livres, sur les disques durs, dans les câbles, les ondes radio et d’autres objets dont nous avons l’habitude de « extraire » l’information. Si nous avons définitivement accepté que la réification du concept d’« information » est inacceptable, nous devons simplement reconnaître que, par exemple, en lisant un livre, nous acquérons de l’information, mais que cet objet que nous devons utiliser pour cela n’en contient pas. L’objet doit nécessairement être présent (il est impossible de lire un livre sans l’avoir), maiscontenirUn objet physique ne peut pas contenir d’informations en lui-même.
Analysons attentivement ce qui se passe lorsque nous lisons un livre. Il est indéniable qu’il y a un certain processus physique en jeu, et certaines étapes de la lecture d’un livre sont plus facilement décrites en termes physiques. En particulier, si nous lisons un livre en papier avec nos yeux, celui-ci doit exister en tant qu’objet matériel, et un niveau d’éclairage acceptable doit être assuré. Le système optique « yeux » doit également être présent et en bon état. L’utilisation d’autres méthodes de lecture (Braille, programmes de synthèse vocale) ne change pas fondamentalement la situation, et dans ces cas aussi, il est pertinent de parler d’une certaine composante matérielle qui doit également être présente.
Il est également possible de tenter de parler en termes physiques de ce qui se passe dans nos cerveaux, en tant que lecteurs, après que le contenu a été livré d’une manière ou d’une autre, mais cela semble peu prometteur. Il se passe certainement quelque chose. La composante matérielle, sans aucun doute, est présente, mais nous n’avons actuellement pas de moyens de traduire en termes matériels une situation aussi simple et évidente que « j’ai été surpris par un retournement de situation ». On ne peut pas exclure que nous n’aurons jamais un tel moyen. Ne serait-ce que parce que, dans différentes têtes, le mécanisme de la surprise face à un retournement de situation peut être réalisé de manière différente.
La spécificité des processus d’information, contrairement aux processus matériels, réside dans le fait qu’un même processus d’information peut être réalisé « dans la matière » de manière fondamentalement différente tout en restant lui-même. Par exemple, la somme de deux nombres peut être trouvée à l’aide d’une calculatrice électronique, d’un boulier, de bâtonnets de comptage, d’une feuille de papier et d’un stylo, ou même dans son esprit. Le sens et le résultat de l’action resteront les mêmes. Un livre peut être reçu sous forme papier par la poste ou sous forme électronique par e-mail. La manière de réaliser cela influence bien sûr de nombreux détails, mais l’essence et le sens de ce qui se passe demeurent inchangés. Toute tentative de « matérialiser » un processus d’information dans une composante matérielle (« l’étonnement – c’est… »)rien d’autre, comme la sécrétion interne de dopamine », «l’enthousiasme –rien d’autre, comme la sécrétion interne d’endorphines ») est semblable à dire que l’addition de deux nombres est…rien d’autre, comme le déplacement de jetons en bois sur des rails en métal. La réalité matérielle est totale, donc tout processus d’information doit avoir un aspect matériel, mais il ne peut et ne doit pas se réduire à cela, sinon l’addition des nombres deviendrait un privilège monopolistique des jetons en bois. En passant à l’examen de l’aspect informationnel de ce qui se passe, il faut savoir s’abstraire de l’aspect matériel, tout en comprenant, bien sûr, qu’il existe indéniablement, mais sa nature précise n’est pas très significative pour nous.
Poursuivons l’examen du processus de lecture d’un livre, en nous abstraisant des détails de la réalisation matérielle de ce qui se passe. Pour que le lecteur puisse lire avec succès le texte qui lui est présenté, un certain nombre de conditions doivent être remplies. Tout d’abord, il doit connaître la langue dans laquelle il est écrit. Deuxièmement, il doit savoir lire. Troisièmement, il doit comprendre pourquoi cette activité est actuellement préférable à toutes les autres. Il n’est pas difficile de remarquer que dans toutes les conditions énumérées, il s’agit de la présence d’informations chez le lecteur, car « connaissance », « compétence » et « compréhension » sont tous des synonymes du concept d’« information ». Ainsi, pour lire un livre, nous avons deux ensembles de conditions pour le bon déroulement du processus : la présence d’un texte livré d’une manière ou d’une autre et la préparation préalable du lecteur. Nous désignerons la condition de livraison du texte comme l’exigence de présence.signalNous désignerons la condition de préparation du lecteur comme l’exigence de présence.contexteТекст для перевода: ..
Ce qui est important, c’est que ces deux ensembles de conditions se retrouvent dans tout processus que nous pouvons identifier comme l’acquisition d’informations. Même si l’on considère une chose aussi simple qu’une petite voiture télécommandée, elle ne peut recevoir des commandes que si, d’une part, tout va bien avec la transmission du signal radio (l’antenne n’est pas cassée et la voiture n’est pas trop éloignée de la télécommande) et, d’autre part, le bloc de contrôle de la voiture « comprend » les commandes envoyées par la télécommande. Ainsi, même si tout semble se dérouler dans un « matériel » de manière parfaitement déterminée, un des composants les plus importants qui a permis à la réception des données par le récepteur d’être réussie, ce sont les connaissances que le concepteur du récepteur a acquises auprès du concepteur de l’émetteur. C’est précisément ces connaissances qui ont permis au récepteur de devenir un objet matériel, dans lequel les atomes ne sont pas disposés n’importe comment, mais de manière tout à fait spécifique.d’une manière particulièreLa onde radio reçue par l’antenne n’est en aucun cas toute l’information qui est entrée dans le récepteur. Il y avait peut-être aussi un courriel électronique reçu par le développeur du bloc de contrôle de la petite voiture de la part d’un collègue qui travaillait sur la télécommande.
Les deux composantes – etsignal, et.contexte– Nous pouvons considérer cela à la fois sous l’angle matériel et sous l’angle informationnel. Mais si l’on peut parfois s’abstraire de l’aspect informationnel du signal (surtout lorsque la largeur du canal est manifestement excessive), il est impossible de s’abstraire de l’aspect informationnel du contexte, qui est par nature la capacité d’interpréter le signal.Le contexte est l’information sur la manière d’interpréter le signal., et c’est pourquoi nous devons le considérer comme une entité immatérielle.
Il peut sembler qu’il y ait un certain élément de tromperie dans le transfert de cette mystérieuse immatérialité dans ce « contexte » énigmatique. Mais il n’est pas difficile de remarquer que l’information perçue et l’information qui constitue le contexte sontdifférentsinformations. L’intrigue du livre et la connaissance de la langue dans laquelle il est écrit sont des savoirs différents. Si la récursivité de la construction (pour qu’il existe un contexte de second ordre, il faut un contexte de troisième ordre, et ainsi de suite à l’infini) suscite une certaine inquiétude, je tiens à préciser, en avançant un peu, que ce n’est pas un défaut de la construction signal-contexte, mais probablement sa caractéristique la plus précieuse. Nous reviendrons à ce sujet dans le cinquième chapitre pour prouver un théorème extrêmement utile à travers la récursivité de la construction signal-contexte.
Pour résoudre nos tâches métaphysiques, l’avantage essentiel de considérer l’information comme ce qui se produit à l’intersection du signal et du contexte réside dans le fait que cette construction constitue justement le pont entre les mondes qui nous manquait tant. Si, dans une situation donnée, nous parvenons à nous abstraire des aspects informationnels du signal (ce qui n’est souvent pas très difficile), nous avons la possibilité de réfléchir à la participation des objets matériels dans le processus informationnel. Si, en outre, nous avons réussi à examiner le contexte dans toute sa dualité (ce qui est courant à notre époque des technologies de l’information), nous obtenons alors pour cette situation spécifique un véritable pont entre les mondes matériel et informationnel. Il convient de noter immédiatement que la présence de ce pont ne nous donne toujours pas le droit de réifier l’information. Le signal, s’il est considéré comme un objet matériel, peut être réifié (un fichier enregistré sur une clé USB, la clé USB dans la poche), mais le contexte, c’est-à-dire la capacité d’interprétation du signal, ne peut pas être réifié.
Lorsqu’on considère une situation classique de transmission de données du point de vue de la théorie de l’information, nous avons un émetteur qui « insère » l’information dans un signal et un récepteur qui « extrait » l’information de celui-ci. Une illusion persistante se crée alors, celle que l’information est quelque chose qui existe à l’intérieur du signal. Mais il est important de comprendre que l’interprétation d’un signal spécialement préparé n’est pas le seul scénario d’acquisition d’information. En prêtant attention à ce qui se passe autour de nous, nous recevons une grande quantité d’informations que personne ne nous a envoyées. Une chaise ne nous envoie pas d’information sur le fait qu’elle est douce, une table ne nous envoie pas d’information sur sa dureté, la peinture noire sur la page d’un livre ne nous envoie pas d’information sur l’absence de photons, une radio éteinte ne nous envoie pas d’information sur son silence. Nous savons interpréter les phénomènes matériels qui nous entourent, et ils deviennent de l’information pour nous parce que nous avons déjà un contexte qui nous permet d’interpréter ce qui se passe. En nous réveillant la nuit, en ouvrant les yeux et en ne voyant rien, nous extrayons l’information selon laquelle il n’est pas encore jour non pas de la présence d’un phénomène physique, mais de son absence. L’absence d’un signal attendu est aussi un signal, et elle peut également être interprétée. En revanche, l’absence de contexte ne peut pas être considérée comme un « contexte nul » particulier. S’il n’y a pas de contexte, alors l’information n’a pas de lieu d’émergence, peu importe la quantité de signal reçue.
Nous savons tous très bien ce qu’est l’information (pour les êtres vivant dans une combinaison d’information, il ne peut en être autrement), mais nous avons tendance à considérer comme information uniquement la partie qui est ici désignée comme « signal ». Le contexte est pour nous une chose qui va de soi, et c’est pourquoi nous avons l’habitude de l’exclure. En mettant le contexte de côté, nous sommes contraints de placer toute « information » exclusivement dans le signal et, de ce fait, nous la réifions sans pitié.
Il n’y a rien de compliqué à se débarrasser de la réification de « l’information ». Il suffit d’apprendre à se rappeler à temps qu’en plus du signal, il y a toujours un contexte. Le signal n’est qu’une matière première qui acquiert un sens (valeur, utilité, importance et, oui, informativité) uniquement lorsqu’elle se trouve dans un contexte approprié. Et le contexte, c’est quelque chose dont il faut absolument parler en termes immatériels (sinon, cette discussion n’aura certainement pas de sens).
Rappelons brièvement le thème des « propriétés de l’information » et évaluons comment ces propriétés s’intègrent dans la structure à deux composants « signal-contexte ».
- Nouvelle.Si la réception du signal n’ajoute rien à l’aspect informationnel du contexte déjà existant, alors il n’y a pas d’événements d’interprétation du signal.
- Fiabilité.L’interprétation d’un signal par le contexte ne doit pas donner d’informations erronées (« vérité » et « mensonge » sont des concepts applicables à l’information, mais non aux objets matériels).
- Objectivité.La même chose que la fiabilité, mais en mettant l’accent sur le fait que le signal peut être le résultat du fonctionnement d’un autre contexte. Si le contexte qui essaie d’obtenir des informations et le contexte intermédiaire n’ont pas de compréhension mutuelle (en premier lieu sur les objectifs poursuivis), alors la fiabilité de l’information ne sera pas assurée.
- Plénitude.Le signal est présent, objectif, fiable, mais le contexte ne suffit pas pour obtenir des informations complètes.
- Valeur(utilité, importance). Il y a un signal, mais pas de contexte approprié. Tous les mots sont compréhensibles, mais le sens n’est pas saisi.
- Accessibilité.Caractéristiques du signal. Si le signal est impossible à obtenir, même la présence du contexte le plus approprié ne permettra pas à l’information d’émerger. Par exemple, n’importe qui pourrait facilement imaginer ce qu’on pourrait faire avec des données précises sur l’issue du match de football de demain. Mais, malheureusement pour beaucoup, ce signal n’apparaîtra qu’après la fin du match, c’est-à-dire à un moment où son utilité et sa pertinence ne seront déjà plus les mêmes.
À mon avis, les propriétés énumérées ci-dessus ressemblent davantage à une liste de pannes possibles qu’à de véritables propriétés. Les propriétés devraient plutôt décrire ce que l’on peut attendre de l’objet en question, et ce sur quoi on ne peut pas compter. Essayons de tirer de la construction « signal + contexte » au moins quelques conséquences évidentes qui, en fait, constitueront des propriétés non pas d’une information spécifique, mais de l’information en général :
- Subjectivité de l’information.Le signal peut être objectif, mais le contexte est toujours subjectif. Par conséquent, l’information ne peut être par nature que subjective. On ne peut parler d’objectivité de l’information que si l’on parvient à garantir l’unité du contexte entre différents sujets.
- Inexhaustibilité informationnelle du signal.Un même signal, en entrant dans des contextes différents, donne des informations différentes. C’est pourquoi, en relisant de temps en temps un livre préféré, on peut à chaque fois découvrir quelque chose de nouveau.
- Il n’existe pas de loi de conservation de l’information.Il n’existe tout simplement pas. Nous aimons que les objets avec lesquels nous interagissons obéissent strictement aux lois de la conservation et ne soient pas susceptibles d’apparaître de nulle part, et encore moins d’avoir l’habitude de disparaître dans le néant. Malheureusement, l’information ne fait pas partie de ces objets. Nous pouvons nous attendre à ce que seules les signaux puissent obéir aux lois de la conservation, mais à l’intérieur du signal, il n’y a pas d’information et il ne peut y en avoir. Il faut simplement s’habituer à l’idée qu’en mode normal, l’information vient effectivement de nulle part et s’en va vers nulle part. La seule chose que nous puissions faire pour la retenir d’une manière ou d’une autre, c’est de veiller à la préservation du signal (ce qui, en principe, n’est pas un problème), du contexte (ce qui est beaucoup plus compliqué, car il est changeant) et de la reproductibilité de la situation dans laquelle le signal entre en contexte.
- L’information est toujours la propriété complète et exclusive du sujet dans le contexte duquel elle s’est produite.Un livre (objet physique) peut appartenir à quelqu’un, mais la pensée engendrée par sa lecture est toujours la propriété exclusive du lecteur. Cependant, si l’on légalise la propriété privée des âmes des autres, on pourra également légaliser la propriété privée de l’information. Cela dit, cela n’annule pas le droit de l’auteur à être considéré comme tel. Surtout si c’est vrai.
- Le signal ne peut pas être attribué des caractéristiques applicables uniquement à l’information.Par exemple, la caractéristique « vérité » ne peut être appliquée qu’à l’information, c’est-à-dire à la combinaison du signal avec le contexte. Le signal lui-même ne peut être ni vrai ni faux. Un même signal, associé à des contextes différents, peut donner dans un cas une information vraie et dans un autre cas une information fausse. J’ai deux nouvelles pour les adeptes des religions « livresques » : une bonne et une mauvaise. La bonne : leurs livres sacrés ne sont pas des mensonges. La mauvaise : ils ne contiennent pas non plus de vérités.
Pour répondre à la question « où existe l’information ? » sans recourir à la construction signal-contexte à deux composants, il faut utiliser les approches populaires suivantes :
- «L’information peut exister dans des objets matériels.»Par exemple, dans les livres. En poussant cette approche à sa logique complète, il est inévitable de reconnaître l’existence de « l’inforode » – une substance fine, présente dans les livres en plus des fibres de papier et des morceaux de peinture. Mais nous savons comment les livres sont fabriqués. Nous savons exactement qu’aucune substance magique n’y est versée. La présence de substances fines dans les objets que nous utilisons pour acquérir des informations contredit notre expérience quotidienne. La construction signal-contexte se passe très bien de substances fines, tout en fournissant une réponse exhaustive à la question « pourquoi, pour lire un livre, a-t-on besoin du livre lui-même ».
- «Le monde est traversé par des champs d’information, dans la fine structure desquels est inscrit tout ce que nous savons.»C’est une idée belle et plutôt poétique, mais si c’est le cas, on ne comprend pas pourquoi il faut un volume de « Hamlet » pour le lire. Est-ce qu’il fonctionne comme une antenne réglée sur une onde spécifique de Hamlet ? Nous savons comment sont fabriqués les volumes de « Hamlet ». Nous savons avec certitude qu’aucun schéma de détection, réglé pour capter des champs d’outre-tombe, n’y est intégré. La construction contextuelle du signal n’a besoin d’aucune hypothèse sur l’existence de mondes invisibles parallèles. Elle se débrouille très bien sans ces entités superflues.
- «L’information ne peut exister que dans nos têtes»Une idée très populaire. La variante la plus insidieuse et persistante de la réification. Son insidiosité s’explique avant tout par le fait qu’aucune compréhension cohérente de ce qui se passe dans nos têtes n’a encore été élaborée par la science, et dans l’obscurité de cette incertitude, il est parfois commode de dissimuler toutes sortes de pensées inachevées. Dans notre monde vaste et diversifié, il arrive qu’une personne écrive une œuvre, puis, n’ayant pas eu le temps de la montrer à quiconque, meure. Et puis, après des années, le manuscrit est retrouvé dans un grenier, et les gens découvrent ce que personne d’entre eux n’a su tout ce temps. Si l’information ne peut exister que dans les têtes, comment peut-elle traverser cette période où il n’y a aucune tête qui la possède ? La construction signal-contexte explique cet effet de manière simple et naturelle : si le signal (le manuscrit dans le grenier) a été préservé et que le contexte n’est pas complètement perdu (les gens n’ont pas oublié comment lire), alors l’information n’est pas perdue.
Voyons comment l’idée de signaux et de contextes s’applique à ce qui se passe lors de la transmission d’informations. Il semblerait qu’il devrait se passer quelque chose d’étonnant : du côté de l’émetteur, l’information est présente, puis l’émetteur envoie au récepteur un signal qui ne contient pas d’information, et déjà du côté du récepteur, l’information est à nouveau présente. Supposons qu’Alice a l’intention de demander à Bob de faire quelque chose. Notons tout de suite qu’Alice et Bob ne doivent pas nécessairement être des personnes vivantes. Alice peut être, par exemple, un serveur de logique métier, et Bob un serveur de base de données. L’essence de ce qui se passe ne change pas pour autant. Donc, Alice possède une information qui est, bien sûr, en elle un mélange de signal et de contexte. En ayant cette information, ainsi que des informations sur les signaux que Bob peut recevoir et interpréter, elle effectue dans le monde matériel un certain changement (par exemple, elle écrit une note et l’accroche avec un aimant sur le réfrigérateur ou, si Alice et Bob sont des serveurs, elle utilise l’infrastructure réseau). Si Alice ne s’est pas trompée à propos de Bob, alors Bob reçoit le signal dans le contexte qu’il a et acquiert l’information sur ce qu’il doit maintenant faire. Le point clé est la communauté de contexte. Si nous parlons de personnes, la communauté de contexte est assurée par la présence d’une langue commune et l’engagement dans une activité commune. Si nous parlons de serveurs, la communauté des contextes se réalise par la compatibilité des protocoles d’échange de données. C’est précisément cette communauté de contextes qui permet à l’information de « sauter » apparemment la partie du chemin où elle ne peut pas exister et d’atterrir du côté du récepteur. En réalité, l’information, bien sûr, ne saute nulle part. Sur le fait qu’Alice possèdela mêmeL’information, que ce soit pour Bob ou pour quelqu’un d’autre, ne peut être discutée que s’ils possèdent des signaux et des contextes indistinguablement identiques. Dans la vie des gens, cela n’existe pas. Voir la couleur verte.ainsi, comme un autre le voit, c’est impossible, mais il est possible de s’accorder entre soi sur ce quetel.Nous désignerons la couleur entre nous par le signal « vert ».
La construction signal-contextuelle n’est pas tout à fait une nouveauté pour la philosophie mondiale. Il y a 250 ans, Emmanuel Kant écrivait que « notre connaissance (information ?) bien qu’il découle de l’expérience (signal ?), mais il est tout à fait impossible sans la présence d’une connaissance a priori chez le sujet connaissant (contexte ?)»..
Mesure de l’information
La mesure de l’information en bits est un plaisir que j’affectionne particulièrement. Il est impossible de résister à l’envie de réfléchir à ce sujet, tout en appliquant la méthode de comptage à la construction signal-contexte qui nous est devenue familière et, je l’espère, compréhensible.
Si l’on se souvient de la théorie classique de l’information, la formule généralisée pour calculer la quantité d’information (en bits) est la suivante :

où.n.– le nombre d’événements possibles, etp.n.– probabilitén.-ème événement. Réfléchissons à ce que signifie cette formule du point de vue du récepteur et de l’émetteur. L’émetteur peut rapporter, par exemple, cent événements, dont le premier, le deuxième et le troisième ont une probabilité de 20 %, tandis que les 40 % restants sont répartis uniformément sur les quatre-vingt-dix-sept autres événements. Il n’est pas difficile de calculer que la quantité d’information dans le rapport sur un événement du point de vue de l’émetteur est d’environ 4,56 bits :
I.= — (3 × 0.2×log2.(0.2) + 97 × (0.4/97)×log2.(0.4/97)) ≈ — (-1,393156857 — 3,168736375) ≈ 4.56
Ne vous étonnez pas du résultat fractionnaire, s’il vous plaît. En technique, il est vrai qu’on doit souvent arrondir à l’entier supérieur dans de tels cas, mais la valeur exacte est aussi souvent intéressante.
Si le récepteur ne sait rien de la répartition des probabilités (et comment pourrait-il le savoir ?), alors, de son point de vue, la quantité d’information reçue est de 6,64 bits (ce qui peut également être facilement calculé à l’aide d’une formule). Imaginons maintenant une situation où, pour les besoins du récepteur, seuls les événements numéro 1 (« exécuter »), 2 (« gracier ») et 100 (« décorer ») l’intéressent, tandis que tout le reste est considéré comme « autre » et sans intérêt. Supposons que le récepteur dispose déjà de statistiques sur les épisodes précédents et qu’il connaît la répartition des probabilités : exécuter – 20 %, gracier – 20 %, décorer – 0,4 %, autre – 59,6 %. En effectuant le calcul, nous obtenons 1,41 bit.
L’écart est considérable. Cherchons une explication à ce phénomène. Si l’on se souvient que l’information n’est pas seulement un signal objectivement existant, mais une combinaison de « signal + contexte », il n’est donc pas surprenant que la quantité d’information générée lors de la réception d’un signal soit également dépendante du contexte. Ainsi, nous avons une bonne concordance entre la conception signal-contexte et la théorie mathématique de l’information.
La grandeur«I», calculée selon la formule considérée, est généralement utilisée pour résoudre les problèmes suivants :
- Pour la construction d’un environnement de transmission de données. Si la tâche de codage est formulée comme « donner tout ce que l’on a, mais le faire de manière aussi efficace que possible », alors pour résoudre ce problème dans le cas décrit dans l’exemple examiné, il faut se concentrer sur une valeur de 4,56 bits. Autrement dit, il faut essayer de faire en sorte qu’en moyenne, un million de cycles de transmission s’inscrive le plus près possible de 4 561 893 bits. Il ne faut pas s’attendre à pouvoir réduire ce volume. Les mathématiques sont implacables.
- Pour comprendre dans quelle mesure l’incertitude du récepteur diminue lors de la réception d’un signal. On considère que l’arrivée d’informations réduit l’entropie informationnelle du récepteur d’une quantité équivalente à celle de l’information reçue. Si l’on considère la quantité d’information dans ce sens, les réponses correctes en fonction des propriétés du récepteur seront 6,64 et 1,41 bits. La valeur de 4,56 sera également une réponse correcte, mais seulement si le récepteur s’intéresse à tous les événements et connaît à l’avance leurs probabilités.
Dans la grande majorité des cas, lorsque nous parlons de bits, d’octets, de mégaoctets ou, par exemple, de gigabits par seconde, nous nous référons à la première interprétation. Nous préférons tous utiliser Internet à large bande plutôt qu’une connexion dial-up chétive. Mais il arrive parfois que nous devions passer une demi-journée sur Internet, lire une montagne de textes et visionner une multitude de vidéos juste pour obtenir enfin une réponse binaire simple à notre question, du genre « oui ou non ». Dans ce cas, notre incertitude ne diminue pas de ces dizaines de gigaoctets que nous avons dû télécharger, mais seulement d’un bit.
L’interprétation entropique de la nature de l’information soulève plus de questions qu’elle n’apporte de réponses. Même d’un point de vue purement pratique, nous constatons que la minimisation de l’incertitude se retrouve chez ceux de nos concitoyens qui n’ont jamais lu un seul livre, et dont tous les contacts cognitifs avec le monde extérieur se limitent à regarder des séries télévisées et des émissions sportives. Ces sujets respectables vivent dans une certitude heureuse et totale sur toutes les questions imaginables de l’univers. L’incertitude n’apparaît qu’avec l’élargissement des horizons et l’acquisition de l’habitude néfaste de réfléchir. La situation où l’acquisition d’informations (la lecture de bons livres intelligents) augmente l’incertitude est impossible du point de vue de la théorie entropique de l’information, mais du point de vue de la théorie signal-contexte, c’est un phénomène tout à fait ordinaire.
En effet, si le résultat de la réception d’un signal est la formation d’un nouveau contexte, alors pour le nourrir, nous avons besoin de signaux toujours nouveaux qui satisferont ce contexte, mais qui, en retour, peuvent créer un nouveau contexte originellement affamé. Ou même plusieurs.
Pas moins surprenantes sont les réflexions sur le fait que l’information pourrait être liée d’une manière ou d’une autre à l’ordre (si l’entropie est une mesure du chaos, alors la négentropie, c’est-à-dire l’information, devrait être une mesure de l’ordre). Examinons les séquences suivantes de zéros et de uns :
0000000000000000000000000000000000000000Un ordre parfait dans le style « rêve de la maîtresse de maison ». Mais il n’y a pas d’informations ici, tout comme il n’y en a sur une feuille de papier vierge ou un disque dur tout juste formaté.1111111111111111111111111111111111111111. En gros, c’est la même chose.0101010101010101010101010101010101010101C’est déjà plus intéressant. L’ordre reste parfait, l’information est toujours aussi rare.0100101100001110011100010011100111001011C’est moi qui n’ai pas hésité à lancer une pièce. 0 – face, 1 – pile. J’ai essayé de lancer honnêtement, et donc on peut supposer qu’il en est résulté un désordre parfait. Y a-t-il ici de l’information ? Et si oui, de quoi s’agit-il ? La réponse qui s’impose est « de tout », mais si c’est le cas, comment en extraire une version utilisable ?1001100111111101000110000000111001101111. De manière similaire à une pièce de monnaie, mais uniquement à travers un générateur de nombres pseudo-aléatoires.0100111101110010011001000110010101110010Ça ressemble aussi à une sorte de bêtise aléatoire, mais ce n’est pas ça. Je vais expliquer ce que c’est ci-dessous.
Si l’on enlève les commentaires textuels et qu’on pose une devinette sur ce qui pourrait être le résultat d’un lancer de pièce, les trois premières options seront immédiatement écartées. La cinquième est également suspecte, car il y a plus de 1 que de 0. C’est un raisonnement erroné. Lors d’un lancer de pièce honnête, l’apparition de toutes ces options a la même probabilité, égale à 2.-40.Si je continue à lancer une pièce sans sommeil ni repos dans l’espoir de reproduire au moins l’une des six options présentées, on peut s’attendre qu’avec un peu de chance, cela me réussisse dans environ cent mille ans. Mais il est impossible de prédire laquelle de ces options se reproduira en premier, car elles sont toutes également probables.
Le sixième point présente d’ailleurs le mot « Order » (c’est-à-dire « ordre ») en code ASCII à huit bits.
Il s’avère qu’il n’y a pas d’informations ni dans un ordre parfait, ni dans un désordre parfait. Ou peut-être qu’il y en a quand même ? Imaginez qu’une séquence parfaitement désordonnée de zéros et de uns (n°4) a été obtenue non pas par moi, mais par un employé du centre de cryptage de l’armée ennemie, et qu’elle est maintenant utilisée comme un morceau de clé secrète pour chiffrer des dépêches. Dans ce cas, ces zéros et uns cessent immédiatement d’être des déchets numériques sans signification et deviennent une information super importante, pour laquelle les déchiffreurs seraient prêts à vendre leur âme. Rien d’étonnant : le signal a acquis un contexte et, de ce fait, est devenu très informatif.
Je n’ai absolument aucun désir d’affirmer que la théorie de l’information entropique est complètement fausse. Il existe un certain nombre d’applications spécifiques dans lesquelles elle donne des résultats adéquats. Il est simplement nécessaire de bien comprendre les limites de son applicabilité. On peut supposer que l’une des restrictions devrait être l’exigence que le signal reçu ne conduise pas à la formation d’un contexte. En particulier, ce critère correspond à la plupart des moyens de communication. On peut effectivement parler de la distinction entre le signal et le bruit comme d’une lutte contre l’entropie.
La mesure de l’information a un autre aspect qu’il vaut mieux ne pas oublier. Le résultat de toute mesure unique est un nombre. Dans notre cas, il s’agit de bits, d’octets, de gigaoctets. Une fois que nous avons obtenu un nombre, nous comptons généralement sur le fait que nous pourrons ensuite l’utiliser de la manière qui nous est familière. Comparer en « plus/moins », additionner, multiplier. Examinons deux exemples d’application de l’opération « addition » aux quantités d’information :
- Il y a deux clés USB. La première fait 64 Go, la seconde 32 Go. Au total, nous avons la possibilité d’enregistrer 96 Go. Tout est correct et juste.
- Il y a deux fichiers. Le premier fait 12 Mo, le second 7 Mo. Combien avons-nous d’informations au total ? On a envie de les additionner et d’obtenir 19 Mo. Mais ne nous précipitons pas. D’abord, compressons ces fichiers avec un logiciel de compression. Le premier fichier a été réduit à 4 Mo, le second à 3 Mo. Pouvons-nous maintenant additionner les chiffres et obtenir un total ?vraiLe volume des données disponibles ? Je proposerais de ne pas se précipiter et de jeter un œil au contenu des fichiers sources. En regardant, nous constatons que tout le contenu du deuxième fichier se trouve dans le premier fichier. Il s’avère donc qu’il n’est pas du tout pertinent d’ajouter la taille du deuxième fichier à celle du premier. Si le premier fichier était différent, alors l’addition aurait un sens, mais dans ce cas précis, le deuxième fichier n’apporte rien au premier.
D’un point de vue informationnel, la situation avec les quines – des programmes dont l’une des fonctions est de produire leur propre code source – est très intéressante. En plus de cette fonction, un tel programme peut contenir d’autres éléments : un algorithme utile, des textes, des images, etc. Il s’avère donc qu’à l’intérieur du programme, il y a ce « quelque chose d’autre », et en plus de cela, il y a le programme lui-même, qui contient encore une fois l’intégralité de lui-même ainsi que ce « quelque chose d’autre ». Cela peut être exprimé par la formule suivante : A = A + B, où B n’est pas égal à zéro. Pour des quantités additives, une telle égalité ne peut pas exister.
Ainsi, la situation concernant la quantité d’information est très étrange. On peut dire que la quantité d’information est une grandeur conditionnellement additive. C’est-à-dire que dans certains cas, nous avons le droit d’additionner les chiffres disponibles, tandis que dans d’autres, ce n’est pas le cas. Lorsqu’il s’agit de la capacité d’un canal de transmission de données (en particulier, une clé USB peut tout à fait être considérée comme un canal de transmission de données du passé vers le futur), l’addition est correcte, tandis que lors de la « pesée » d’un signal spécifique, nous obtenons une grandeur dont la possibilité d’addition avec d’autres grandeurs similaires est déterminée par des facteurs externes dont nous pouvons même ne pas avoir connaissance. Par exemple, on peut parler de la capacité informationnelle du génome humain (l’ADN peut être considéré comme un support de transmission de données, et, autant que je sache, il existe des groupes de chercheurs essayant de construire des dispositifs de stockage basés sur l’ADN) et elle est d’environ 6,2 Gbit, mais toute réponse à la question«Combien d’informations sont spécifiquement enregistrées dans mon génome ?»Cela serait sans sens. Le maximum que l’on puisse affirmer, c’est que quelle que soit la méthode de calcul utilisée, le résultat ne peut pas dépasser ces fameux 6,2 Gbit. Ou, si la réalité est telle qu’il faut prendre en compte non seulement la séquence des bases nucléotidiques, alors cela peut être le cas. En revanche, si l’on parle de la quantité totale d’informations contenue dans une cellule vivante, il semble que la réponse à cette question ne puisse tout simplement pas être obtenue, ne serait-ce que parce que la cellule elle-même est un être vivant, et non un simple moyen de transmission de données.
En conclusion du sujet «mesure de l’information», j’aimerais introduire le concept de «classe d’informativité», qui permet d’évaluer le volume d’information, ne serait-ce que qualitativement :
- Informativité finale– situation où tout le signal contextuel nécessaire peut être codé par une séquence discrète de longueur finie. C’est précisément pour de telles situations que la mesure de l’information en bits est applicable. Exemples :
- Текст «Гамлета».
- Tous les textes qui nous sont parvenus, jamais écrits par l’humanité.
- Information dans le génome.
Les technologies de l’information actuelles fonctionnent précisément avec des informations finales.
- Infinie informativité– situation où un signal nécessite une séquence discrète de longueur infinie pour être codé, et toute restriction (« compression avec perte ») à une longueur finie est inacceptable. Exemple : les données sur la position des billes qui doivent être conservées lors d’une modélisation idéale du billard, de sorte que si l’on relance ensuite le processus à l’envers, la position initiale soit reconstituée. Dans ce cas, les vitesses et les positions des billes doivent être connues avec une précision infinie (un nombre infini de décimales), car en raison des fortes non-linéarités présentes, une erreur dans un seul chiffre a tendance à s’accumuler et à conduire à un résultat qualitativement différent. Une situation similaire se produit lors de la résolution numérique d’équations différentielles non linéaires.
Malgré l’apparente absurdité, il n’y a aucune raison fondamentale pour que, avec le développement des technologies, nous ne parvenions pas à acquérir des moyens permettant de travailler avec des informativités infinies.
- Informatique irrésolue– situation dans laquelle les données requises ne peuvent être obtenues par aucun moyen en raison de limitations fondamentales, qu’elles soient de nature physique ou logique. Exemples :
- Il est impossible de savoir ce qui s’est passé hier sur une étoile située à 10 années-lumière de nous.
- Il est impossible de connaître simultanément avec une précision absolue l’impulsion et la position d’une particule (incertitude quantique).
- Dans une situation de prise de décision, le sujet ne peut pas savoir à l’avance quelle alternative parmi celles disponibles il choisira. Dans le cas contraire (s’il connaît déjà la décision), il ne se trouve pas dans une situation de prise de décision.
- Une description déterministe complète de l’Univers ne peut être obtenue de quelque manière que ce soit. Cela est contrecarré par l’ensemble des limitations fondamentales – tant physiques que logiques. À cela s’ajoutent les effets liés au paradoxe du barbier.
S’il reste encore un certain espoir que la clarification de la réalité permettra de transformer certaines informations apparemment insolubles en informations finies ou, à tout le moins, infinies, les limitations logiques ne peuvent être surmontées, quelle que soit l’évolution des technologies.
«Information» en physique
Historiquement, le lien entre le thème de « l’information » et celui de « l’entropie » est né des réflexions sur le démon de Maxwell. Le démon de Maxwell est une créature fantastique qui se tient près d’une porte dans la paroi séparant deux parties d’une chambre contenant du gaz. Lorsque, à gauche, une molécule rapide arrive, il ouvre la porte, et lorsqu’une molécule lente arrive, il la ferme. Et si une molécule rapide arrive à droite, il ferme la porte, mais s’il s’agit d’une molécule lente, il l’ouvre. En conséquence, des molécules lentes s’accumulent à gauche, tandis que des molécules rapides s’accumulent à droite. L’entropie d’un système fermé augmente, et grâce à la différence de température générée par le démon, nous pouvons, à notre plaisir, faire fonctionner un moteur perpétuel de deuxième type.
Un moteur perpétuel est impossible, et c’est pourquoi, afin d’aligner la situation avec la loi de conservation de l’énergie, tout en respectant également la loi de l’augmentation de l’entropie, il a fallu raisonner de la manière suivante :
- Lorsque le démon est en action, l’entropie du gaz diminue.
- Mais en même temps, puisque les molécules interagissent avec le démon, le gaz n’est pas un système isolé.
- Il faut considérer le système « gaz + démon » comme un système isolé.
- L’entropie d’un système isolé ne peut pas diminuer, donc l’entropie plus l’entropie du démon ne diminue pas.
- Il en découle que l’entropie du démon augmente.
Pour l’instant, tout cela est logique. Mais que peut signifier « l’entropie du démon augmente » ? Le démon reçoit des informations (nous travaillons pour l’instant dans une terminologie traditionnelle) sur les molécules qui s’approchent. Si l’information est une entropie négative, alors l’entropie du démon devrait diminuer, et non augmenter. Supposons que le démon fasse un effort intellectuel simple et, par le biais d’un mécanisme de porte, transmette des informations à la molécule en vol (ou, en alternative, ne les transmette pas). L’entropie négative revient à la molécule, réduisant ainsi l’entropie du gaz. Mais pourquoi l’entropie du démon augmente-t-elle ? Pourquoi ne prenons-nous en compte que le flux d’information sortant du démon, sans tenir compte de celui entrant ? Que se passerait-il si le démon ne se contentait pas d’oublier immédiatement les signaux qu’il a reçus des molécules arrivantes, mais les mémorisait ? Peut-on dans ce cas dire que l’entropie du démon n’augmente pas ?
Norbert Wiener, en examinant le démon de Maxwell (« Cybernétique »), écrit qu’il est impossible de construire un moteur perpétuel à partir de cette chose, car tôt ou tard, l’entropie croissante du démon atteindra un seuil critique, et le démon se détériorera. En principe, cela semble logique, mais il est peu probable que la dégradation du démon soit expliquée par le fait qu’il transmette sa sagesse originelle aux molécules, devenant ainsi lui-même stupide. D’un point de vue informationnel, le travail du démon est très simple et ennuyeux. Il n’est pas question de « gaspillage d’énergie mentale ». De la même manière, nous ne disons pas, par exemple, que chaque fichier compressé par un programme d’archivage augmente l’entropie de l’archiveur et diminue ainsi progressivement sa capacité à compresser les données. Il est probable que l’impossibilité d’un moteur perpétuel basé sur le démon de Maxwell doit être expliquée non pas par des considérations informationnelles ou technologiques, mais par le fait que le gain énergétique provenant de la manipulation d’une molécule ne peut pas dépasser les coûts énergétiques liés à la détermination des paramètres de la molécule approchante, ainsi que les coûts de manipulation de la porte.
Les formules utilisées pour calculer l’entropie thermodynamique et l’entropie informationnelle sont globalement similaires. L’entropie thermodynamique (comparez avec la formule (1) ci-dessus) :
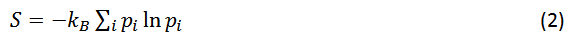
où.p.i.– probabilitéi.-ème état, maisk.B.– constante de Boltzmann. Mais cette formule est inévitablement liée à l’existence d’un sujet qui a classé les états et a identifié un nombre fini de groupes qui l’intéressent. Si l’on essaie de se débarrasser du sujet intéressé, on peut découvrir qu’il y a un risque élevé que l’expression correcte doive être écrite ainsi :

La probabilité totale est égale à 1 (le système doit nécessairement se trouver dans l’un des états) :

Un nombre infini d’états possibles est beaucoup plus proche de la vérité de la vie qu’un nombre fini. Il n’est pas difficile de montrer que si, dans le système considéré, le pourcentage d’états ne tend pas vers zéro.x., chez lesquels la probabilitép.x.non nulle, l’entropie intégrale tend vers l’infini. En termes de la formule (2) :

Ainsi, si l’hypothèse selon laquelle l’opération d’intégration est appropriée ici est correcte (et il suffit que l’une des grandeurs physiques possède la propriété de continuité), alors la capacité « informationnelle » de pratiquement n’importe quel système matériel (c’est-à-dire à l’exception des cas dégénérés) s’avère illimitée. Cela annihile tout sens à égaler l’entropie informationnelle à l’entropie thermodynamique. La similarité des formules peut être attribuée au fait qu’il existe dans notre monde de nombreuses choses fondamentalement différentes exprimées par des formules similaires. Il existe également d’autres arguments en faveur de la correspondance entre l’entropie thermodynamique et l’entropie informationnelle, mais, autant que je sache, ils n’ont jamais été soumis à une vérification expérimentale, ou (comme, par exemple, le principe de Landauer) sont eux-mêmes dérivés de l’hypothèse d’égalité des entropies.
En parlant du lien entre le thème de « l’information » et la physique, il est impossible de ne pas mentionner le concept de « l’information quantique ». Les lois de la mécanique quantique sont telles que, dans certains cas, il est effectivement pertinent d’utiliser des termes liés à l’information pour décrire ce qui se passe. Par exemple, selon le principe d’incertitude de Heisenberg, nous pouvons connaître avec précision soit l’impulsion d’une particule, soit sa position. Cela crée l’illusion que, lors d’une mesure, nous ne pouvons obtenir qu’un volume maximal d’information. Il en découle comme une sorte de conclusion automatique que, à l’intérieur de la particule, il pourrait exister une information dont le volume est strictement limité. Je ne peux rien dire sur la productivité ou la contre-productivité d’une telle utilisation des concepts d’information, mais il y a un fort soupçon qu’établir un pont entre le concept purement physique de « l’information quantique » et l’information que nous manipulons à un niveau macro (par exemple, « Hamlet ») est non seulement difficile, mais tout simplement impossible.
Pour transmettre notre macro-information, nous utilisons non seulement des objets et des phénomènes physiques, mais aussi leur absence. Le texte dans le livre est codé non seulement par la matière de l’encre, mais aussi par les espaces non colorés (on ne peut rien lire sur une feuille uniformément colorée). On peut également facilement imaginer de nombreuses situations où un signal très important est transmis non par une action énergétique, mais par son absence. Je suis même prêt à imaginer qu’à l’intérieur d’une particule se trouve une mystérieuse substance qui constitue l’information, mais imaginer queà l’intérieur du videLes particules contiennent aussi des informations – c’est quelque chose de tout à fait illogique.
À l’heure actuelle, au vu de notre compréhension du monde, il me semble que le concept d’« information quantique » devrait être considéré de la même manière que le concept de « couleur » appliqué aux quarks. Autrement dit, oui, l’« information quantique » peut et doit être reconnue comme une notion précieuse, mais il est essentiel de comprendre qu’elle ne peut avoir qu’un rapport indirect avec l’« information » dont nous parlons dans tous les autres cas. Peut-être que le conflit peut être résolu en considérant que la physique peut effectivement étudier de manière productive la base matérielle du signal transmis (en particulier, en répondant à la question de la capacité maximale d’un canal de transmission de données), mais la présence d’un signal, bien que nécessaire, n’est pas une condition suffisante pour affirmer qu’il y a de l’information dans l’objet considéré.
Il est nécessaire de comprendre clairement que nous n’avons pas de fondement physique à l’information (une sorte d’analogue de la théorie du phlogistique, mais applicable non pas à la chaleur, mais à l’information) non pas parce que nous ne savons pas encore tout, mais parce qu’il ne peut tout simplement pas y en avoir. L’une des exigences les plus essentielles de la méthode scientifique, appliquée de manière la plus claire et cohérente en physique, est l’élimination de l’agent agissant doté de libre arbitre de l’objet d’étude. L’agent (le soi-disant « observateur implicite ») doit bien sûr être présent à l’événement observé, mais il n’a pas le droit d’interférer. Le caractère mécaniste des phénomènes étudiés, c’est-à-dire l’absence totale d’activité dirigée, est ce qui fait de la physique ce qu’elle est. Mais dès que nous commençons à parler d’information, nous ne pouvons pas échapper au fait que les signaux reçus par l’agent sont des matières premières pour la prise de décisions. L’observateur implicite des phénomènes physiques doit se moquer de ce qu’il observe, tandis que l’agent agissant, vivant à la fois dans le monde matériel et dans la réalité informationnelle, ne peut en principe pas se permettre d’être indifférent. De cette opposition diamétrale des exigences posées à l’agent, placé au sein des phénomènes étudiés, il s’ensuit que le phénomène « information » ne peut être réduit à aucun phénomène physique, y compris ceux qui n’ont pas encore été découverts.
Ce qui est particulièrement surprenant, c’est qu’un excellent consensus a été atteint entre matérialistes et idéalistes sur la nécessité de l’existence d’une « information » physique profonde. Pour les matérialistes, cela est avantageux car la physique atteint ainsi une description totale de la réalité (il ne reste rien qui ne soit pas une réalité physique). Les idéalistes, quant à eux, célèbrent leur victoire car leur « esprit » est ainsi officiellement reconnu comme la base de l’univers. Ces deux camps, qui se sont longtemps affrontés, célèbrent leur triomphe, mais plutôt l’un sur l’autre, que sur le bon sens. Tant les matérialistes que les idéalistes réagissent de manière très agressive à toute tentative de relier les mondes matériel et idéal par un moyen alternatif de réification banale.
Données
Comme mentionné précédemment, un signal peut être considéré non seulement comme un objet matériel, mais aussi comme un objet immatériel. Selon le principe de la totalité de la réalité physique, un signal doit bien sûr avoir une incarnation physique, mais il arrive souvent que l’aspect physique du signal ne nous intéresse pas du tout, et que seule sa composante immatérielle nous préoccupe. Dans de tels cas, nous nous abstraitons complètement de la physique du signal, et il en résulte un objet plutôt étrange pour nos réflexions ultérieures. Nous avons écarté la physique, et il est toujours impossible de parler de la présence d’informations à l’intérieur de cet objet, car ce n’est qu’un signal, et pour qu’il y ait information, un contexte est nécessaire. Nous appellerons ces objets des données. Les données sont un signal immatériel. Elles ne sont pas immatérielles parce qu’elles ont une nature transcendante et voyagent à travers des entités astrales subtiles, mais parce que, dans ce cas précis, il ne nous importe pas de savoir comment elles voyagent. Par exemple, un volume de « Hamlet » dans un bel reliure, ou un exemplaire rare – c’est un signal dont nous sommes intéressés à la fois par la composante matérielle et immatérielle. Mais si nous avons simplement besoin de rafraîchir notre mémoire sur le monologue « être ou ne pas être », alors nous cherchons…текст., et peu importe où nous le trouvons. Un livre en papier, un fichier sur une clé USB, ou un service de bibliothèque en ligne, tout convient. Le texte de « Hamlet » est une donnée, tandis qu’un volume d’édition de luxe de « Hamlet » n’est pas seulement cela.
Un cas particulièrement intéressant est celui d’un objet pour lequel non seulement la physique n’est pas pertinente, mais où le contexte approprié est également absent. Imaginez une inscription dans une langue inconnue (je ne parle pas chinois, donc prenons le chinois). J’aimerais savoir ce que cette inscription signifie, alors je prends une feuille et je reproduis soigneusement les caractères. Je copie simplement tous les traits et les courbes. Pour moi, tout cela n’est que des traits et des courbes. Le sens de ce qui est représenté n’apparaîtra que lorsque je montrerai cette feuille à quelqu’un qui maîtrise le chinois, et qu’il traduira l’inscription dans une langue que je comprends mieux. En attendant que cela se produise, j’ai sur ma feuille un objet d’information qui est définitivement un signal, mais un signal pour un contexte qui est actuellement absent.
Dans le cas de la copie des caractères chinois, je pourrais ne pas me donner la peine de les redessiner.données(ce sont précisément des données) sur un morceau de papier, puis les photographier avec un téléphone et les envoyer à un ami par e-mail. Au cours du voyage de ce signal vers mon ami, l’absence de contexte pour interpréter cette inscription ne serait pas seulement observée par moi, mais aussi par le logiciel du téléphone, le programme de messagerie et toute la magnificence des protocoles Internet qui participeraient à la transmission des données. On pourrait dire que la compréhension, en général, est une caractéristique qui nous est propre, à nous, êtres complexes de chair et de sang, mais ce ne serait pas tout à fait vrai. Par exemple, lors de la transmission d’une image avec des idéogrammes, le niveau de transport du réseau compléterait les données transmises avec ses propres données de service, quicompréhensibles(c’est-à-dire seront correctement interprétés) les mécanismes qui mettent en œuvre le niveau de transport du réseau de transmission de données. Si l’on suppose quecompréhension– ce n’est pas nécessairement quelque chose de mystérieux et d’élevé, qui, d’un regard pénétrant, perçoit l’essence même des phénomènes, mais simplement la présence d’un contexte adéquat (dans le cas du niveau de transport du réseau, ce contexte est formé par le fait que les développeurs de l’infrastructure réseau respectent le protocole TCP). On peut donc affirmer avec certitude que les systèmes techniques possèdent également la capacité de compréhension. Oui, cette compréhension ne ressemble pas beaucoup à notre propre capacité, que nous observons de l’intérieur, à saisir l’essence des phénomènes, mais cela ne change rien à l’affaire.
Le concept de « données », bien qu’il n’apporte rien de fondamentalement nouveau à la métaphysique de l’information, s’avère néanmoins d’une grande utilité d’un point de vue pratique. La structure à deux composants « signal-contexte », bien qu’elle soit complète (le troisième composant n’est pas nécessaire), pose immédiatement de nombreux problèmes lorsqu’on essaie de l’appliquer dans la vie quotidienne. La source de ces désagréments réside dans le fait que le terme « signal » est clairement associé à l’aspect matériel du processus, et lorsque cet aspect matériel doit être ignoré, la force « ancrante » du « signal » commence à poser de sérieux obstacles. Imaginez que votre ami envisage de faire un voyage à Brême et vous demande comment il pourrait en apprendre davantage sur cette ville. La première chose qui vous vient à l’esprit est Wikipédia. En consultant les différentes sections linguistiques, vous remarquez que l’article en russe, bien qu’il soit bon, est très court, tandis que l’article en anglais, bien que beaucoup plus long, reste inférieur à celui en allemand (ce qui n’est guère surprenant). Maintenant, vous devez dire à votre ami que l’article en anglais contient plus d’informations que celui en russe, mais à ce moment-là, en vous remémorant la philosophie de l’information, vous comprenez qu’il n’y a pas d’informations dans aucune des sections. L’article sur Wikipédia est un signal qui devient de l’information lorsqu’il est placé dans un contexte. Problème.«Le signal enregistré sur les disques durs des serveurs anglophones de Wikipédia lorsqu’il entre dans le contexte de ta perception…»– Beurk, quelle horreur. Comment un camarade peut-il accéder à ces disques durs avec son contexte ?«Le signal, transmis via Wi-Fi depuis des serveurs anglophones…»– Ce n’est pas ça non plus. Quel rapport avec le Wi-Fi, si le camarade peut tout aussi bien aller sur Wikipédia via Internet mobile ? En remplaçant le terme « signal » par le synonyme « données » (dans ce cas, il s’agit bien d’un synonyme), tous les inconvénients disparaissent.«Tu peux regarder sur Wikipédia, mais garde à l’esprit que l’article en anglais, et surtout en allemand, contient beaucoup plus d’informations sur Brême.»Nous avons profité du fait que, même si, comme nous le savons maintenant, il ne peut y avoir d’informations dans l’article, les données constituent en fait l’article. Le signal, dont la réalisation physique dans ce cas précis ne nous importe pas.
D’après mon expérience, je peux dire qu’après avoir expérimenté le passage à une terminologie correcte dans la vie quotidienne et dans mon activité professionnelle (technologies de l’information), je n’ai jamais rencontré de situation où l’un de mes interlocuteurs ait remarqué que quelque chose avait changé. La seule chose à laquelle je dois maintenant faire attention, c’est de savoir s’il s’agit de données ou d’informations. Par exemple, dans une base de données, on ne stocke pas des informations, mais des données. Cependant, les utilisateurs, en saisissant ces données dans la base, échangent ainsi des informations. Le système reste toujours informationnel, mais fonctionne sur la base des données accumulées.
Avec le développement des réseaux de transmission, nous disposons d’un critère assez simple qui nous permet de déterminer si nous avons le droit de nous abstraire complètement de la physique d’un objet particulier et, par conséquent, de parler de lui comme d’un…objet d’information(c’est-à-dire à)données). Le critère est le suivant :Si un objet peut être transmis par Internet, alors nous avons tout à fait le droit de parler de cet objet comme d’un objet informationnel...
Exemples :
- La côtelette n’est pas un objet d’information, car elle nous intéresse (elle est savoureuse et nutritive) précisément dans sa manifestation physique.
- La recette de préparation d’une côtelette est un objet d’information. Elle peut être transmise sans perte sur Internet. Avec tous les détails et subtilités, avec des images, et même avec des vidéos.
- Une pièce de monnaie n’est pas tout à fait un objet d’information, surtout si elle a une valeur numismatique.
- L’argent est un objet d’information. Beaucoup d’entre nous, y compris moi-même, ont dû payer en ligne. En fait, l’argent est un objet extrêmement intéressant du point de vue de la philosophie de l’information. Peut-être vous souvenez-vous de ce qui a été dit précédemment, à savoir que l’information ne se soumet pas aux lois de la conservation, mais pour que l’argent fonctionne, il doit se conformer à la loi de conservation. C’est pourquoi pour les objets d’information « argent », une infrastructure a été artificiellement créée, qui veille délibérément à l’équilibre « si quelque part il y a un ajout, alors quelque part il doit y avoir exactement la même diminution ». Nous reviendrons à la discussion du phénomène de l’argent lorsque nous aborderons les sujets et la formation des systèmes.
Pour la clarté de la terminologie, il serait bien sûr préférable de parler non pas d’« informationnel », mais deobjet immatérielMais le terme « informationnel » est beaucoup plus pratique, car il ne contient pas la particule « ne ».
Je tiens à souligner que la règle empirique simple d’identification d’un objet informationnel a une structure « si-alors », et fonctionne donc dans un seul sens. Autrement dit, le fait que nous ne puissions pas transmettre quelque chose par Internet ne signifie pas que l’objet n’est pas informationnel. Par exemple, nous ne pouvons pas transmettre le nombre pi en « direct » (c’est-à-dire sous forme de séquence de chiffres). Nous pouvons transmettre la recette de préparation de cette « côtelette » (c’est-à-dire un programme qui calcule successivement les chiffres après la virgule du nombre pi), nous pouvons transmettre une image avec une désignation, mais nous ne pouvons pas transmettre cette « côtelette » elle-même.
L’information dans le nombre pi
Puisqu’on parle du nombre pi, il est intéressant d’examiner un cas amusant lié à cette notion.
On dit que parmi les chiffres qui composent la queue infiniment longue du nombre pi, il est théoriquement possible de trouver n’importe quelle séquence de chiffres prédéfinie. Pour être tout à fait précis, il ne s’agit pour l’instant que d’une hypothèse, ni prouvée ni réfutée. Il existe des nombres réels qui ont la propriété de contenir n’importe quelle séquence finie de chiffres (on les appelle « normaux »), mais l’hypothèse selon laquelle le nombre pi est normal n’a pas encore été prouvée. En particulier, un nombre normal contenant n’importe quelle séquence de zéros et de uns peut être obtenu en ajoutant successivement à la suite après la virgule décimale toutes les combinaisons possibles, en augmentant progressivement le nombre de chiffres. Voici comment :
0,(0)(1)(00)(01)(10)(11)(000)(001)(010)(011)(100)(101)(110)(111)(0000)… et ainsi de suite.
En notation décimale, cela donnera un nombre légèrement supérieur à 0,27638711, et ce nombre contient assurément le contenu de n’importe quel fichier de votre disque dur, même celui que vous n’y avez pas encore enregistré.
Mais nous allons fermer les yeux sur le fait que la normalité du nombre pi n’est pas prouvée et, dans nos réflexions, nous allons le considérer comme normal. Le nombre pi est entouré d’une multitude d’histoires, d’énigmes et de préjugés, et il est donc plus intéressant d’en discuter que de parler d’une quelconque production algorithmique banale. Si une erreur mathématique vous dérange, considérez simplement qu’à partir de maintenant, je ne parle pas du nombre pi, mais de tout nombre normal en base 2.
Cela donne une image plutôt majestueuse. Imaginez que, dans vos vieux jours, vous vous asseyez, que vous écriviez votre biographie détaillée et que vous l’enregistriez dans un fichier. Eh bien, il s’avère qu’au sein de pi, cette séquence de zéros et de uns existe déjà maintenant. Il y a aussi la même séquence, mais complétée par la date précise et les circonstances de votre mort. Voilà qui constitue véritablement un livre des destins, n’est-ce pas ?
Le début de notre livre des destins (la partie entière et les 20 premiers caractères de la queue infinie) est le suivant :
11.00100100001111110110…
Réfléchissons à la manière dont on pourrait lire un tel livre des destins. Supposons que j’aie écrit ma biographie jusqu’à ce jour, que j’aie pris un calculateur d’une puissance fantastique et que je l’aie contraint à trouver le début de ma biographie parmi les chiffres de pi. Il serait absurde de s’attendre à ce que la première occurrence trouvée ait une suite significative. Il est plus probable que ce soit un mélange insensé de zéros et de uns. En modifiant un peu l’algorithme du calculateur, je l’ai appris à trouver non seulement les occurrences d’une partie connue de ma biographie, mais aussi à analyser si la suite constitue un texte cohérent, écrit dans un style similaire. Et voilà, enfin, mon calculateur a trouvé un tel fragment. Je ne sais pas s’il va me réjouir ou me chagriner, mais je ne vais pas arrêter le calculateur. Qu’il continue son travail. Au bout d’un moment, il va me submerger d’une multitude de versions de ma biographie future trouvées dans le nombre pi. Certaines seront tout à fait ordinaires (« j’ai travaillé, je me suis retiré à tel moment, j’ai vieilli, j’ai souffert de telle maladie, je suis mort à tel moment »), mais d’autres seront beaucoup plus intéressantes. Par exemple, dans l’une des versions, il sera dit que demain, ni plus tôt ni plus tard, se produira une apocalypse zombie mondiale, et que je serai déchiqueté par des morts-vivants assoiffés de sang. Dans une autre, il sera inévitablement écrit (puisqu’il y a toutes les combinaisons de zéros et de uns dans le nombre) que j’acquerrai l’immortalité et l’omnipotence, et que je deviendrai le maître de l’Univers. Et encore une infinité de variantes, s’échappant sans fin du calculateur. Laquelle de ces versions croire ? Peut-être la toute première ? Mais pourquoi celle-là précisément ?
Pour simplifier ma tâche, essayons de deviner avec le nombre pi d’une manière un peu plus simple. Posons-lui une question binaire simple. Par exemple, est-ce que ce serait avantageux pour moi d’acheter aujourd’hui le paquet d’actions que j’ai repéré ? Si le premier chiffre après la virgule de pi est un un, cela signifie que l’oracle omniscient m’a répondu que c’est avantageux. Si c’est un zéro, cela signifie qu’il faut attendre. Voyons voir. Le zéro est apparu directement en première position, et le un, eh bien, même pas en deuxième, mais en troisième. Oh, quelque chose me dit qu’avec un oracle comme ça, je ne vais jamais acheter une seule action dans ma vie. Il faudrait ajouter à cet oracle un autre oracle qui me dirait quelle position regarder.
Il s’avère donc que pour extraireinformationsиз.donnéesIl nous manque un tout petit peu pour comprendre les livres du destin – une clé qui nous indiquerait de quel point de vue il faudrait lire ce livre. Sans cette clé, la seule information que nous tirons de l’infini enchevêtrement de chiffres du nombre pi, c’est le rapport entre la longueur de la circonférence et le diamètre. C’est presque triste, en fait…
Les conclusions du chapitre
Dans ce chapitre, grâce à la construction à deux composants « signal-contexte », nous avons appris non seulement à nous débarrasser de la réification de « l’information », mais aussi à obtenir un outil permettant, sans recourir à des pratiques mystiques, d’établir un pont entre les aspects matériels et immatériels de la réalité.
Principales notions et concepts examinés :
- Informationcomme la combinaison du signal et du contexte.
- Signalcomme une circonstance qui peut être interprétée.
- Contextecomment l’information sur la façon dont le signal peut être interprété.
- Le lien entre l’information et l’entropie existe, mais il ne faut pas l’absolutiser.Dans certaines situations, l’acquisition d’informations peut être considérée comme une victoire sur le chaos, dans d’autres – au contraire, dans d’autres encore – il est même impossible d’identifier de quel ordre il pourrait s’agir. La connexion avec l’entropie est le plus clairement observable lors de la résolution du problème de la transmission de données à travers un canal bruité, mais ce problème n’est pas tout ce que nous avons à faire avec l’information.
- Chaque fois,mesurant l’informationNous devons nous interroger sur la question de savoir si nous obtenons une quantité additive en résultat. Si ce n’est pas une quantité additive, il vaut mieux ne pas l’additionner à quoi que ce soit et ne pas la multiplier.
- Classe d’informativitéComment évaluer qualitativement les perspectives d’obtention des informations requises. Trois classes : informativité finie, infinie et indécidable.
- L’information ne peut pas avoir de fondement physique direct.Toute tentative de recherche d’une base physique de l’information peut et doit être considérée comme des métastases de la réification. Le lien entre la physique et l’information doit se faire uniquement à travers le concept de « signal ».
- Donnéescomme un signal, dont on peut s’abstraire de la composante matérielle. Le concept de « données », bien qu’il n’ait pas de valeur philosophique distincte, permet de se débarrasser des inconvénients liés à l’orientation matérialiste du concept de « signal ».
- Technique instrumentale«peut-il être transmis par Internet»pour une identification rapide, si l’objet en question estobjet d’information..
Chapitre 3. Fondements
Pour être honnête, il aurait fallu commencer le récit par les fondements. Sans eux, les réflexions précédentes semblent un peu suspendues dans le vide. Mais si j’avais commencé par les fondements, il est probable que le lecteur n’aurait pas compris pourquoi une telle étrangeté était nécessaire, et en conséquence, ce matériau si important serait resté inassimilé.
Qu’est-ce que des fondations et à quoi servent-elles ?
Les fondements philosophiques sont un outil permettant d’évaluer les énoncés en termes de leur fiabilité et, par conséquent, de leur applicabilité lorsque le coût d’une erreur est trop élevé.
Tout ce que nous pouvons affirmer peut être clairement divisé en trois classes d’énoncés (pour plus de détails et de justifications, voir Ludwig Wittgenstein dans le « Tractatus logico-philosophicus ») :
- Tautologies– des affirmations qui sont toujours vraies, quelles que soient les circonstances. La particularité des tautologies est que leur domaine de vérité absolue est complètement fermé sur leur propre domaine de définition. Par exemple, l’affirmation « il pleuvra ou il ne pleuvra pas » est toujours vraie, mais elle ne nous dit rien sur la probabilité qu’il pleuve aujourd’hui. Les tautologies ne sont pas nécessairement inutiles. Par exemple, toute la logique et toute la mathématique sont en essence des tautologies, mais lorsqu’on y ajoute des affirmations non tautologiques, elles se transforment en outils de travail précieux.
- Auto-contradictions– des affirmations qui sont toujours fausses, quelles que soient les circonstances. Elles ne peuvent également pas être utilisées pour déterminer s’il va pleuvoir ou non.
- Faits.– des affirmations qui peuvent être à la fois vraies et fausses. Si (c’est-à-dire quand) un fait est vrai, et que nous le savons, nous pouvons l’utiliser de manière productive, surtout si nous l’enrichissons avec une tautologie utile comme la logique ou les mathématiques. Si (c’est-à-dire quand) un fait est faux, mais que nous le considérons comme vrai, nous subissons des pertes.
La situation est plutôt dramatique. Nous pouvons nous rassurer avec de pures tautologies, nous enivrant de leur vérité, mais cela ne nous apportera aucun bénéfice, à part une satisfaction personnelle. Nous pouvons divertir le public avec des contradictions, mais cela ne nous fournira aucune information utile. Toutes nos connaissances utiles sur quoi que ce soit sont des faits qui, en principe, n’ont pas la propriété d’être absolument fiables.
Il s’avère que tout notre savoir utile est peu fiable, tandis que tout notre savoir fiable est en soi inutile, et ne devient utile que lorsque nous y ajoutons quelque chose de peu fiable ? Oui, c’est bien cela. Cette situation ne nous satisfait absolument pas, ne serait-ce que parce que l’affirmation selon laquelle tout notre savoir utile est peu fiable est tautologique, et toute application productive de celui-ci ne se produit que lorsque nous y ajoutons un fait « appliquant ». Et l’ajout d’un fait confère à l’affirmation selon laquelle le savoir utile est peu fiable la propriété d’un fait. C’est-à-dire la capacité d’être à la fois vrai et faux.
Si l’on formule la tâche comme « trouver un moyen d’identifier la situation dans laquelle l’affirmation selon laquelle la connaissance utile ne peut être fiable est fausse », alors cela constituera la tâche de recherche des fondements philosophiques.
Les méthodes les plus populaires pour obtenir des bases :
- Atteindre un consensus. Si tout le monde est d’accord pour dire que l’eau est mouillée et que la terre est plate, alors considérons cela comme des faits fiables. C’est une exploitation éhontée du conformisme humain, particulièrement « efficace » lorsqu’elle est associée à la violence.
- L’acquisition d’une source autoritaire. Ce principe peut être particulièrement illustré par les religions « livresques » – le judaïsme (la Torah et d’autres livres dont la véracité des affirmations n’est pas contestée), le christianisme (la Bible), l’islam (le Coran), ainsi que d’autres similaires, y compris le communisme (les œuvres des classiques du marxisme-léninisme). La faiblesse de cette approche réside dans le fait que plus il y a de faits pris comme fondement, moins la fiabilité globale est obtenue en conséquence, ce qui engendre un besoin pressant d’interprètes, dont l’activité gonfle et fragilise encore davantage les fondements. Les contradictions accumulées doivent généralement être résolues par la violence.
- L’acquisition d’un fait primaire compact. L’expérience de cette acquisition est particulièrement bien décrite par René Descartes dans son « Discours de la méthode… ». S’étant plongé avec audace dans un scepticisme total, Descartes a découvert que le seul fait indiscutable qu’il avait était : « Je pense, donc je suis ». Construire une immense et majestueuse structure de connaissance fiable sur ce fondement apparemment risible était une tâche extrêmement délicate, complexe et épuisante, mais il faut reconnaître que la science mondiale s’en est plutôt bien sortie. Ce qui est intéressant, c’est qu’elle l’a fait sans recourir à la violence pour parvenir à un consensus.
Avant de continuer, je ne résisterai pas au plaisir de démontrer que le « je pense, donc je suis » de Descartes, malgré son évidente vérité, n’est pas une tautologie, mais un fait qui peut être faux. Supposons que j’ai fabriqué un petit appareil qui suit si je suis encore en vie ou non. Dès qu’il reconnaît que je suis définitivement mort, il enverra des courriels à tous mes contacts avec le contenu suivant :«Bonjour, chers amis ! C’est avec tristesse que je vous annonce que je suis décédé le <insérer date et heure>, et que désormais je ne pense ni n’existe. Avec respect et mes vœux de longue vie, A.M.»Les technologies disponibles sont déjà suffisantes pour fabriquer un tel appareil. Si tout s’était déroulé comme je l’aurais souhaité, alors, lorsque mon heure serait venue, mes correspondants auraient reçu de ma part une lettre (exactement de ma part, car l’appareil n’est qu’un moyen de livraison différée), dans laquelle je déclarerais que je ne pense pas et n’existe pas. Et dans ce cas précis, cette déclaration serait vraie. Le fait que, par mon action (la fabrication de l’appareil), je parvienne à un avenir que je ne peux atteindre en personne n’a rien d’étrange. Atteindre quelque chose dans l’espace (par exemple, par téléphone) ou dans le temps est pour nous une chose tout à fait ordinaire. Ainsi, « je pense, donc je suis » est un fait qui peut être à la fois vrai et faux. Mais ce fait est toujours vrai lorsqu’il est déclaré par un sujet dans son propre « ici et maintenant ».
À notre grand regret, de la célèbre phrase de Descartes « je pense, donc je suis » ne peut pas être déduit tout ce dont nous avons besoin pour justifier les postulats de la philosophie de l’information. Certaines choses peuvent être déduites (par exemple, le concept de scaphandre informationnel et les réflexions qui l’accompagnent sur la limitation de notre propre monde), mais cela ne suffit pas. Même la construction « signal-contexte » ne peut pas être déduite de « je pense, donc je suis », car le simple fait de penser inclut la donnée de tous les contextes existants au sein de la pensée. Écarter les contextes du raisonnement (dans « je pense ») conduit à ce que tout le phénomène de l’information doive être transféré dans le signal, et là, il est désespérément réifié. Cela, d’ailleurs, soulève certaines réflexions sur les raisons pour lesquelles la question de la recherche des bases matérielles de la conscience est devenue une tâche insoluble pour le paradigme scientifique actuel. De plus, de « je pense, donc je suis » ne peut pas être déduit l’énoncé « je ne suis pas le seul à penser », qui est nécessaire ne serait-ce que pour considérer l’acte de communication. Il ne nous reste donc rien d’autre qu’à inventer un autre principe de recherche des fondements d’une connaissance fiable, en remplacement du familier et confortable « je pense, donc je suis ».
Comme test simple pour vérifier la fiabilité des fondements, on peut utiliser ce qu’on appelle le « raisonnement fou ».«Un argument fou»J’appelle l’hypothèse selon laquelle tout ce qui se passe autour de moi : toute ma vie, tous les événements, toutes les personnes avec qui je communique – n’est que le fruit de ma terrible maladie mentale, et en réalité, je ne suis rien d’autre qu’un être indescriptible complètement fou, attaché par des sangles à un lit dans un hôpital psychiatrique, dans un univers organisé d’une manière totalement différente de ce que je peux imaginer. Si la justification continue de fonctionner même face à une telle hypothèse monstrueuse, elle est fiable. Le « je pense, donc je suis » de Descartes résiste à cet « argument de la folie », et par conséquent, toute théorie qui en découle doit également y résister. Dans notre recherche d’une méthode alternative de justification, nous devons simplement parvenir au même résultat.
Bases dépendantes de la situation
L’idée principale que je vais appliquer pour établir les fondements de la philosophie de l’information sera de renoncer à la recherche de vérités absolues. Au lieu de cela, il est proposé de partir de la tâche à résoudre et de déduire à chaque fois des ensembles de fondements dont la fiabilité sera strictement locale, uniquement dans le cadre de la tâche en question. Cette approche n’est rien d’autre qu’une mise en œuvre de l’approche instrumentale de la philosophie, appliquée au problème de la recherche de fondements. Le prix à payer pour ce plaisir sera que, comme fondements, nous n’obtiendrons pas un produit unique, parfait à tous égards, digne d’être gravé sur des tablettes, mais un outil permettant de produire, selon les besoins, des produits dont la perfection sera également présente, mais celle-ci, la perfection, sera toujours strictement locale. En utilisant une analogie courante, nous renonçons à la recherche de l’outil de fixation idéal, et dans une situation où nous avons des vis, nous pourrons justifier l’utilisation d’un tournevis, tandis que s’il y a des clous, l’outil approprié sera un marteau.
Imaginez que vous êtes dans un supermarché, que vous avez rempli votre caddie de produits et que vous attendez maintenant à la caisse. Tant qu’il y a l’occasion, on peut philosopher sur l’illusion de ce qui se passe. Par exemple, sur le fait que le supermarché, la caissière et les produits que nous achetons ne sont rien d’autre qu’une combinaison de signaux qui parviennent à notre cerveau par le biais de nos nerfs visuels, auditifs et autres. On peut aussi réfléchir au fait que l’argent n’est qu’une convention et, du point de vue de la véritable structure de l’univers, représente une rare absurdité. Mais la queue avance, et au lieu de réflexions abstraites sur l’illusion de l’argent, la question « Ai-je oublié mon portefeuille à la maison ? » devient beaucoup plus pertinente. Quand nous sommes dans cette situation…à l’intérieur de la situationDans le cadre d’une transaction, la question générale « existe-t-il de l’argent ? » reçoit une réponse claire « certainement oui » et se transforme en une question plus spécifique « existe-t-il dans ma poche ou à la maison ? ». Ainsi, dans le contexte de la transaction, nous pouvons ajouter à notre toujours vrai fait « je pense, donc je suis » un fait tout aussi indiscutable en ce moment précis : « l’argent existe ». Bien sûr, nous pouvons poursuivre nos réflexions métaphysiques et, en ignorant le regard interrogateur de la vendeuse, ne pas entrer dans la situation de vente, ce qui nous amènerait à rentrer chez nous sans courses.
Imaginez que vous participez à un tournoi d’échecs. Si vous êtes vraiment venu pour participer, et non pas seulement pour taquiner les autres avec une métaphysique absconse, alors la condition d’entréeà l’intérieur de la situation«Un tournoi d’échecs» sera la reconnaissance du fait de l’existence non seulement de son propre «je», mais aussi du fait de l’existence des échecs, ainsi que des règles qui les régissent. Et aussi du fait de l’existence du tournoi et de ses règles. Vous pourriez peut-être essayer discrètement de contourner les règles (un smartphone puissant avec un bon programme d’échecs élève immédiatement le niveau à celui de maître) et cela pourrait même passer inaperçu. Mais cela n’annulera en rien le fait de l’existence des règles, ni le fait [d’une tentative infructueuse] de les enfreindre.
Le principe de justification situationnelle dépendante repose sur le fait queSi dans une certaine situation nous essayons d’en parler et de faire en sorte que cette parole ait un sens, nous pouvons sans hésitation inclure dans l’ensemble des faits primaires le fait même de l’existence de cette situation, le fait d’y être présent, le fait d’en parler (de penser à elle) et les faits concernant l’existence des entités sans lesquelles cette situation ne serait pas possible.Текст для перевода: ..
Il peut sembler qu’en ouvrant la voie à des faits primaires dépendants du contexte, nous donnons le feu vert à une licence intellectuelle qui mènera inévitablement à la possibilité de justifier n’importe quoi. Oui, les faits primaires dépendants du contexte sont un outil dangereux, mais ils ne deviennent dangereux qu’en cas d’utilisation inappropriée. On peut dégager deux règles simples qui rendent l’utilisation de cet outil utile et sûre :
- Lorsque le fait primaire est accepté avec succès et utilisé de manière très productive pour une situation donnée, il peut y avoir la tentation de l’absolutiser légèrement et de l’utiliser dans des réflexions sur d’autres situations. Il ne faut pas le faire. Le fait primaire ne doit pas dépasser le cadre de la situation ou de l’ensemble de situations pour lesquelles il a été établi. Par exemple, même si un tournoi d’échecs a un prix en argent, inclure dans cette situation le concept de « l’argent », qui est introduit pour des situations d’achat-vente, n’est pas correct, car dans la situation de « jeu d’argent », cet argent ne joue pas du tout le même rôle que celui qui lui est attribué dans le cadre d’une transaction commerciale. Même si ce sont en essence les mêmes billets de banque. En revanche, si le tournoi comprend des parties payées par contrat, alors la notion d’achat-vente apparaît dans la situation du tournoi, et il devient alors pertinent de parler de « cet argent » comme l’un des faits primaires.
- Ne pas considérer comme primaires les faits qui, bien qu’ils soient souhaitables dans une situation donnée, ne sont pas indispensables à celle-ci. Par exemple, je peux parler de la date de naissance d’une personne en termes de signes du Zodiaque (pour cela, je dois les prendre comme faits primaires), mais cela ne m’empêchera en aucun cas de considérer, comme hypothèse de travail principale, que toute l’astrologie, du début à la fin, n’est qu’un genre littéraire, dont l’essence réside dans la création de textes pseudo-prophétiques dénués de sens.
Une manipulation imprudente de toute méthode de justification philosophique donne un résultat déplorable. Même la beauté conceptuelle et la pureté idéologique du fait « je pense, donc je suis » n’ont pas empêché René Descartes d’introduire immédiatement plusieurs hypothèses qui lui semblaient évidentes, mais qui étaient en réalité très éloignées de la solidité, et par conséquent d’arriver à un « raisonnement » sur l’existence de Dieu qui s’éloigne complètement de la beauté et de la pureté.
Malgré toute la richesse des situations et, par conséquent, des faits primaires qui en découlent, cette méthodologie s’avère résistante à l’« argument fou ». En effet, mon existence au sein de la situation « supermarché, produits, caisse, argent » implique l’existence du fait primaire « argent », que je sois réellement physiquement dans la file d’attente à la caisse du supermarché ou que tout cela ne soit qu’une illusion de mon esprit malade.
Lié à l’idée«dans la situation»La méthode de justification philosophique est une conséquence logique de l’approche instrumentale de la philosophie, c’est-à-dire de la base du méthode évoquée dans l’introduction. Si nos raisonnements étaient entrepris pour établir une vérité absolue (« les lois les plus générales de l’organisation du monde »), alors une justification dépendante de la situation serait bien sûr complètement inappropriée. Mais si notre activité est orientée vers l’élaboration d’outils adaptés à la résolution de problèmes concrets, alors nous avons tout à fait le droit de nous appuyer à la fois sur le fait de l’existence de ces problèmes et sur notre besoin même d’outils appropriés.
Application des justifications dépendantes du contexte
Chaque fois, pour chaque situation particulière, repartir de zéro pour établir des fondements et construire toutes les chaînes est trop coûteux. Surtout compte tenu du fait que les situations ont tendance à changer presque à chaque minute. Il est donc judicieux de développer dès le départ un ensemble de méthodes permettant de formuler des affirmations qui, bien qu’elles ne prétendent pas au titre de vérités absolues (nous avons dû renoncer à cela dès que nous nous sommes engagés dans la situation), seront néanmoins applicables de manière suffisamment large.
Extraction de faits
Supposons que nous ayons déterminé qu’un fait est primordial pour une situation donnée. Il en découle que si nous faisons abstraction de ce fait et décidons de considérer que « tout cela est des absurdités, cela n’existe pas réellement », nous nous fermons automatiquement la possibilité d’examiner de manière adéquate cette situation précise, ainsi que toutes celles qui lui ressemblent. La prochaine fois, nous ferons abstraction de quelque chose d’autre, puis encore d’une autre chose, et finalement nous arriverons à un point où le champ des questions pour lesquelles nous pouvons avoir des faits primordiaux se sera rétréci à un point, se sera dégénéré et aura en fait cessé d’exister. Et tout cela à cause du fait que pour un fait primordial trouvé dans une situation, nous avons simplement trouvé une autre situation dans laquelle ce fait ne peut en aucun cas être primordial.
Considérons les deux affirmations suivantes :
- «La fée a transformé une citrouille en carrosse pour Cendrillon.»
- «Pour Cendrillon, la fée a fait une carrosse à partir de la tête de la belle-mère.»
Pour pouvoir dire quoi que ce soit sur ces ensembles de lettres, nous devons accepter comme faits primaires l’existence de Cendrillon, des fées et d’autres choses plutôt douteuses. D’une part, nous nous souvenons bien sûr que tout cela est une invention, mais d’autre part, nous pouvons affirmer avec certitude que la première affirmation est vraie et la seconde fausse. Mais comment un fait d’interaction entre deux objets inexistants peut-il être vrai ? Oui, bien sûr, dans le monde que nous appelons réel, cette Cendrillon, voyageant dans une carrosse en citrouille, n’a jamais existé. Mais cela suffit-il pour refuser catégoriquement l’existence de Cendrillon, fermant ainsi la porte à la possibilité de discuter de l’intrigue de ce conte plutôt agréable ? C’est tout simplement déraisonnable. Il serait plus judicieux de reconnaître qu’il existe un certain nombre de situations (que l’on peut désigner comme le « monde du conte de Cendrillon ») dans lesquelles l’existence de cette Cendrillon et de sa fée bienveillante est un fait primaire, tandis qu’en dehors de ce monde (même dans le monde du conte des trois petits cochons), ce fait n’est même pas une hypothèse plausible.
L’affaire, bien sûr, ne se limite pas à Cendrillon. Sous le couteau de négation décrit ici, des choses comme l’âme, la vie, la pensée, le sens, l’objectif, la liberté, l’amour et encore une immense liste de sujets sur lesquels il serait non seulement utile, mais carrément vital de parler de manière appropriée, sont facilement touchées.
L’extraction des faits primaires fonctionne selon l’algorithme suivant :
- Considérons une situation dans laquelle nous devons être capables de formuler des énoncés significatifs.
- Nous calculons les faits primaires qui se produisent dans cette situation.
- Apprenons à manipuler ces faits primaires sans réfléchir au fait que « en réalité, tout cela n’existe pas ». Il n’y a pas de « réalité » unique, éternelle et immuable. Il y a des situations dans lesquelles nous entrons et à l’intérieur desquelles nous devons savoir nous orienter.
Eh bien, il est bien sûr très souhaitable de ne pas traîner des Cendrillons, des fées, des diables, des dieux, et même la liberté, la pensée, les objectifs et les sens là où ils n’existent pas.
Un aspect très sérieux à considérer est que de l’essence de la situation, on peut extraire non seulement des faits initialement fiables, mais aussi des faits initialement non fiables. C’est-à-dire ceux qui, à l’intérieur de la situation, doivent logiquement pouvoir être à la fois vrais et faux. Prenons par exemple la situation où j’essaie de savoir quel temps il fera demain. Plus précisément, s’il pleuvra toute la journée. Les faits initialement fiables (vrais) dans cette situation seraient « demain arrivera certainement » et « il y aura certainement une météo ». Mais les faits initialement fiables ne sont pas tout ce que j’ai à ma disposition dans la situation considérée. Mon activité de recherche de réponse à ma question repose sur le fait que tant que je suis à l’intérieur de cette situation, je…inconnu, y aura-t-il de la pluie demain ? L’existence de la question et l’incertitude de la réponse sont des conditions logiquement nécessaires pour se trouver dans une situation de recherche de réponse.
Ainsi, à la situation peut être attribué un ensemble de faits initialement fiables (vrais ou faux) et un ensemble de faits initialement non fiables. Selon le critère de « fiabilité », il y a une séparation claire et sans ambiguïté des ensembles de faits au sein de la situation. Un fait dans la situation est présent soit comme une affirmation nécessaire, soit comme une question ouverte.
Un cas très intéressant est celui des problèmes mathématiques ouverts. En général, les mathématiques sont par nature une tautologie, où toutes les affirmations présentes sont soit absolument vraies, soit absolument fausses. Mais il existe un certain nombre d’affirmations dont nous ne savons pas si elles sont vraies ou fausses. Par exemple, l’une de ces questions est l’hypothèse de Riemann concernant les zéros de la fonction zêta. En raison de la tautologie des mathématiques, la réponse est bien sûr présente, et elle est unique. Mais elle est actuellement inconnue. C’est pourquoi les meilleurs esprits mathématiques du monde s’acharnent sur cette énigme, cherchant cette réponse. Ils seraient satisfaits de n’importe quelle option – que ce soit « oui, c’est vrai » ou « non, c’est faux ». Dans la situation de « recherche de preuve », l’hypothèse sur les zéros de la fonction zêta est une question ouverte, mais dès qu’une preuve sera trouvée, l’hypothèse cessera d’être une hypothèse, et cette affirmation deviendra soit un théorème prouvé, soit son négatif deviendra un théorème prouvé.
Recherche de situations
Supposons qu’à travers une opération d’extraction de faits, nous ayons obtenu une certaine affirmation avec la mention obligatoire « primaire fiable » ou « question ouverte ». Nous pouvons maintenant lancer le processus à l’envers et calculer les situations dans lesquelles ce fait est présent. Si nous avons appris à manipuler les faits extraits, cela signifie que nous avons appris à raisonner de manière adéquate dans toutes les situations où ce fait est présent. En passant des faits aux situations, il est même possible de trouver non seulement des situations individuelles, mais aussi des classes entières de situations. En conséquence, toute théorie ayant une justification à travers les faits primaires trouvés sera fiable dans n’importe quelle situation relevant de la classe.
Il me semble que la pratique de la construction artificielle de faits primaires pour rechercher des situations où ces faits se présentent exactement comme spécifié est à la fois curieuse et utile. Par exemple, c’est dans cette optique que j’ai abordé l’exemple mentionné ci-dessus avec le petit appareil qui m’informe de ma mort : j’ai pris notre fait primaire habituellement fiable « je pense, donc je suis » et j’ai imaginé une situation où ce fait devient fondamentalement peu fiable. Dans ce cas, l’incertitude est due au fait que je ne peux en aucun cas garantir que l’appareil ne donnera pas de fausse alerte, et c’est pourquoi il serait judicieux d’ajouter une note dans la lettre préparée, indiquant que le fait communiqué devrait être vérifié pour plus de fiabilité.
En principe, en opérant avec des faits artificiels, il peut arriver que l’ensemble des situations recherchées se révèle vide. Par exemple, pour l’affirmation « Harry Potter existe », il existe une classe de situations dans lesquelles cela constitue un fait intrinsèquement vrai (le monde du conte de Harry Potter) et une classe de situations où l’affirmation est intrinsèquement fausse (en dehors du monde du conte). Cependant, je ne parviens pas à imaginer une situation dans laquelle cette affirmation serait une question ouverte.
On peut affirmer que si nous apprenons à naviguer avec précision entre les situations et les faits primaires, et vice versa, entre les situations et leurs classes, nous serons en mesure d’élaborer des théories d’une fiabilité exceptionnelle.
Réalité objective
Lorsque nous commençons à appliquer des justifications situationnelles, quelque chose d’étrange commence à se produire avec la réalité objective. Cette même réalité qui doit exister en dehors de nos fantasmes et de nos désirs. La réalité que nous rêvons de connaître et sur laquelle nous souhaitons agir.
Tout d’abord, la réalité objective cesse d’être un tout homogène. En se retrouvant dans une situation et en en tirant un ensemble de faits primaires, nous obtenons une réalité qui n’a pas nécessairement à se rapporter d’une manière ou d’une autre à la vision du monde dérivée des faits primaires d’une autre situation. Le concept classique d’un Être unique, indivisible et éternel cesse d’être fondamental et devient davantage une curiosité historique qu’un outil de travail.
Deuxièmement, dans cette réalité objective étrangement fragmentée, commencent à pénétrer des entités très étranges. Celles que nous ne nous attendions pas à rencontrer dans la réalité objective. Par exemple, Cendrillon avec sa fée et sa carrosse en citrouille. Bien sûr, toutes ces entités étranges sont soigneusement enfermées dans des réserves d’où elles ne peuvent s’échapper, mais le simple fait de voir de telles curiosités pénétrer notre réalité si précieusement protégée ne peut, au départ, que choquer.
La rigidité de la conception d’une réalité objective, unique et indivisible a déjà conduit à ce que d’énormes pans des questions philosophiques les plus pressantes soient relégués dans le marécage trouble de l’agnosticisme. Ne pouvant affirmer l’existence objective, dans le cadre d’un Être indivisible, des objets avec lesquels nous devons composer à chaque seconde, nous avons assisté à un déferlement monstrueux de l’obscurantisme et de la désorganisation intellectuelle. Cela évoque l’image d’une jeune femme qui n’est prête à lier sa vie qu’à un prétendant idéal sous tous les aspects, et tant que de tels personnages ne se présentent pas, elle s’égare avec chaque passant.
Dans les chapitres suivants, nous devrons apprendre à manipuler des entités pour le moins inhabituelles, dont l’existence dans un Être unique serait tout simplement impossible à affirmer. Le concept de « contexte », qui est très discutable du point de vue de la réalité objective totale, n’était que le début. Si la science matérialiste peut, d’une certaine manière (il est évident que cela devient de plus en plus difficile chaque année), se contenter du lit de Procuste de l’Être unique, la métaphysique qui prétend se nommer philosophie de l’information ne peut se permettre le luxe d’ignorer le monde étrange et parfois contradictoire des objets immatériels. Dans de telles conditions, la seule alternative à l’abandon de l’indivisibilité de la réalité objective serait un détachement complet de toute réalité et une capitulation inconditionnelle au mysticisme. Il n’y aura pas de capitulation. Il y aura une réalité objective fragmentée, avec laquelle nous apprendrons à travailler.
Révision du passé
Il est maintenant temps, ayant reçu la méthodologie de justification, de passer en revue les deux chapitres précédents (je passe l’introduction et le bref historique de la question, car il n’y a rien à justifier) et de critiquer avec un degré extrême de minutie les affirmations douteuses qui y figurent.
Dualisme : la métaphore « livre »
- Quel droit avais-je de parler d’un livre comme d’un objet matériel ? Comment pouvais-je savoir que toute cette « masse », ce « volume », ces mystérieuses « propriétés chimiques » et autres choses existent réellement, et ne sont pas le fruit de malveillants démons ou de créateurs fous de mondes virtuels ?
Si je dois déplacer une armoire et que je n’ai pas la force de la soulever avec les livres, je dois physiquement retirer les livres de l’armoire. Dans cette situation, les livres sont considérés comme des objets matériels, ayant une masse et occupant de l’espace. Que la réalité soit réelle ou virtuelle, je me trouve dans la situation « il faut déplacer l’armoire ». Ainsi, le fait que « le livre est un objet matériel » est valable au moins dans une situation, et donc nous avons le droit d’en parler.
- Sur quel droit ai-je décidé que le livre est un objet immatériel ? Le livre est en effet un objet exclusivement matériel ! Il a une existence objective, indépendante de notre conscience et de notre connaissance à son sujet. « Exister objectivement » est une propriété de la matière, et seulement de la matière, tandis que tout le reste n’existe que subjectivement, c’est-à-dire de manière peu fiable, indémontrable, fantomatique et indigne d’attention. (C’est moi, désolé, qui reproduis le raisonnement standard des matérialistes dialectiques.)
Pour établir ce fait, nous n’avons pas besoin d’aller bien loin. Vous, lecteur (oui, vous personnellement dans votre « ici et maintenant »), vous vous trouvez dans la situation de « lire un livre ». Ce livre en particulier. Voyons quel fait primaire est une partie intégrante de cette situation. Mon existence – certainement pas, car elle est évidente seulement pour moi, mais pour vous, elle ne résiste pas à l’« argument du fou ». Et d’ailleurs, peut-être que justement maintenant (dans votre « maintenant »), je suis en train de dormir profondément, et donc je ne pense pas. Ou je suis déjà mort, et en tant qu’organisme vivant, je n’existe pas du tout. Peut-être que le fait primaire serait l’existence de la surface sur laquelle vous lisez les lettres ? Elle est certes souhaitable, mais pas obligatoire. Si vous écoutez ce livre, il n’y a aucune surface. Nous l’écartons donc comme souhaitable, mais non nécessaire. Peut-être votre capacité à comprendre ce livre ? Évidemment, mais cela ne suffit pas. Il faut quelque chose d’autre. Il faut le texte de ce livre. Ce texte même que vous lisez. Sans lui, il ne s’agit plus de lire un livre. Il s’avère donc que dans la liste des faits primaires que vous avez actuellement, on peut sans hésitation ajouter quelque chose comme le texte du livre. Le texte du livre peut exister ou ne pas exister, mais précisément maintenant, il existe de la manière la plus objective qui soit.
La nécessité d’opérer avec des entités immatérielles se manifeste non seulement dans la situation de lire un livre, mais aussi dans toute situation où nous avons besoin d’en savoir plus sur quelque chose que nous ne pouvons pas toucher pour le moment. Même si je regarde par la fenêtre, que je vois des gouttes tomber et que je décide de prendre un parapluie, ce parapluie ne me servira pas à me protéger des gouttes que j’ai vues (elles auront déjà eu le temps de tomber), mais d’autres gouttes. Les molécules d’eau sont de la matière, mais lorsque je regardais par la fenêtre, ce qui m’intéressait, ce n’étaient pas elles, mais l’objet immatériel « la réponse à la question de savoir s’il pleut actuellement ».
Dualisme : la totalité de la réalité physique
Pourquoi ai-je lié la réalité matérielle exclusivement à l’espace physique ? Qu’en est-il du temps ?
L’espace est un contenant très pratique pour les objets qui ne sont pas « moi ». Et même pour un objet aussi particulier que « mon corps ». En revanche, le temps est un mauvais contenant. Les objets dont la place est exclusivement dans le passé n’existent plus (il n’existe que leurs traces dans le présent), tandis que ceux qui sont exclusivement dans le futur n’existent pas encore (il n’existe que des intentions ou des prévisions qui se trouvent dans le présent). Si je peux me déplacer dans l’espace et placer mon « ici » à côté de l’endroit occupé par l’objet qui m’intéresse, dans le « maintenant », je suis fermement enfermé. Le temps est une entité extrêmement intéressante d’un point de vue métaphysique et, dans le cadre de la philosophie de l’information, nous en parlerons certainement, mais pour l’instant, il est important de noter que, du point de vue de son utilisation comme contenant pour l’existence des objets, c’est un choix très malheureux.
Dualisme : la totalité de la réalité informationnelle
Dans les réflexions sur les mondes des sujets, j’ai audacieusement postulé qu’en plus de moi, il existe d’autres êtres, et que ma combinaison d’information ne correspond pas à leurs combinaisons d’information. N’est-ce pas imprudent ? Peut-être que la combinaison d’information est unique pour tous ?
Lorsque nous nous trouvons dans une situation de « communication », nous devons reconnaître comme un fait primordial l’existence de l’autre avec qui nous communiquons. Dans certaines situations, il peut être difficile d’obtenir une connaissance fiable de ce que représente réellement notre interlocuteur (un interlocuteur « linda » avec un chat sur son avatar peut s’avérer être un homme barbu ou même un bot programmé), mais le fait même de la présence d’un interlocuteur dans la situation de « communication » est indiscutable.
L’hypothèse de l’unité de tous les combinaisons d’information est contredite par le fait que nous pouvons nous retrouver dans une situation où certaines entités présentes à l’intérieur de notre combinaison sont présentes, tandis que d’autres ne le sont pas à l’intérieur de la combinaison de l’être avec lequel nous communiquons (situation de « communication avec un chien »). Et l’idée selon laquelle la combinaison du chien serait un sous-ensemble de la nôtre n’est ni prouvable ni réfutable, car pour prouver ou réfuter cela, il faudrait sortir des limites de son propre monde, ce qui n’est pas possible.
Dualisme : la totalité de l’indivisibilité des réalités
Une image avec deux axes (matériel et immatériel) découle logiquement de la totalité et de la diversité des deux réalités. Nous semblons avoir compris la totalité, mais pourquoi doivent-elles être différentes ? Peut-être ne sont-elles finalement pas différentes, et si l’on parvenait à introduire habilement un troisième axe, il pourrait englober tout ce dont nous avons besoin ?
Toute la famille de situations dans lesquelles nous pouvons nous retrouver peut être grossièrement divisée en celles où l’existence d’objets dans l’espace est essentielle et celles où la spécificité de l’espace n’est pas significative. Quand il s’agit de trouver la clé de la maison (« mon dieu, dans quelle poche l’ai-je mise ? »), la position spatiale de l’objet recherché est cruciale. Ainsi, au sein de telles situations, l’existence de l’espace physique est postulée précisément comme l’axe « matériel » est tracé. Cela nous donne immédiatement la nécessité de cet axe matériel tel qu’il est. Même si nous traçons un autre axe de manière très astucieuse, il doit tout de même y avoir au moins deux axes. Et s’il y a deux axes, cela signifie qu’ils sont différents.
En fait, l’image avec deux axes est problématique précisément parce qu’il n’y a que deux axes. Idéalement, il devrait y en avoir davantage, car un même objet peut souvent être considéré sous différents angles. L’aspect matériel (spatial) est unique, car nous avons un seul contenant pour l’existence de la matière. Mais il peut y avoir autant d’aspects immatériels que notre imagination peut le permettre. Il y a la valeur cognitive, la valeur monétaire, l’esthétique, et bien d’autres encore. Toute cette richesse a dû être réduite à une seule échelle « informationnelle » conventionnelle uniquement pour pouvoir être représentée d’une manière ou d’une autre sur un dessin en deux dimensions.
Dualisme : réification
Ah, en fait, pourquoi devrions-nous avoir peur de cette chose ? Peut-être que la réification, surtout lorsqu’elle est bien réalisée, est justement ce dont nous devrions rêver ?
De manière similaire au point précédent, nous prenons des situations où la présence d’un espace physique n’est pas nécessaire. Dans de telles situations, postuler l’existence d’un espace physique en tant que contenant (et, par conséquent, exiger que les objets considérés aient effectivement leur place en lui) constituerait une violation du principe de « ne pas introduire dans les faits primaires quoi que ce soit qui ne découle pas de l’essence de la situation ».
Existence de l’information : signaux et contextes
- Que diriez-vous des informations sans signal ?
Si la situation ne contient que des faits initialement fiables, alors elle est complètement définie, et aucun « entrant » supplémentaire n’est nécessaire. Mais, malheureusement, une telle situation se retrouve complètement tautologiquement fermée sur elle-même. Ni entrée, ni sortie. Système isolé. Elle n’a pas d’intérêt pratique. L’intérêt pratique apparaît lorsque la situation comporte des questions ouvertes. Et quand une question ouverte se présente, il devient nécessaire de comprendre ce qui peut se passer avec elle et comment. Un signal est justement quelque chose qui provient de l’extérieur de la situation et qui entraîne des changements dans la question ouverte. Soit il donne une réponse claire, et alors la situation se termine et se transforme en une autre situation, dans laquelle le fait qui était présenté sous forme de question ouverte devient un fait initialement fiable, soit il apporte des précisions, mais ne ferme pas complètement la question.
En considérant toute situation avec des questions ouvertes, nous devons supposer l’existence de signaux influençant l’ouverture de ces questions.
- Que dire de l’information sans contexte ?
Dans une situation avec une question ouverte, cette même question ouverte constitue le contexte, qui, étant donné que nous avons postulé l’ouverture de la question, ne peut pas ne pas exister.
- Peut-être qu’en plus du signal et du contexte, il faudrait ajouter autre chose ?
Peut-être. La construction signal-contextuelle n’est qu’un outil. Si elle peut être améliorée, pourquoi pas ?
Existence de l’information : mesure de l’information
- Qui a dit que la formule de Shannon est correcte ?
La formule ne peut pas être incorrecte. C’est son application qui peut l’être.
- Et peut-être que les déterministes ont raison, et que toute l’information sur le passé, le présent et l’avenir de l’Univers existe quelque part de manière objective ?
Supposons que ce soit le cas. Acceptons l’existence de cette information (probablement, de ces données) comme un fait fondamentalement fiable et essayons d’imaginer une situation caractérisée par ce fait primaire. La première chose à laquelle on peut prêter attention, c’est que le sujet se trouvant dans cette situation connaît avec une précision absolue tout son avenir. Par conséquent, la situation de prise de décision est impossible pour lui (toutes les décisions ont déjà été prises et lui sont connues à l’avance). La situation qui en résulte est complètement dépourvue de questions ouvertes et, par conséquent, le contexte du sujet est égal à zéro. Autrement dit, le sujet a un signal omniprésent, mais n’a aucun contexte pour interpréter ce signal. Ce sujet hypothétique tout-sachant, bien qu’il existe (c’est précisément pour lui que nous avons construit la situation), est catégoriquement incapable de penser. De ce raisonnement simple, il découle que l’hypothèse de l’existence objective d’un livre universel déterministe des destins entre en contradiction irréductible avec le fait « je pense ».
Ne vous étonnez pas qu’en partant de l’idée du pandéterminisme, nous soyons immédiatement arrivés à celle d’un être omniscient. Il aurait été tout aussi possible, en partant de l’être omniscient, d’aboutir au pandéterminisme. En essence, le matérialisme vulgaire et le mysticisme monothéiste sont deux faces d’un même absurde.
Existence de l’information : « information » en physique
- D’où vient cette certitude qu’avec l’aide du démon sorcier Maxwell, il est impossible de violer la loi de conservation de l’énergie ?
Si nous parlons de la loi de conservation de l’énergie, nous devons comprendre le terme « énergie » dans le sens qui lui est donné en physique. En physique, l’énergie est par définition ce qui se conserve lors de toutes les transformations. La validité même du concept d’« énergie » en physique est une hypothèse, mais jusqu’à présent, nous avons eu la chance que, lorsqu’un déséquilibre dans la somme des types d’énergie connus était découvert, un nouveau type d’énergie était toujours trouvé, dans lequel la différence avait été transférée ou d’où elle provenait. Dans le contexte de la « physique théorique », la découverte d’une violation de la loi de conservation de l’énergie est un signal pour rechercher un nouveau type d’énergie. Hypothétiquement, il est bien sûr possible que, face à un déséquilibre trouvé, un nouveau type d’énergie ne soit pas découvert, mais cela signifierait alors qu’il faudrait renoncer au concept d’« énergie ». Quoi qu’il en soit, pour tirer la sonnette d’alarme, une expérience réelle est nécessaire, et, autant que je sache, personne n’a encore réussi à créer un démon de Maxwell fonctionnel.
- D’où vient cette certitude que le progrès de la physique ne mènera finalement pas à la découverte de l’inforode ?
Voir ci-dessus sur l’absurdité de la réification. Il est certain que l’on trouvera à maintes reprises quelque chose que l’on voudra rapidement considérer comme la base matérielle de l’information. Dans cette situation, je proposerais de se rappeler que nous connaissons déjà des milliers de façons de matérialiser un signal, et de considérer le phénomène nouvellement découvert comme un de ces moyens supplémentaires.
Existence de l’information : données
La définition du concept d’« objet d’information » en faisant appel au concept d’« Internet » n’est-elle pas un peu exagérée ?
Ce n’est pas une définition, mais simplement un critère qui peut parfois être utile.
Les conclusions du chapitre
La folie ne fera que croître. Le seul moyen de rester ancré dans la réalité et de ne pas se lancer dans un vol sans but de pensées débridées est de s’accrocher de toutes ses forces à des fondations solides et inébranlables.
Principales notions et concepts examinés :
- Fondement philosophiqueComment distinguer des concepts fiables d’une fantaisie déconnectée de la réalité.
- «Argument fou»comme un outil pour tester la fiabilité des bases.
- Fait primairecomme n’étant pas une tautologie, une affirmation dont la véracité est acceptée comme un fait. Il existe différentes approches pour résoudre la tâche d’acquisition de faits primaires, et la justification dépendant de la situation en est une.
- Essence.justification dépendante de la situationDans le fait que si nous examinons une question, soit nous pouvons accepter le simple fait de son existence comme un fait primaire, soit nous devons reconnaître que notre activité est dépourvue de sens.
- Les faits primaires peuvent être clairement divisés enpremièrement vraisfaits etinitialement peu fiablesfaits.
- Règlesjustification situationnelle (elles doivent être mémorisées et appliquées sans faille) :
- Refus de l’absolutisation. La justification dépendante de la situation est inadaptée à la recherche de Vérités Absolues. Tout ce qui est déduit de faits primaires dépendants de la situation n’est justifié que dans le cadre de la situation considérée (ou d’une classe de situations).
- Dans la liste des faits primaires, il est permis de ne prendre que ce sans quoi la situation examinée est définitivement impossible. Un fait primaire correct doit résister à l’épreuve de l’« argument du fou ».
- Techniques instrumentales, utiles lors de l’application de justifications dépendant de la situation :
- Extraction de faits. Un fait situationnel primaire ne peut pas être rejeté uniquement sur la base du fait qu’il existe des situations (d’autres situations) dans lesquelles il est certainement faux.
- Recherche de situations. Construction d’une situation dans laquelle une affirmation donnée à l’avance (ou un ensemble d’affirmations) constitue un fait primaire. Cela est utile pour clarifier les limites de la situation examinée et pour rechercher les interdépendances des faits primaires.
- Réalité objectiveelle a cessé d’être unique et indivisible. Avec l’application de justifications dépendant de la situation, il devient normal que des choses qui sont indéniablement réelles dans une situation soient nécessairement absentes dans une autre.
Chapitre 4. Systèmes
Pour faire le prochain pas et aborder le thème « pourquoi l’information ? », il est nécessaire d’apprendre à réfléchir sur des sujets agissant de manière ciblée. Et pour cela, il faut apprendre à réfléchir sur les systèmes. Mais d’abord, examinons un sujet très intéressant : « l’objectivation », qui nous intéresse non pas tant pour elle-même, mais comme moyen d’accéder correctement au concept de « système ».
Objectivation
Il se trouve que nous n’arrivons pas vraiment à discuter de l’Univers dans toute la richesse de ses nombreux aspects. Pour être plus précis, nous n’y parvenons pas du tout. Nous sommes contraints de saisir des morceaux de cette réalité globale et de les examiner séparément. Opérertout de suite touteLa réalité, dans nos intérêts, ne fonctionne pas non plus. Nous devons opérer avec des fragments isolés. Le résultat de cette approche fragmentaire, qui est la seule à notre disposition, est notre illusion extrêmement tenace selon laquelle le monde dans lequel nous vivons est intrinsèquement composé d’objets. En sortant dans la rue, nous voyons des maisons, des arbres, des gens, des animaux, des voitures, des pierres et d’autres objets. Dans le miroir, nous nous voyons et nous considérons également comme un objet parmi ceux qui existent dans le monde. Il nous semble que la division du monde en objets, dont nous avons l’habitude de nous servir, est une propriété innée de la réalité objective. On pourrait se demander, comment cela pourrait-il être autrement ?
Bien sûr, il peut en être autrement. Prenons par exemple une pierre qui se trouve sur le chemin. Nous pouvons la voir, en parler avec un ami, et même, si elle n’est pas trop lourde, la soulever et la jeter hors du chemin. Pourtant, l’isolement de la pierre est en quelque sorte une illusion.

On peut distinguer deux familles de raisons étroitement liées entre elles qui nous poussent à croire que les pierres existent en tant qu’objets distincts :
- Nous nous retrouvons régulièrement dans des situations où nous devons disperser ou ramasser des pierres. Dans les situations où nous devons passer et que cet objet sur la route nous en empêche, il est tout à fait utile de prendre en compte le fait que « les pierres existent ». Ainsi, l’existence des pierres peut être facilement justifiée par un raisonnement dépendant de la situation.
- Nous sommes nous-mêmes des êtres capables de manipuler des morceaux de réalité qui possèdent des échelles et des propriétés non seulement utiles, mais aussi possibles. La pierre est un objet qui est suffisamment stable pour que nous puissions le voir et le comprendre, et assez solide pour ne pas se désagréger entre nos mains. De plus, elle est suffisamment sûre pour que nous puissions la prendre sans risquer de brûler instantanément ou de mourir à cause d’un poison de contact. Il n’est donc pas surprenant qu’il existe probablement dans toutes les cultures humaines un mot spécifique désignant de tels objets.
Il nous semble évident que l’objectivité apparente des morceaux de réalité dans un état solide de la matière, surtout lorsqu’ils peuvent être séparés de leur environnement sans trop d’efforts, est quelque chose de naturel. La situation est beaucoup plus compliquée avec les liquides, les gaz et les champs, pour lesquels il est très conditionnel de dire où un objet commence et où il se termine. C’est encore plus problématique avec l’objectivité des objets immatériels. Par exemple, en ce qui concerne les types de revenus, les catégories d’infractions, les genres de compositions musicales et d’autres choses similaires.
ObjectivationJe vais continuer à appeler le processus dont le résultat est la déclaration d’un certain morceau de réalité comme un objet distinct.
L’objectivation est toujours un processus dépendant du sujet et de la situation. La dépendance au sujet est due au fait que le sujet ne peut réaliser que l’objectivation à laquelle il est adapté, tandis que la dépendance situationnelle est liée au fait que, selon la situation dans laquelle se trouve le sujet, il peut distinguer différents objets à partir d’une même réalité. Mon exemple préféré est un verre d’eau. Si je demande qu’on me rapporte un verre d’eau, j’attends de recevoir un récipient rempli de liquide. Et lorsque je bois le verre d’eau qui m’a été apporté, dans ce cas, le verre d’eau n’est plus que le liquide. Je n’ai ni le désir ni la possibilité de consommer le récipient en verre. En l’espace de quelques secondes, les frontières de l’objet « verre d’eau » ont changé, mais cela ne m’étonne d’aucune manière.
Tout seul.Le monde ne se compose pas d’objets. Les objets dans le monde « apparaissent » seulement lorsque le sujet entre dans le monde et, en fonction de ses tâches et de ses capacités, réalise une objectivation.
Je risque de supposer que l’objectivation est l’une des opérations les plus élémentaires effectuées par le cerveau. Tant que nous n’avons pas identifié un objet, nous ne pouvons formuler aucune affirmation à son sujet, et donc l’objectivation précède toute logique. Tant qu’il n’y a pas d’objet, nous n’avons rien à qualifier de propriétés, et sur la base de ces propriétés, nous ne pouvons pas inclure l’objet (qui n’existe pas encore) dans une classification. Par conséquent, l’objectivation doit précéder toute mathématique fondée sur la théorie des ensembles. L’objectivation ressemble beaucoup à la tâche de reconnaissance de formes, mais ce n’est pas de la reconnaissance de formes, car avant de commencer à reconnaître quoi que ce soit, il est souhaitable d’objectiver ce « quelque chose ». Même pour prendre la décision la plus simple du type « poursuivre »…Ce texte à traduire : ceci.ou se traîner plus loin » il est souhaitable de d’abord objectiver « cela ».
Une question intéressante à part est de savoir si l’objectivation est une condition indispensable de tout processus informationnel. D’une part, bien sûr, elle confère à l’informationobjectivité(L’information devient « opaque »). D’autre part, l’objectivation ne découle en aucun cas de la construction « signal-contexte », et donc rien ne nous empêche de considérer, en termes d’information, par exemple, le processus de régulation simple, pour lequel l’introduction d’« objets » n’est pas nécessaire ou même nuisible.
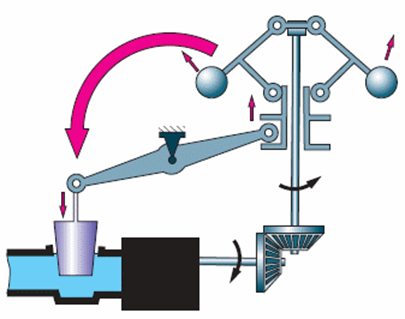
Régulateur centrifuge qui fonctionne, mais qui n’objectivise rien.
Si l’on porte une attention particulière à notre propre interaction avec le monde qui nous entoure, il est facile de constater que nous n’objectivons pas tout. Par exemple, si l’on place une pierre dans la paume de la main et qu’on la maintient en l’air sans la laisser tomber, on peut remarquer que, bien que tous les éléments de cette situation puissent être décrits par des mots (la pierre en tant qu’objet, la main en tant qu’objet, le fait de la maintenir en l’air en tant qu’action objectivée, etc.), il n’est pas nécessaire de le faire. Dans notre vie quotidienne, nous accomplissons de nombreuses actions de manière tout à fait consciente, mais pour les réaliser, l’objectivation n’est pas nécessaire. De plus, tenter de décomposer consciemment ce qui se passe en éléments constitutifs et de « verbaliser » tout cela en nous peut devenir un fardeau superflu qui gâche tout. Peut-être que lorsque nous apprenons à tenir une pierre en l’air, il est utile de prendre conscience de l’angle de la main comme un objet mesurable distinct, mais une fois que nous avons appris à le faire, nos mécanismes internes de régulation déjà entraînés commencent à gérer la tâche sans aucune objectivation.
Le thème de l’«objectivation» nous montre, entre autres, un problème sérieux que nous ne devons en aucun cas négliger. En définissant initialement la philosophie comme la recherche d’un langage adapté à différentes situations, nous nous sommes immédiatement retrouvés dans une situation où l’application de l’objectivation est nécessaire. Nous n’avons aucun moyen de communication verbale qui ne suppose pas une objectivation préalable, et cela entraîne une distorsion significative. Par exemple, si nous réfléchissons au régulateur centrifuge montré sur l’image ci-dessus, nous devrons d’abord décomposer ce système en ses différentes parties, puis décrire comment elles interagissent. Même si nous faisons abstraction des détails de mise en œuvre, nous serons tout de même contraints de réfléchir à la manière dont la vitesse de rotation de l’arbre de la machine à vapeur est stabilisée par un retour d’information via le mécanisme de régulation de l’alimentation en vapeur. Dans ce contexte, «vitesse de rotation», «retour d’information» et «régulation de l’alimentation en vapeur» sont des objets, bien que abstraits, qui peuvent être décrits quantitativement, même s’ils sont des «informations».extérieurEn ce qui concerne le système du point de vue humain, nous avons un ensemble d’objets, mais si nous essayons de regarder ce qui se passe…de l’intérieurDans les situations de régulation de l’alimentation en vapeur, nous pourrons constater qu’il n’y a aucun objet à l’intérieur de cette petite combinaison spatiale d’information. Ou peut-être qu’il y en a, si le contrôle de la vanne est réalisé à l’aide d’un microcontrôleur, dont le programme est écrit dans un langage de programmation orienté objet.
En réfléchissant à différentes choses, essayons de ne pas oublier que, en plus de la position de l’être pensant, raisonnant et, par conséquent, objectivant dans laquelle nous nous trouvons par nécessité, il peut exister parfois un point de vue beaucoup plus adéquat qui mérite d’être pris en compte.de l’intérieur, et il se peut qu’il n’y ait déjà plus d’objets. L’exemple donné dans le paragraphe précédent avec le programme de gestion, écrit dans un langage de programmation orienté objet, illustre le piège idéologique dans lequel on tombe à cause d’une incompréhension des différences de positions.«de l’extérieur»и.«de l’intérieur»Les technologies de l’information que nous avons actuellement sont touchées. On continue de penser que les systèmes d’information seront efficaces s’ils sont aussi précis que possible.réfléchirce qui se passe dans le monde réel. Puisque nous ne connaissons pas d’autre monde réel que celui que nous percevons sous forme d’objets, il nous semble logique que l’ordinateur opère avec les mêmes concepts que nous. Ainsi, nous effectuons nous-mêmes l’objectivation et présentons son résultat à l’ordinateur sous une forme prête à l’emploi. Après cela, tout système développé en utilisant des technologies orientées objet se retrouve être l’incarnation de la situation spécifique dans laquelle se trouvait le concepteur au moment de l’élaboration du modèle objet. Lorsque la situation change (non pas « si », mais bien « quand », car la situation change constamment), cette montagne de code qui a été développée pour un modèle devenu inadapté est soit jetée à la poubelle, soit se transforme en une source de problèmes, constamment réparée, et source de maux de tête. En conséquence, nous observons avec étonnement comment les progrès impressionnants du matériel compensent largement la lourdeur et la lenteur croissantes des logiciels. Les mêmes tâches qui ralentissaient autrefois sur un Pentium-100 ralentissent maintenant de la même manière sur un Core i7, et il n’est pas toujours possible d’expliquer cela par une augmentation de la richesse fonctionnelle des logiciels, car dans de nombreux cas, la fonctionnalité est restée sans changements visibles. Il est très difficile d’expliquer pourquoi il n’est pas du tout nécessaire d’essayer de tirer…à l’intérieursystèmes dans leur état primitif la logique que nous prévoyons ensuite d’observerde l’extérieur...
De plus, en intégrant dans l’ordinateur une objectivation que nous avons déjà réalisée nous-mêmes, nous lui retirons la moindre chance d’effectuer cette opération de base par lui-même. Après cela, nous ne devrions pas nous plaindre du fait qu’aucune…compréhensionL’ordinateur n’est en principe pas capable de nous démontrer cela. En suivant les approches traditionnelles de construction des systèmes d’information, nous sommes condamnés à expliquer en détail à l’ordinateur,quoi et commentIl devrait le faire. Une certaine approche initiale vers des technologies qualitativement nouvelles, permettant de programmer des objectifs plutôt que des séquences d’actions, peut être considérée comme le sujet en plein essor du « deep learning ». C’est précisément là, dans les couches internes des réseaux de neurones artificiels, qu’il se passe quelque chose que l’on peut déjà qualifier de propre objectivation.
Systématicité
Lorsque nous parlons de systèmes, nous mettons généralement l’accent sur les points suivants :
- Les systèmes sont des objets composés, c’est-à-dire qu’ils se composent d’objets dont ils peuvent être décomposés.
- À l’intérieur du système, les éléments interagissent. Cela signifie qu’on peut parler non seulement des parties constitutives, mais aussi des relations entre elles.
- Le système dans son ensemble possède au moins une propriété qui est absente de ses éléments (un phénomène connu sous différents noms tels que « propriété intégrative », « synergie », « holisme », « émergence », « effet systémique »).
Nous allons aborder cette liste de bas en haut, car ce qui est fascinant, c’est l’effet systémique qu’elle engendre. Mon exemple préféré pour illustrer ce phénomène est la hache. Une hache de menuisier ordinaire, qui, comme on le sait, se compose d’une partie en fer tranchante (qui s’appelle aussi « hache »), d’un manche en bois et d’un coin qui sert à fixer la partie en fer au manche. Dans l’ensemble, la hache a la propriété d’être « pratique pour couper du bois ». Si l’on examine les parties constitutives, il est vrai que l’on peut essayer de couper du bois avec la partie en fer, mais c’est extrêmement peu pratique. Horriblement peu pratique. N’essayez même pas. Avec le manche en bois, il est tout simplement impossible de couper du bois. Quant au coin, il vaut mieux ne même pas en parler. Mais lorsque toutes les parties sont assemblées correctement, l’outil résultant est très pratique pour couper du bois. Où se trouve la propriété « pratique pour couper du bois » lorsque la hache est démontée ? Il semble qu’elle n’existe nulle part. Elle est tout simplement absente. Où disparaît-elle si l’on démonte la hache ? Il semble que ce soit dans le néant. On pourrait bien sûr essayer de relier cette situation à la loi de conservation (« rien ne naît de nulle part et ne disparaît dans le néant »), mais le résultat serait désastreux. Il faudrait supposer qu’il existe quelque part dans le monde un endroit obscur où, lors de la fabrication de la hache, l’une des « âmes » de hache qui s’y languissent s’incarne dans l’objet presque fini (et puis, après le démontage de la hache, elle y retourne). Cela devient une telle ésotérisme sauvage que même les mystiques les plus audacieux auraient honte de l’énoncer. Et tout cela alors que nous savons exactement comment une hache est conçue et fonctionne. Elle fonctionne très simplement, et pour comprendre pleinement ce qui se passe, nous n’avons pas besoin d’invoquer des entités superflues. La seule entité dont nous devons néanmoins nous souvenir est le sujet qui, en fin de compte, sera celui qui trouvera pratique de couper du bois. Tant que le sujet est contraint d’objectiver les parties constitutives séparément, il ne peut pas obtenir la propriété intégrative utile sur un ensemble de pièces désintégré, mais une fois que l’objet est assemblé, il s’objectivise déjà avec l’effet systémique « émergé » dans l’objet objectivé.
On peut jouer avec l’idée que le fonctionnement de notre pensée (conscience, esprit, âme, etc.) peut également être considéré comme un effet systémique résultant de l’ensemble des parties constitutives de notre cerveau. Si c’est le cas, alors les réflexions sur une âme séparée du corps n’ont pas plus de sens que celles sur l’incarnation d’un confort existant pour couper du bois dans une hache fabriquée. De plus, il devient clair pourquoi le grand mystère de la pensée ne nous est pas révélé par la faiblesse des microscopes que nous utilisons pour étudier la structure des cellules nerveuses, mais par le fait que nous n’avons pas encore suffisamment appris à réfléchir sur les effets systémiques. Si la conscience est un macro-effet, alors, en descendant au niveau micro, nous excluons inévitablement le macro-effet de notre analyse.
Certains philosophes aiment parler de la transformation de la quantité en qualité au lieu de l’effet systémique. Il me semble qu’il y a là une certaine ambiguïté. L’effet systémique n’implique pas nécessairement une transformation de la quantité, ni même une transformation en qualité. Par exemple, si nous prenons mille morceaux de fer en forme de hache, nous ne parviendrons pas à en faire un outil pratique pour couper du bois. Il semble que, pour qu’une qualité émerge, il faille parfois autre chose que de la quantité. De plus, le point final de cette transformation n’est pas nécessairement la qualité. Du point de vue du bûcheron, assembler une hache donne une qualité, tandis que du point de vue du comptable qui tient les comptes d’une usine fabriquant des haches, assembler une hache ne représente qu’un +1 au débit du compte « Produits finis ».
Examinons le point suivant (nous avançons dans la liste de bas en haut) sur lequel on attire généralement l’attention lors de l’étude des systèmes, à savoir que les éléments d’un système interagissent entre eux. On peut citer de nombreux exemples de systèmes dont les parties n’interagissent pas entre elles. Par exemple, un mot est composé de lettres et possède une propriété émergente (le sens du mot) qui n’est pas simplement la somme des significations des lettres. Dans ce cas, il n’est pas vraiment pertinent de dire que les lettres d’un mot interagissent d’une manière ou d’une autre. On pourrait bien sûr objecter que nous observons des systèmes dont les éléments n’interagissent pas depuis une position « externe ». Et si le système est objectivé et observé depuis une position « externe », on peut toujours dire que…en faitelle n’est pas un système et représente une illusion formée chez le sujet. Il y a deux contre-arguments à cela :
- Si l’existence d’un système dans une situation donnée est un fait primaire (justification dépendante de la situation), de quoi s’agit-il ?«en fait»De quoi peut-on parler ?
- Observer un système non lié par des interactions peut se faire non seulement de l’extérieur, mais aussi de l’intérieur, en étant partie intégrante de celui-ci. Par exemple, un agent de sécurité peut percevoir le système de sécurité comme un tout, même si l’absence d’interaction entre ses différents éléments lui semble évidente. En effet, l’interaction n’est possible qu’entre des objets de même nature. Les éléments du système de sécurité peuvent être des grilles installées aux fenêtres (objets matériels) et le règlement concernant le remplacement des serrures de porte adopté par l’organisation (objet informationnel). L’interaction entre ces objets est manifestement impossible.
Le concept de « système » s’est développé à une époque où l’on désignait par ce terme des objets matériels assemblés. En parlant d’un objet matériel constitué en un tout, il est en effet difficile de ne pas reconnaître que les parties doivent être physiquement reliées entre elles. Mais lorsqu’il s’agit d’un système immatériel (comme le langage naturel en tant que système de signes, la législation en tant que système de régulation des relations sociales, le système monétaire en tant que fondement des relations de marché, etc.), il est tout à fait possible de se passer de l’exigence d’interaction entre les parties. Si l’analyse des liens entre les éléments d’un système aide à comprendre ce qui se passe, elle peut être recommandée, mais si elle complique les choses, il n’est pas nécessaire de s’inquiéter de violer l’un des postulats centraux hérités des grands cybernéticiens du passé concernant l’« approche systémique ». Après tout, il existe dans le monde de nombreux objets interagissant qui ne forment pas des systèmes simplement parce qu’il n’y a pas de situations où leur objectivation en tant qu’unité pourrait nous être utile. Ne nous inquiétons plus jamais si nous découvrons que les éléments de l’un des systèmes que nous examinons n’interagissent pas entre eux. Cela n’entrave souvent en rien l’émergence d’effets systémiques.
Le dernier point essentiel (si l’on considère de bas en haut) est que les systèmes sont des entités composites. Dans ce contexte, il est pertinent de prouver deux affirmations :
Affirmation 1 :Si nous avons constaté l’apparition d’un effet systémique dans l’objet, alors l’objet en question est composite.C’est simplement par définition l’effet systémique comme une propriété qui appartient à un tout, mais qui est absente dans les parties constitutives. Si un objet est indivisible, il est impossible de parler d’effets systémiques.
Affirmation 2 :Si nous avons constaté que l’objet est composite, alors un effet systémique doit être observé sur cet objet.Cela découle du fait que si nous nous trouvons dans une telle situation où nous ressentons le besoin d’objectiver un ensemble de composants comme un tout, ce besoin ne peut être formulé que dans des termes désignant l’effet systémique qui émerge de ce tout en formation.
Ainsi, la décomposabilité des systèmes et l’apparition de l’effet systémique constituent une paire de propriétés qui sont mutuellement nécessaires et suffisantes l’une pour l’autre. Par conséquent, elles représentent différentes formulations désignant le même phénomène. Pour plus de clarté, appelons-lesystématicitéТекст для перевода: ..
Ce qui est intéressant, c’est que les affirmations 1 et 2 restent valables non seulement lors de l’objectivation du système du point de vue « extérieur », mais aussi lors de l’objectivation du point de vue « intérieur ».
Parfois, en parlant des systèmes, on met en avant un élément essentiel.hiérarchisationC’est-à-dire que si quelque chose est composé de parties, ces parties peuvent également être décomposées et donc considérées non pas comme des objets, mais comme des sous-systèmes, qui à leur tour se composent de sous-sous-systèmes, et ainsi de suite. Cela semble logique, mais il est utile de se rappeler que le mécanisme d’objectivation, à travers lequel nous avons à la fois le système lui-même et ses parties constitutives, est dépendant de la situation. Cela signifie que lorsque nous commençons à décomposer les sous-systèmes en sous-sous-systèmes, nous avons déjà quitté la situation de l’objectivation initiale du système et de sa décomposition initiale, et nous nous sommes maintenant retrouvés prisonniers du choix que nous avons fait à ce moment-là. Le critère de décomposition appliqué à la première étape ne peut pas être appliqué à la deuxième, car il s’est déjà complètement épuisé. À la deuxième étape, il faut appliquer un autre critère, et au final, la décomposition hiérarchique à deux niveaux se révèle inévitablement être le résultat d’un mélange de deux principes hétérogènes, alourdi par le fait que le deuxième critère est arbitrairement placé sous la « subordination » du premier. Fort de mon expérience vaste et variée dans le travail pratique avec des constructions hiérarchiques, je peux dire que je n’ai jamais rencontré une hiérarchie exempte de contradictions logiques et des désagréments sérieux qui en découlent.
L’hierarchie est une propriété illusoire des systèmes, apparaissant dans environ cent pour cent des cas en raison d’erreurs logiques, et promettant à peu près autant de désagréments. L’apparition de l’hierarchie dans toute réflexion sur les systèmes est une bonne raison de commencer par chercher l’erreur. Même avec la ramification des arbres, tout n’est pas si simple qu’il y paraît. Ceux qui affirment que les arbres sont certainement ramifiés n’ont tout simplement jamais vu leurs racines.
Pas de systèmes
Il peut se former une impression erronée selon laquelle on pourrait considérer tout dans le monde comme un système, puisque la décomposabilité de n’importe quelle chose n’est qu’une question de disponibilité de l’outil de découpe approprié. Si c’était le cas, la propriété « est un système » serait applicable à tout et n’importe quoi, et ainsi elle serait complètement vidée de son sens. Les poètes peuvent se permettre d’énoncer des affirmations universelles du type « tout est vanité et tourment de l’esprit », mais en raisonnant de manière saine, nous devons comprendre qu’il ne nous est permis d’utiliser le terme « vanité » que si nous parvenons à trouver quelque chose qui ne soit pas de la vanité, et alors seulement, avec tout le droit qui en découle, nous pourrons examiner la vanité de la vanité en contraste avec la non-vanité de ce qui n’est pas vanité. Il en va de même pour la systématicité des systèmes. Pour examiner correctement la systématicité, nous devons, comme de l’air, trouver des objets qui ne sont pas des systèmes.
Dans le monde matériel, il est inutile de chercher de tels objets. Dans le monde matériel, tout se divise en parties, et la question, comme mentionné précédemment, ne dépend que de la présence de la scie appropriée. Même ce qui ne peut pas être physiquement divisé peut être divisé logiquement. Les objets véritablement indivisibles (atomiques) sont ceux qui ont une taille nulle. Autrement dit, ce sont des points. Rien ne peut être contenu à l’intérieur d’un point, donc un point ne peut pas être divisé. Et puisque l’on ne peut pas le diviser ni physiquement ni même logiquement, il ne peut être question d’effets systémiques (propriétés présentes dans un point entier, mais absentes chez… quoi ?) Voici des exemples de points :
- Un point géométrique dans l’espace. Par exemple, le sommet A du triangle ABC. Ou le centre d’un cercle. Ou le point d’intersection de deux droites. Ce qui est intéressant, c’est qu’un point, malgré sa taille nulle, peut posséder des propriétés. Par exemple, la propriété d’être équidistant de tous les points du cercle.
- Nombre. C’est aussi un point, mais pas dans l’espace géométrique, plutôt sur une échelle numérique. Par exemple, le nombre pi. On pourrait objecter que le nombre pi est une chose infiniment complexe, ayant en lui un infini de décimales après la virgule. Mais non, cette complexité n’apparaît que lorsqu’on essaie de l’écrire dans le système décimal. Dans le système pi, le nombre pi s’écrit très simplement : « 10 ». Oui, les systèmes de numération n’ont pas besoin d’avoir une base entière. Encore une fois, les nombres ont des propriétés, même s’ils sont des points de taille nulle.
- En général, n’importe quelle.identitéa une propriété ponctuelle d’indivisibilité. Dès que nous objectivons quelque chose (peu importe quoi), nous pouvons vouloir inclure cet objet dans des raisonnements utilisant les opérateurs « le même » et « semblable ». L’application de l’opérateur « le même » opère sur l’identité de l’objet, tandis que « semblable » opère sur les propriétés. « Voici tante Macha,la même«Macha, sur laquelle tu as attiré l’attention dans l’album scolaire» – un exemple de manipulation de l’identité de Macha. «Notre nouveau concierge».le même«Alcoolique, comme le précédent» – exemple d’opération sur les propriétés.
Les exemples avec des points géométriques et des nombres n’étaient nécessaires que pour montrer que la recherche d’éléments atomiques n’est pas une tâche aussi désespérée qu’il pourrait sembler au premier abord. Ce qui suscite vraiment l’intérêt, ce sont bien sûr les identités. Arrêtons-nous plus en détail sur ce sujet.
Il y a des situations qui nécessitent de manipuler des identités. « Appelez au téléphone. »того.«votre employé qui est venu chez nous hier», «apporte»тот.feuille sur laquelle j’écrivais», «il est originaire dede même«les villes, tout comme moi», «déduis les dépenses sur»ту же.l’article dont je me suis inspiré le mois dernier ». Remplacer dans ces déclarations l’opérateur « le même » par « semblable » déforme complètement le sens. Il existe des situations où l’identité n’est pas importante, mais où les propriétés le sont. Dans la phrase « qu’il vienne chez nous demain »tel quelUn employé compétent, tel qu’il était la semaine dernière, peut remplacer «tel» par «le même», mais cela constituerait une restriction inutile, limitant les possibilités. Il existe des situations où l’opération sur l’identité est impossible. Dans la phrase «achète…les mêmes«Des tomates, comme hier» ne peut pas être remplacé par «ces mêmes». «Ces tomates» ont déjà été achetées et mangées, et il n’est pas possible de les racheter.
Lors de l’examen de tout système pendant la période de notre attention à celui-ci, nous fixons nécessairement son identité. Si à chaque instant suivant, nous considérons que ce qui est devant nous n’est pas…le mêmeL’objet qui était là un instant auparavant nous laisse seulement la possibilité de contempler, avec étonnement, un kaléidoscope d’images sans lien entre elles. Même si l’objet est changeant (par exemple, un jet d’eau, où l’eau elle-même se renouvelle chaque seconde), cela ne nous empêche pas de le stabiliser par son identité, ce qui nous permet de réfléchir à cet objet. Par exemple, on peut dire d’un jet d’eau qu’il est trop fort et qu’il faudrait le réduire un peu. Dans cette situation, nous ne sommes pas du tout dérangés par le fait que les molécules d’eau changent constamment. L’objet « jet d’eau » se révèle être un objet avec lequel on peut interagir et que l’on peut contrôler à l’aide d’un robinet. L’identité « ce jet d’eau » que nous attribuons à un morceau objectivé de la réalité est en soi un point logique, un objet de taille nulle. Le jet d’eau est un système en constante évolution, tandis que le point logique qui lui est attribué, « ce jet d’eau spécifique », est une non-système stable.
Il n’y a aucune mystique dans le concept d’identité. La mystique apparaît dès que nous essayons de réifier l’identité. Où existe un jet d’eau ? Ici, il sort du robinet et va dans l’évier. Où existe l’identité « ce jet d’eau », qui possède les propriétés d’un point de taille nulle ? Euh… Au centre de la section de sortie du tuyau ? Ou bien plaçons-la au centre de masse du jet ? Dans les deux cas, c’est un volontarisme totalement superflu. Peut-être que le point logique serait mieux placé dans la tête de l’observateur ? Peut-être, mais dans quelle tête devrions-nous le placer, si deux personnes regardent le jet ? En somme, le point logique est logique précisément parce qu’il n’a pas besoin d’être placé quelque part dans l’espace. Nous parvenons très bien à opérer avec des points logiques sans avoir à les situer dans l’espace physique.
Opérer avec des points logiques signifie les utiliser pour construire des énoncés. Nous savons que la Volga se jette dans la mer Caspienne. Pour le dire, nous avons pris le point logique « rivière Volga » (la Volga elle-même n’est bien sûr pas un point, mais un immense système, mais l’identité « rivière Volga » est un point) et l’avons relié au point logique « mer Caspienne » par le lien logique (prédicatif) « se jette ».
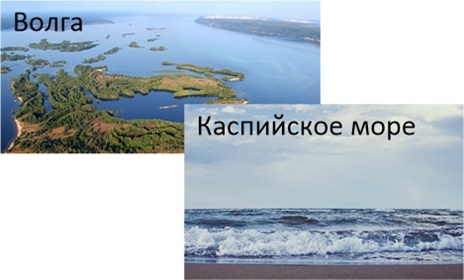
Systèmes : Volga et mer Caspienne

Points logiques : la Volga et la mer Caspienne
Nous ne pouvons pas utiliser les objets eux-mêmes dans nos énoncés. Seulement leurs désignations. Des points logiques. Des identités.
Les identités n’ont aucune incarnation physique concrète. Toute incarnation physique implique une taille non nulle et, par conséquent, un contenu interne. Un point logique n’a pas de taille. C’est précisément ce qui lui confère sa valeur. Toute attribution de propriétés à un objet ainsi fixé s’effectue par des relations prédicatives.
Lorsque nous classifions un objet ou un phénomène, nous construisons ainsi un lien qui relie l’identité de l’objet à un ensemble. Cette pomme est délicieuse, elle appartient à l’ensemble des choses délicieuses. Angelina Jolie est belle, elle fait partie de l’ensemble des êtres beaux. Socrate est un homme (tout comme Angelina Jolie), il appartient à l’ensemble « les humains ». Il n’y a aucune raison de penser que la nature de l’ensemble, au moment où cet ensemble est utilisé dans une relation prédicative, diffère de la nature de l’objet de l’autre côté de la relation. Ainsi, chaque ensemble n’est pas seulement quelque chose de grand et complexe, mais aussi un point logique auquel se rattachent les extrémités des relations. Un exemple de relation, à son tour, est une entité composite (un point à une extrémité, un point à l’autre extrémité, le sens de la relation), mais dès que nous voulons caractériser cet exemple par une certaine caractéristique (par exemple, « c’est vrai » ou « c’est faux »), nous le faisons à nouveau par le biais d’une relation prédicative, dont un bout est l’exemple de la relation prédicative existante, et l’autre bout est la valeur de la caractéristique. Les valeurs les plus intéressantes et souvent utilisées à cet égard sont « vérité » et « fausse ». Celles-ci, de manière naturelle, dans ce contexte, sont des points logiques. Des identités. « Qu’est-ce que la vérité ? » s’interrogent les philosophes. Je ne sais pas ce qu’est la vérité, mais je sais ce qu’est « la vérité ». C’est un point logique auquel se rattachent les relations prédicatives qui caractérisent la véracité des affirmations.
Il peut sembler que les identités, en raison de leur vide intérieur, sont des choses complètement inutiles dans la gestion. Après tout, ce qui nous intéresse, c’est la rivière Volga elle-même, et non un point logique abstrait et intérieurement vide comme « rivière Volga ». Mais il y a un sens à savoir manier le concept d’identité, ne serait-ce que parce qu’à partir du moment où nous essayons d’affirmer quoi que ce soit sur la rivière Volga, nous commençons déjà à utiliser cet étrange objet ponctuel. Le simple fait que les identités soient largement utilisées dans des relations prédicatives permet, par une justification situationnelle, d’affirmer que les identités existent. Bien sûr, pas en tant qu’objets matériels (ce serait une réification), mais en tant qu’objets immatériels.
Il existe un certain nombre de phénomènes sur lesquels il est difficile de réfléchir de manière adéquate sans recourir au concept d’« identité ». Par exemple, l’amour. Le véritable amour, qui traverse les années, les circonstances et la variabilité des caractéristiques de l’objet aimé, est une intention axée sur l’identité, et non sur un ensemble de propriétés. L’intention sur un ensemble de propriétés n’est qu’une combinaison éphémère de préférences consuméristes, et un tel désir ne peut certainement pas être qualifié d’amour. Quelle que soit la forme d’amour que nous prenons – l’amour d’un homme pour une femme, d’une femme pour un homme, d’un parent pour un enfant, d’un enfant pour un parent, pour sa famille, pour sa ville, pour son peuple, pour son pays, pour son travail, ou même l’amour d’un chien pour son maître – dans tous les cas, l’objet de cet amour doit d’abord être considéré comme ce point logique qui, bien que semblant vide et inutile, est fondamental. Sinon, les faits directement et fidèlement observés ne s’assemblent pas en un système et se présentent à nous comme une sorte de fantasmagorie absurde. On pourrait objecter à l’acceptation de l’identité comme objet d’amour en disant qu’une mère aimant son enfant, et encore plus un chien aimant son maître, ne se préoccupe pas de concepts abstraits comme des points logiques de taille nulle ou de l’applicabilité du calcul des prédicats. Bien sûr, c’est vrai. Mais cela n’a pas d’importance. Les planètes n’ont également aucune idée des masses ou des carrés des distances, mais cela n’empêche pas la mécanique newtonienne de fournir une description précise et adéquate de leur mouvement.
Un intérêt particulier pour nous réside dans notre propre identité, que nous désignons comme notre propre « moi ». Peut-on considérer ce « moi » comme une auto-identité inhérente à chacun de nous ? Je ne vois aucun obstacle à cela. Si nous devons parler du « moi » comme d’un point logique, alors une série de conséquences plutôt amusantes en découle, parmi lesquelles les plus curieuses me semblent l’immortalité de ce « moi » et la résolution du problème de la conscience de soi. Si l’on considère le « moi » comme un point logique, ce point ne cesse pas d’exister avec la destruction de l’organisme. Les liaisons prédicatives changent de manière significative (elles sont complétées par le prédicat « est mort », tandis qu’un certain nombre de prédicats, par exemple « peut être invité à prendre le thé », tombent en désuétude), mais le point logique lui-même reste intact. Le point logique est indestructible.
En ce qui concerne la conscience de soi, si nous considérons le « moi » comme une identité, rien ne nous empêche de penser que la conscience de soi est la capacité d’un sujet à manipuler le concept de sa propre identité. Cela élimine immédiatement toute la mystique pompeuse qui entoure le problème de la conscience de soi et oriente les réflexions vers un cadre strictement constructif. Existe-t-il, en plus de l’homme, d’autres êtres capables de manipuler le concept de leur propre identité ? Il est évident que oui, car la compréhension du type « ceci est moi, et cela n’est pas moi » est utile aux organismes dans de nombreuses situations différentes, y compris dans des choses aussi banales que la prise de nourriture. Existe-t-il des êtres qui ne possèdent pas de conscience de soi ? Il est difficile de le dire, mais si, dans le fonctionnement d’un système quelconque, la manipulation de sa propre identité n’est d’aucune utilité, il est tout à fait possible qu’il n’ait pas non plus de mécanismes pour cela.
Exemples de systèmes techniques opérant et non opérant sur le concept d’identité propre :
- L’adaptateur Wi-Fi connaît son adresse MAC et, en écoutant le réseau, n’accepte que les paquets destinés à cette adresse. Il s’agit d’une manipulation non négligeable de sa propre identité.
- Calculatrice de bureau. Pour effectuer des calculs, il n’est pas du tout nécessaire qu’elle opère avec sa propre identité. Si l’identité de la calculatrice est néanmoins requise (par exemple, pour le suivi des biens de faible valeur), le comptable collera un numéro d’inventaire. Ce petit papier, bien qu’il ajoute une identité à cet objet, ne sera pas « reconnu » par les mécanismes internes de la calculatrice. L’identité externe apparaîtra, mais l’opération avec sa propre identité ne le sera pas.
Il est vraiment dommage, bien sûr, de réduire une chose aussi sacrée que notre précieuse conscience de soi à ce qui, dans le cas le plus simple, se réalise par deux lignes de code (j’ai moi-même fait cela à plusieurs reprises), mais c’est encore pire lorsque la solution simple et utile à la question se noie dans un marécage verbal de constructions mystiques.
Frontières
Ainsi, nous avons une image plutôt intéressante qui se dessine. À la sortie du processus d’objectivation, nous avons des systèmes (par exemple, la rivière Volga), qui sont immédiatement dotés d’identités (respectivement, « rivière Volga »). Nous avons donc deux en un. À la base se trouve un point logique, mais toute l’opération autour de ce point consiste en des manipulations avec des liaisons prédicatives qui lui sont attachées. Ainsi que des prédicats liés aux parties correspondantes des prédicats initiaux. Et encore des prédicats caractérisant les liaisons. La forêt des liaisons grandit, et si l’on ne s’arrête pas à temps, elle engloutira le monde entier, car dès le deuxième pas, nous atteignons le point logique « vérité », d’où, à travers la question « qu’est-ce que la vérité ? », nous risquons de nous égarer complètement. Que dire, même au premier pas, à travers la question « pourquoi ai-je besoin de cet objet ? », nous accédons à notre « moi » infini et englobant.
Si nous étendons logiquement chaque objet à l’ensemble du monde, cela mène bien sûr à une impasse. Nous devons nous arrêter quelque part. Mais où ? Dans le cas le plus minimal, nous avons l’identité elle-même, mais l’identité n’est pas un système. Un système n’apparaît que lorsque quelque chose d’autre est attaché à un point. Peut-on considérer qu’un système est seulement un ensemble de prédicats directement attachés à l’identité en question ? Ce n’est pas très satisfaisant non plus. Pourquoi seulement eux ? Pourquoi ne pas considérer la chaîne « A-B-C » comme un lien « A-C » ? En somme, trouver une frontière claire et unique pour tout système s’avère être une tâche qui, dès le départ, n’a pas de solution. Heureusement, généralement, à la fin du processus d’objectivation, nous obtenons non seulement une identité, mais aussi de nombreux indices sur la manière dont nous devrions tracer la frontière dans cette situation particulière. Il est temps de rappeler que l’objectivation fonctionne toujours comme un processus dépendant du sujet et de la situation, et si nous avons tracé la frontière de manière claire et correcte maintenant, cela ne signifie pas qu’elle restera tout aussi juste dans une minute, dans une situation légèrement modifiée.
Considérons un système tel que le chat Murka. Tout d’abord, il possède un corps pelucheux qui occupe une place dans l’espace physique. Si nous voulons simplement le caresser et qu’il ne s’enfuit pas, cela peut suffire. Voici le chat, nous nous approchons et nous le caressons. Si nous voulons le nourrir, il faut d’abord prendre en compte non pas le corps (qui peut se promener quelque part, et peu importe où précisément), mais les informations sur quel type de nourriture convient aux chats. Si nous avons le désir de l’accueillir, nous devons d’abord nous demander si le prédicat « sans propriétaire » appliqué à ce chat est vrai. Et bien sûr, il y a encore une multitude d’autres prédicats décrivant le caractère, l’état de santé (vers !!!), l’éducation à la propreté, une éventuelle grossesse (voulez-vous tout de suite le problème des chatons ?) et ainsi de suite. Accueillir un chat chez soi, ce n’est pas simplement transporter quelques kilos de poids vivant à travers le seuil. C’est entrer en symbiose, et peut-être pas seulement avec le chat, mais aussi avec la toxoplasmose. Se limiter à la présence d’un corps physique serait une légèreté impardonnable.
Si jamais vous voyez dans des nouvelles de vulgarisation scientifique un titre comme « Des scientifiques ont créé un modèle de chat », n’hésitez pas à vous renseigner sur la prise en compte dans ce modèle des relations avec les humains, les souris, les chiens, le symbiose avec la microflore, le développement de l’industrie des aliments pour chats, les progrès de la médecine vétérinaire, ainsi que, pour éviter les surprises, les particularités de la réglementation législative concernant la possession d’animaux domestiques dans certains pays. Car, vous savez, sans tenir compte de tout cela, tout modèle de chat serait fondamentalement incomplet. Si un jour dans ces mêmes nouvelles vous lisez que « dans 50 ans, il sera possible de créer un modèle du cerveau humain », il vous suffira de rire. Le cerveau, détaché de son environnement – c’est-à-dire de son habitat – n’a aucun sens. Et l’habitat du cerveau, c’est le monde entier, sans exception, tel que nous le connaissons, y compris les cerveaux des expérimentateurs malchanceux.
Maintenant, je vais considérer comme système moi-même. Comme base, bien sûr, nous prendrons notre identité, c’est-à-dire le point logique désigné par le mot « je ». J’ai un corps physique. Une question intéressante se pose immédiatement : qu’est-ce que je devrais considérer comme le corps physique de mon « je » ? Dans certains cas, on peut se limiter au cerveau, ou même au cortex de ses hémisphères, car c’est là, semble-t-il, que se trouve l’appareil qui réalise ma pensée. C’est joli – des signaux par les nerfs à l’entrée, des signaux par les nerfs à la sortie, mais il manque quelque chose. Par exemple, si je dis « j’étais assis dans un fauteuil, puis je suis passé au canapé », cela n’a pas de sens, car je suis resté assis dans cette boîte osseuse chaude, sombre et solide. Dans la situation du fauteuil et du canapé, il faudrait élargir ma définition pour inclure mon corps. Je sors de la maison, je marche dans la rue. Un camion qui passe éclabousse mes pantalons et mon manteau de boue provenant d’une flaque. Maintenant, je suis sale. Ou pas moi, mais seulement mes vêtements ? Non, c’est quand même moi. Je veux avoir l’air présentable, donc je dois me nettoyer. Sans m’en rendre compte, j’ai inclus mes vêtements dans les limites de mon « je ». Après m’être nettoyé, je monte dans une voiture, je conduis, je me gare mal. J’ai abîmé mon pare-chocs. Attendez, mais je n’ai pas de partie du corps qui s’appelle pare-chocs. Néanmoins, c’est moi qui l’ai abîmé. Il s’avère que lorsque je conduis, j’inclus la voiture dans le système que je désigne par « je ». Pourquoi pas ? Et si, en enfonçant un clou, je manque le clou et me frappe le doigt, on ne pourra pas dire que c’est le marteau, ce vilain, qui m’a frappé le doigt. C’est moi qui me suis frappé le doigt. Oui, le contact physique du doigt était avec le marteau, mais à ce moment-là, le marteau était une extension de ma main et, par conséquent, faisait partie du système désigné par l’identité « je ».
Comme prévu, la frontière de mon « moi » est dépendante de la situation. Voyons jusqu’où elle peut s’étendre. En principe, à l’intérieur de mon système de « moi », nous incluons tout ce que nous désignons par le mot « mon » en fonction de la situation. Mon corps, mes vêtements, ma maison, ma famille, mes amis, mes ennemis (oui, c’est ça), ma ville, mon pays, ma planète. Mon monde. Mes conceptions du bien et du mal. Quand j’ai mal, c’est ma douleur, et si j’ai faim, c’est ma faim. Je suis conscient de certains de mes défauts, et ce sont mes défauts, et c’est ma conception de ce qu’il vaudrait mieux qu’ils n’existent pas qui me pousse à m’en préoccuper. Mes idées sur la nocivité de mes défauts, bien sûr, font également partie de moi. Il semble donc qu’il n’y ait pas de limites à l’expansion de mon « moi ». Dans différentes situations, je trace bien sûr la frontière « ici c’est moi, et là-bas ce n’est déjà plus moi », mais il est parfois utile de se rappeler que parler de moi et du monde dans lequel je vis, c’est en principe parler de la même chose. Et il ne s’agit bien sûr pas seulement de moi. Vous, lecteur, et le monde dans lequel vous vivez, c’est aussi le même sujet. D’ailleurs, ce n’est pas une nouveauté. L’unité essentielle du sujet et du monde dans lequel il vit est un point clé d’une philosophie très ancienne, désignée sous le nom de « zen ». Nous avons simplement atteint cette vérité ancienne d’une manière étrange, non pas par la méditation dans un monastère en haute montagne, mais par des réflexions sur l’objectivation, les systèmes, les identités et la dépendance situationnelle des frontières.
Bilan du chapitre
Les principales notions et concepts abordés dans ce chapitre :
- Objectivation– processus dont le résultat est la déclaration d’un certain morceau de réalité comme un objet distinct. L’opération d’objectivation précède (est implicitement considérée comme l’opération « zéro ») toute logique.
- L’objectivation est toujours un processus dépendant du sujet et de la situation.Il ne peut exister aucune division unique et correcte de la réalité entière en objets distincts.
- Système– n’importe quoi (un morceau objectivé de la réalité), possédant la propriété de systématicité.
- Systématicité– fusionnés par une continuité logique («deux en un»), deux propriétés : la décomposabilité et la présence de propriétés émergentes. Si l’objet considéré peut être décomposé, il possède au moins une propriété émergente. Inversement, si une propriété peut être définie comme émergente, l’objet peut être décomposé en parties constitutives qui ne possèdent pas cette propriété.
- Hiérarchicité– une propriété illusoire des systèmes. Notre habitude de construire des hiérarchies est le résultat d’un défaut de perception.
- L’objectivation, en plus de la mise en évidence du système par rapport à la réalité qui l’entoure, a pour résultat l’identité.Identité– point logique. Entité immatérielle intérieurement vide (de taille nulle) utilisée pour désigner un objet.
- Conscience de soion peut définir cela comme la capacité d’un système à opérer de manière non inutile avec le concept de sa propre identité.
- Il ne faut pas oublier qu’il peut y avoir au moins deux points de vue sur tout objet examiné : du point de vue«de l’extérieur»et du point de vue«de l’intérieur»Toutes les concepts examinés – l’objectivation, la systématicité et l’utilisation des identités – sont applicables depuis ces deux perspectives.
- Le sujet et le monde dans lequel il vit sont en essence un seul et même objet.Dans la grande majorité des cas, il est pratique d’oublier cela, mais il existe des situations où il est nécessaire de s’en souvenir.
- L’unité essentielle du sujet et du monde rend impossible la modélisation à grande échelle de tout sujet.
Chapitre 5. Sujet agissant de manière ciblée
La pensée philosophique mondiale est fortement ancrée dans le thème du « sujet connaissant », mais nous devrons aller au-delà et examiner le sujet agissant. La connaissance est sans aucun doute un composant nécessaire, mais son utilité n’apparaît que lorsque le savoir acquis est utilisé pour atteindre des objectifs.
La considération de la connaissance détachée de son application n’avait de sens que tant que nous avions l’habitude. réifier l’information. Tant que la connaissance était considérée comme une « substance fine » stockée quelque part à l’intérieur du sujet, on pouvait parler de la valeur intrinsèque de la connaissance. Maintenant, lorsque nous avons compris qu’aucune « substance fine » n’existe (voir chapitre 2 ) et qu’il n’existe pas non plus de réalité objective unique pour toutes les situations (voir chapitre 3 ), nous, armés de l’idée de l’unité essentielle du sujet et du monde (voir chapitre 4 ), nous pouvons aborder la discussion de certaines questions auparavant insolubles avec le bon ensemble d’outils.
L’une des questions philosophiques désespérées est celle de l’existence de la causalité, qui peut être formulée de la manière suivante :«Quelle est la raison pour laquelle des relations de cause à effet sont observées partout dans notre monde ?»On peut facilement remarquer que cette question est logiquement circulaire. La causalité y est devenue un phénomène examiné à travers le prisme de la catégorie « causalité ». Néanmoins, cette question existe, et sans y apporter de réponse, il est impossible de comprendre comment les connaissances acquises par le sujet connaissant peuvent, d’une manière ou d’une autre, se rapporter aux objectifs que le sujet agissant tente d’atteindre.
«Pourquoi» et «pourquoi»
En posant des questions sur les raisons d’un phénomène ou d’un autre, nous pouvons commencer la question par le mot « pourquoi » ou par le mot « pour quoi ». Parfois, il arrive que la question « pour quoi » n’ait pas de sens, tandis que seule la question « pourquoi » en ait un. Parfois, c’est l’inverse. Il arrive aussi que les deux questions, « pour quoi » et « pourquoi », soient correctes, mais dans ce cas, elles impliquent des réponses fondamentalement différentes. Pratiquons un peu :
- Вопрос :Pourquoi pleut-il ?
Ответ:Un cyclone est arrivé.
Вопрос :Pourquoi pleut-il ?
Ответ:… pas besoin. - Вопрос :Pourquoi l’ampoule brille-t-elle ?
Ответ:Je veux lire.
Вопрос :Pourquoi l’ampoule brûle-t-elle ?
Ответ:La chute de tension sur le filament, pour une résistance électrique donnée, entraîne la libération d’énergie thermique avec une puissance égale à U.2./R.. - Вопрос :Pourquoi l’eau coule-t-elle dans la baignoire ?
Réponse :Je me lave les mains.
Вопрос :Pourquoi l’eau coule-t-elle dans la salle de bain ?
Réponse :Parce que le robinet est ouvert. - Вопрос :Pourquoi les baies de framboise sont-elles sucrées ?
Ответ:Pour que les animaux les mangent et dispersent les graines à travers toute la forêt.
Вопрос :Pourquoi les baies de framboise sont-elles sucrées ?
Ответ:Parce que le glucose produit lors du processus de photosynthèse est transféré dans les fruits et s’y accumule.
Les questions de type « pourquoi » impliquent une réponse téléologique, c’est-à-dire fondée sur l’utilité d’un événement. L’approche scientifique exige un rejet de la téléologie ou, si cela est impossible, demande que tout « pour que » se réduise finalement à un « parce que » mécaniste. Et c’est juste. Un peu plus bas, cela deviendra clair.Pourquoi.C’est fait comme ça.
Considérons comment les causes et les conséquences se rapportent entre elles dans les questions du « pourquoi » et du « pour quoi ». L’action d’un sujet actif consiste à rassembler un ensemble de causes qui, en fin de compte, donneront la conséquence désirée. D’abord, je tends la main vers l’interrupteur, puis je profite de l’ampoule allumée. À ce moment-là, lorsque je tends la main vers l’interrupteur, l’ampoule n’est pas encore allumée. Et quand elle est allumée, il n’est plus nécessaire de l’activer. Lorsque j’ouvre le robinet, il n’y a pas encore de jet d’eau. Quand je rapproche mes mains du jet, mes mains ne sont pas encore lavées. Une fois que mes mains sont lavées, je n’ai plus besoin de les laver. Lorsque le framboisier accumule du glucose dans ses baies, celles-ci ne sont pas encore mangées par les animaux. Quand les baies sont mangées, l’arbuste ne stocke plus de glucose dans ces baies spécifiques. Dans la causalité téléologique du « pourquoi », la conséquence est toujours temporellement postérieure à la cause (félicitations, nous avons rencontré le concept de « temps »). En termes d’espace, la cause et la conséquence peuvent également se trouver à des endroits différents (l’interrupteur sur le mur, et l’ampoule au plafond).
Dans la causalité mécaniste « pourquoi », la cause coïncide entièrement avec l’effet tant dans l’espace que dans le temps. La dissipation de puissance par une ampoule s’exprime par la formule P = U.2./R, et dans ce phénomène, l’endroit dans l’espace et le moment dans le temps où la puissance P se dissipe sont exactement le même endroit dans l’espace et le même moment dans le temps où il y a une chute de tension U sur la résistance électrique R. Qu’est-ce qui est la cause et qu’est-ce qui est l’effet ici ? Si nous contrôlons l’alimentation en tension à l’aide d’un interrupteur, et que la libération d’énergie est l’effet souhaité, alors considérons la tension comme la cause et la puissance comme l’effet. S’il y a peu de lumière, nous allons remplacer l’ampoule par une plus puissante. Plus puissante signifie qu’elle a une résistance électrique plus faible. La cause de l’augmentation de P sera la diminution de R. En revanche, un générateur électrique fonctionne dans le sens inverse : pour obtenir une tension à la sortie (qui sera l’effet souhaité), nous appliquons un effort (une puissance mécanique) à l’arbre du générateur.
La formule bien connue de la mécanique, F = ma, qui relie la force, la masse et l’accélération, concerne toujours la même zone d’espace et de temps. De la même manière, selon la situation, nous pouvons désigner la force (par exemple, la force de nos muscles) comme la cause, et l’accélération de la balle comme l’effet souhaité. Et nous pouvons faire l’inverse. Par exemple, si la force de nos muscles n’est pas suffisante pour enfoncer un clou dans un morceau de bois, nous organisons une accélération brusque (le ralentissement est également considéré comme une accélération en physique) du marteau, et nous obtenons la force désirée.
En physique, la flèche du temps est réversible. Le seul endroit en physique où le temps est irréversible est la loi de l’augmentation de l’entropie. Mais si l’on examine attentivement le concept d’entropie, il devient évident qu’il est étroitement lié à l’existence d’un observateur qui se soucie réellement de l’état dans lequel se trouve un système thermodynamique parmi de nombreux états également probables. À partir d’un nombre insignifiant (par rapport au total) d’états, il peut tirer profit (y compris financier), tandis que des autres, il ne peut pas. Ce « souci » introduit une téléologie dans l’examen du système, et le résultat est l’apparition d’une directionnalité du temps physique.
Dans la causalité téléologique, la flèche du temps est irréversible. La cause est un outil que nous avons.il y a ici et maintenant, et que nous pouvons utiliser, tandis que la conséquence est ce qui n’existe pas encore au moment de l’action. L’irréversibilité du temps dans la causalité téléologique est due à une différence logique insurmontable entre « existe » et « n’existe pas ».
Prédisposition vs. contrôlabilité
Bien que dans la causalité mécaniste la cause et l’effet soient simultanés, le temps (généralement noté t dans les formules) est néanmoins présent dans la réalité physique. Essayons de réconcilier le temps téléologique avec le temps physique.
Supposons que je lance une balle dans un panier de basket. Mon objectif dans mon « ici et maintenant » est de donner à la balle une vitesse et une direction telles qu’elle se retrouve dans le panier après un certain laps de temps. Tant que la balle vole, je n’influence pas son mouvement. En lançant la balle, j’essaie de créer une telle détermination pour quelques secondes à l’avance, dans laquelle la probabilité de l’événement « balle dans le panier » est maximale. Si je parviens à créer une détermination rigide et sans alternative, on peut dire que j’atteins de mon « ici et maintenant » le « là et plus tard ». Le « là et plus tard » passe de l’état « n’existe pas » à l’état « existe », caractéristique non pas du futur, mais déjà du présent. Du point de vue du temps physique « t », cet avenir n’est pas encore arrivé, et pour l’instant, je n’observe que le vol de la balle, mais logiquement, la détermination est déjà établie, et l’événement « balle dans le panier » fait déjà partie de mon « ici et maintenant ».
Puisque le résultat de toute action intentionnelle se situe toujours dans le futur par rapport au moment où l’action est réalisée, il est logique de dire que cet élargissement du « maintenant » vers l’avenir est précisément ce que le sujet agissant de manière intentionnelle fait avec le temps téléologique. J’ai mis la bouilloire sur le feu — j’ai créé une prédisposition à ce qu’il y ait de l’eau bouillante dans quelques minutes. J’ai acheté des provisions pour le dîner — j’ai rendu plus probable la prédisposition à être rassasié jusqu’au matin. J’ai réparé le toit — j’ai éliminé la prédisposition indésirable d’être inondé pendant la pluie.
Plus nos connaissances sur l’environnement sont fiables, plus nous pouvons établir des chaînes de déterminations de manière fiable et sur un horizon plus lointain. Les connaissances sont de l’information. Avant tout, il s’agit d’informations sur les leviers que nous pouvons actionner dans notre « ici et maintenant » pour obtenir le « après » souhaité. C’est en fait la réponse à la question « pourquoi l’information ».
Considérons une grande détermination naturelle. Par exemple, le mouvement de la Terre autour du Soleil. Ce processus est suffisamment stable, et il est possible de calculer avec une très grande précision la position relative de ces objets, par exemple, il y a mille ans et, si rien d’extraordinaire ne se produit, pour les mille prochaines années. Nous n’avons actuellement pas la possibilité d’influencer ce processus, et je soupçonne même qu’il n’y a pas de désir d’avoir une telle possibilité. Considérons cela comme une détermination complète, si ce n’est pour un million d’années à venir, du moins pour l’année à venir. Le Soleil se lève et se couche, les saisons changent, et cela jour après jour, année après année. L’événement « le lever du Soleil demain » peut être considéré comme un futur, mais on peut aussi en parler comme d’un présent étendu dans le temps. La Terre tourne, et c’est notre présent, stable sur une très longue période. La Terre se déplace sur son orbite — et on peut aussi en parler non pas comme d’un changement de coordonnées au fil du temps, mais comme d’un état stable « se trouvant sur une orbite elliptique ». Si quelqu’un (le dieu Ra ?) devait décider si le Soleil se lèvera demain ou non, alors le lever de demain ne serait pas une détermination, et si nous voulons que le matin arrive, il nous faudrait probablement nous soucier d’offrir un sacrifice généreux au dieu Ra.
Comprendre et accepter le temps physique comme un « présent » étendu dans le temps nous est fortement entravé par cette représentation intuitive de l’écoulement du temps que nous (nous tous, y compris moi) avons l’habitude d’utiliser toute notre vie. Le temps nous apparaît soit comme un axe le long duquel nous voyageons (hier, nous étions au point « hier », et aujourd’hui, nous avons déménagé au point « aujourd’hui », comme le dessinait Emmett Brown dans le film « Retour vers le futur »), soit comme un flot d’événements qui nous submerge du futur et s’écoule vers le passé (« Les Langoliers » de Stephen King). Ces deux représentations ne peuvent avoir aucun rapport avec la réalité. Elles sont logiquement dépourvues de sens. Si l’on suppose la véracité de la première représentation, nous avons un mouvement d’un point le long de l’axe temporel, et puisque c’est un mouvement, il doit avoir une vitesse. Plus précisément, une seconde par seconde. En réduisant les secondes, nous obtenons une grandeur sans dimension, toujours identiquement égale à un. Cela devient une totale absurdité. En ce qui concerne la seconde représentation, dans ce cas, nous devons parler de la vitesse d’arrivée du flot temporel, qui s’avère également égale à une seconde par seconde. Ainsi, pour que les aiguilles des horloges puissent tourner, que les voitures puissent rouler et que les enfants puissent grandir, le temps doit rester immuable et stable dans un « toujours maintenant ». Il est facile, bien sûr, de réaliser que le temps ne peut pas s’écouler, mais il est beaucoup plus difficile de trouver quoi faire avec cette compréhension et quelle représentation plus correcte adopter. Personnellement, je ne sais pas quoi en faire. La seule chose que je peux proposer, c’est de ne pas trop s’inquiéter si ces représentations logiquement absurdes entrent en contradiction avec ce dont il arrive de parler.
Il serait intéressant de discuter avec des physiciens théoriciens professionnels de la possibilité de reformuler la physique de manière à ce que ce ne soit pas la vitesse qui soit une invention utile, dérivée de la distance et de Δt, mais que Δt soit considérée comme une invention utile, définie par la vitesse de la lumière. En d’autres termes, se débarrasser de la nécessité d’un processus de fond logiquement absurde « l’écoulement du temps à une vitesse de 1 sec/1 sec ».
Je dois m’excuser auprès des fans de récits fantastiques sur les voyages dans le temps. Puisque le temps ne s’écoule pas, il n’y a pas de cela.lieux., où la machine à voyager dans le temps aurait dû nous emmener. « Lieu dans le temps » est à la fois maintenant, il y a un million d’années et pour l’éternité après, c’est toujours la même chose — « maintenant ». La machine à voyager dans le temps n’a nulle part où aller.
Un cas intéressant de déterminisme est celui des événements aléatoires non contrôlés. Le lancer de pièce, le jeu de roulette (mais pas dans un casino, car il faut une roulette honnête), la désintégration radioactive, la réduction quantique — ce sont des exemples de la manière dont un avenir incertain (inexistant ?) devient en quelque sorte un présent déterminé et existant. On peut ressentir le désir de trouver dans les événements aléatoires la source de l’incertitude de l’avenir. Cela entraînera un mélange de deux incertitudes — téléologique (tant que je n’ai pas décidé où aller, à droite ou à gauche, les deux options sont possibles, et ma tâche est d’accomplir… probablement, par analogie avec la réduction quantique, cela pourrait être appelé réduction téléologique) et mécaniste. Afin que ces deux incertitudes, fondamentalement différentes par leur nature, ne se mélangent pas, je propose, en considérant le mode de vie des sujets d’action délibérée, de considérer l’incertitude mécaniste comme une forme de déterminisme, se distinguant des autres déterminismes par le fait que le sujet agissant ne peut en aucun cas savoir ce qui va se passer et comment cela va se passer. Ainsi,Nous considérerons comme géré tout ce qui n’est pas prédéterminé, et comme prédéterminé tout ce qui n’est pas gérable., y compris même ce qui se produit selon les lois de la purest des hasards.
Ainsi, un sujet agissant de manière ciblée a, à chaque point et dans chaque aspect de son activité intentionnelle :
- Objectif..Même si le sujet ne peut pas expliquer clairement pourquoi il a fait quelque chose de spécifique, cela ne signifie pas qu’il n’y avait pas d’objectif. Les structures profondes de notre être ne rendent pas toujours compte à la cortex des hémisphères cérébraux des décisions qu’elles prennent. De plus, l’objectif n’est pas toujours unique, et souvent, différents aspects de notre essence jouent à tirer sur la corde, ce qui ne favorise pas notre capacité à être toujours cohérents et logiques. Lorsque ce que « fait » le sujet n’est soumis à aucun objectif (par exemple, en tombant d’une fenêtre, il se dirige vers le trottoir avec une accélération de 1g), cette « activité » peut être considérée uniquement comme la réalisation d’une détermination mécaniste. L’objectif est une information sur ce que je « veux » et ce que je « ne veux pas ». Grâce à la présence d’un objectif, se réalise ce fait remarquable que tout organisme vivant se soucie de ce qui va se passer, tandis que tout système inanimé s’en moque absolument et définitivement.
- Possibilités.D’un point de vue informationnel, le sujet doit avoir connaissance des leviers qu’il peut actionner dans son « ici et maintenant », ainsi que des informations sur la manière dont ces leviers sont liés à la réalisation de ses désirs. En principe, il ne s’agit pas de deux connaissances distinctes, mais d’une seule, bien qu’il soit parfois pertinent de se concentrer sur la recherche de moyens d’action, et parfois sur la compréhension des conséquences de chaque action. La véritable beauté et le sens civilisationnel du développement des sciences naturelles, qui étudient le monde mécaniste, résident précisément dans le fait qu’elles nous fournissent des connaissances (informations) sur le fonctionnement des déterminismes. En utilisant ces connaissances, nous pouvons, depuis notre « ici et maintenant », déclencher des déterminismes de plus en plus longs et prévisibles, nous permettant ainsi d’atteindre un avenir plus lointain et intéressant. C’était une réponse à la question,Pourquoi.Les sciences naturelles ignorent soigneusement la causalité téléologique.
Il est intéressant de noter que la présence d’objectifs appropriés est une condition nécessaire à la connaissance des possibilités. L’objectif crée un contexte pour le signal « manuel de physique », et sans ce contexte, le signal ne peut pas devenir une information.
La somme de connaissances que nous apporte les sciences naturelles ne doit pas être considérée uniquement comme un ensemble de contraintes qui nous sont imposées, mais aussi comme un recueil de recettes qui élargit nos possibilités. La détermination mécaniste totale, prônée par les déterministes, ne découle d’aucune loi physique. Encore une fois : il n’existe et ne peut exister aucune loi physique interdisant d’affirmer que c’est moi, dans mon « ici et maintenant », qui choisis d’aller à droite ou à gauche.
Calculs
En théorie des algorithmes, le calcul est défini comme la transformation d’un ensemble de données d’entrée en un ensemble de résultats selon un algorithme donné. Au début du calcul, à la fois l’ensemble des données d’entrée et l’algorithme doivent être complètement spécifiés. C’est cette interprétation du calcul qui est évoquée dans le célèbre thèse de Church-Turing.
Le fonctionnement de la machine de Turing, depuis le moment du démarrage jusqu’à l’arrêt, est un processus non contrôlé, car il est entièrement prédéterminé par un ensemble de données initiales et un algorithme. À l’intérieur du processus de calcul, il n’y a nulle part de variabilité de l’avenir, nécessaire au fonctionnement d’un sujet agissant. Par conséquent, un tel calcul ne peut en aucun cas être considéré comme la réalisation d’une activité d’un sujet agissant de manière intentionnelle, en particulier celle de la pensée humaine.
L’introduction d’un élément de hasard dans le fonctionnement d’un algorithme ou dans les données d’entrée (l’utilisation d’équipements peu fiables ou d’un générateur de nombres aléatoires) ne nous donne pas non plus le droit de considérer un tel calcul comme une réalisation de la pensée. L’incertitude mécaniste a été examinée plus haut comme une variante spécifique de la détermination mécaniste.
Sur ce sujet de l’intelligence machine, on pourrait considérer qu’il est clos, s’il n’y avait pas une petite observation. Il se trouve qu’actuellement, ce que font nos ordinateurs ne s’inscrit pas dans la conception classique du calcul. La plupart des programmes pour les systèmes d’exploitation modernes, dans leur bloc principal, ne font rien d’autre que d’enregistrer des gestionnaires d’événements dans le système. Un programme piloté par des événements se révèle ouvert au monde, et son fonctionnement, considéré dans son ensemble, n’est plus un calcul unique. Le travail de l’éditeur de texte dans lequel ce texte est écrit ne peut déjà plus être reproduit par une machine de Turing. Pour le reproduire, il faudrait d’abord inclure moi-même dans le modèle, et à terme, tout l’univers. À un niveau très bas, au niveau de chaque algorithme de gestionnaire d’événements, tout reste bien sûr des calculs de Turing, mais dès que nous commençons à considérer le système dans son ensemble, nous obtenons immédiatement des effets systémiques, dont l’un est l’impossibilité de reproduire ce qui se passe par une machine de Turing.
Dans son essence, un sujet agissant de manière délibérée peut tout à fait être réalisé par un analogue de la machine de Turing, mais comme il est ouvert sur le monde et que son fonctionnement n’est pas un calcul unique, il n’y a aucune contradiction entre la théorie et la pratique.
Théorème de la détermination externe des objectifs
Formulation :La source de la définition des objectifs de tout système, à l’intérieur duquel le concept d’« information » est applicable, est toujours complètement transcendant par rapport au système.
En d’autres termes : quelle que soit la système que nous considérons, son activité en tant qu’entité unique est déterminée par des objectifs dont la source se trouve toujours entièrement en dehors de ce système.
Si l’on parle d’un individu, une affirmation similaire concernant la fixation d’objectifs externes, formulée au milieu du 20e siècle par Viktor Frankl, est devenue la base idéologique de la méthode qu’il a développée pour traiter les crises existentielles, connue sous le nom de « logothérapie ». Ici, je généralise cette affirmation à tous les systèmes liés au concept d’« information » et j’essaie de prouver cette affirmation.
Preuve.Considérons un système dans lequel se déroule un processus qui s’inscrit dans le schéma «information = signal + contexte». Comme nous le savons, le contexte est aussi une information, et puisqu’il s’agit également d’une information, il doit également se décomposer en son propre signal et son propre contexte :Information = signal1.+ contexte1.Contexte1.= signal2.+ contexte2.Contexte2.= signal3.+ contexte3.
Et ainsi de suite. En substituant la précision du contexte 1 dans la première formule, nous obtenons :Information = signal1.+ signal2.+ contexte2.
En substituant la précision du contexte 2, nous obtenons :Information = signal1.+ signal2.+ signal3.+ contexte3.
Puisque les signaux ne sont que des circonstances dont la signification apparaît dans un contexte, ils peuvent être regroupés et considérés comme un tout :Information = signal123.+ contexte3.
Nous appellerons opération de réduction des contextes l’opération consistant à exclure les contextes de l’examen tout en compressant simultanément les signaux.
On peut envisager trois options pour organiser la chaîne infinie de signaux et de contextes qui en résulte :
- Elle peut être en boucle si à un moment donné le contexte pour l’information « contexten+m.» deviendra un nouveau contexten+m+1., et le contexte précédemment parcourun...
- Il peut y avoir une dégradation des contextes au sein du système à mesure que l’on progresse dans la chaîne. Dans ce cas, en ayant un contexte au moins quelque peu identifiable.n., nous découvrons que le contexte qui suitn+1.est devenu une quantité négligeable et peut être exclu de l’examen.
- La chaîne de contextes peut dépasser le système. C’est-à-dire, par exemple, le contexten.est également une information interne du système, tandis que le contexten+1.elle ne lui appartient plus.
Aucune autre option ne se présente. Pour prouver le théorème de la détermination externe des objectifs, il est nécessaire de démontrer l’impossibilité des options 1 et 2.
Impossibilité de bouclage. Pour l’option de bouclage, nous avons la séquence suivante de réductions (supposons qu’au lieu du contexte 3, nous revenons au contexte 1). Donné :Information = signal1.+ contexte1.(expression 1)Contexte1.= signal2.+ contexte2.(2).Contexte2.= signal3.+ contexte1.(3).
Premier pas (nous avons inséré la précision du contexte 1) :Information = signal12.+ contexte2.(4).
Deuxième étape (nous avons inséré la précision du contexte 2) :Information = signal123.+ contexte1.(5).
Troisième étape (nous avons encore une fois précisé le contexte 1) :Information = signal123.+ contexte2.(6).
Le signal n’a pas changé, car le signal2.déjà pris en compte dans l’ensemble des circonstances désignées comme « signal »123.». D’après les expressions (5) et (6), il s’ensuit que le contexte1.égal au contexte2.. En insérant le contexte2.au lieu de contexte1.dans l’expression (3) et le contexte1.au lieu de contexte2.dans l’expression (2), nous obtenons :Contexte1.= signal2.+ contexte1.(7).Contexte2.= signal3.+ contexte2.(8).
Il en découle que les signaux 2 et 3 ne jouent aucun rôle et peuvent être exclus de l’examen. Ainsi, les contextes 1 et 2, dépourvus de signal, cessent d’être de l’information, et l’information avec laquelle l’examen a commencé perd son contexte :Information = signal1.+ NULL (9)
Privée de contexte, l’information cesse d’être de l’information. Par conséquent, bien que du point de vue topologique, la situation de bouclage du contexte puisse sembler cohérente, elle n’est pas capable de fournir le contexte nécessaire à l’existence de l’information.
L’impossibilité d’atténuer le contexte au sein du système. Supposons qu’à un certain stade n, notre capacité d’information du contexte soit devenue une quantité négligeable :Information = signal1234..n+ contexten.
, où.contexten.0.
Tant que nous pouvons encore suivre le contexte, l’information que nous avons peut être complète grâce au fait qu’en avançant dans la chaîne, nous avons accumulé un grand signal. Mais dès que le contexte cesse d’être discernable, l’ensemble des signaux perd son contexte et cesse d’être de l’information. Par conséquent, la situation d’atténuation du contexte à l’intérieur du système jusqu’à zéro ne nous permet pas d’obtenir de l’information.
Situation de sortie du contexte au-delà du système.Information = signal1234..n+ contexten.
, où est le contexten.n’est pas détaillé en raison du dépassement des limites du système examiné. Pour préciser le contexten.Nous aurions dû introduire le contexte.n+1., mais nous ne pouvons pas le faire, car il est transcendant pour le système. Par conséquent, le lien logique « contexten.— contexten+1.» pour le système est transcendantale (c’est-à-dire transfrontalière).
Ainsi, le sens de la manipulation des signaux 1, 2, 3, et ainsi de suite jusqu’àn., peut être déterminé uniquement par ce qui a été mis en dehors de ses limites lors de l’objectivation du système. Ce qui devait être prouvé.
Notez que la puissance du contexte transcendant n’est pas du tout nécessaire.n+1.était grandiose. L’essentiel est que ce contexte transcendant ne soit pas nul. Il suffit de toute petite quantité, mais pas négligeable, pour engendrer une avalanche de contextes qui, en fin de compte, fournira une information tout à fait significative.
Avant de commencer à utiliser de manière productive le théorème de la finalité externe, je ne peux m’empêcher de me livrer à une petite réflexion amusante. Je vais considérer comme système tout mon monde, c’est-à-dire tout le contenu de ma combinaison informationnelle (j’espère que vous n’avez pas oublié ce que c’est). En réalité, ma combinaison informationnelle est tout le monde tel que je le connais, y compris même ce que je ne sais pas, mais que je suis capable d’apprendre. Moi-même, ma famille, mes amis, ainsi que tout mon environnement, y compris les villes et les pays, la Terre, le système solaire, la galaxie, les quasars et les trous noirs — tout cela, d’une manière ou d’une autre, je le connais, donc tout cela se trouve à l’intérieur de ma combinaison. Les notions de bien et de mal, de « bien » et de « mal » — elles sont aussi là. Même des abstractions comme le théorème de Pythagore, le nombre pi et, oui, le théorème de la finalité externe — tout cela n’est nulle part ailleurs que dans le système considéré. À l’intérieur de ce système, l’information est présente, ce n’est pas pour rien que c’est une combinaison informationnelle, n’est-ce pas ? Cela signifie qu’il existe une source de sens pour toute cette magnificence, et elle se trouve, selon le théorème que je viens de prouver, entièrement en dehors du système considéré. Je vais désigner l’ensemble de ce qui constitue la source de la finalité pour mon monde (ma combinaison informationnelle est mon monde) par le mot « Dieu ». Pourquoi pas ? Cela convient tout à fait au sens. Que puis-je donc dire de ce Dieu ? Eh bien, tout d’abord, il est en dehors de mon monde, et par conséquent, je ne peux lui attribuer aucune propriété. Il ne peut être ni bon, ni mauvais, ni puissant, ni juste, ni ancien, ni nouvellement apparu. Aucune. Pas de propriétés. Mais néanmoins, il existe nécessairement (oui, cela a fonctionné).preuve de l’existence de Dieu). D’ailleurs, bien sûr, il existe seul (preuve de l’unicité de Dieu). Deuxièmement, il ne peut pas être un sujet d’action délibérée, car il a déjà englobé tout le sens global, et en conséquence, il est resté sans objectif externe.preuve de l’inexistence de Dieu). En troisième lieu, de par ma pratique, je sais qu’il existe dans le monde d’autres êtres en plus de moi, et leurs infoscaphandres, bien qu’ils se croisent avec le mien, ne coïncident pas avec le mien au point d’être identiques. En conséquence, ce qui est transcendant pour d’autres êtres ne l’est pas dans mon infoscaphandre. Et inversement. Il en résulte qu’il y a autant d’êtres que de Dieux.preuve de la pluralité des dieux). Par conséquent, toute communication dont le sujet est Dieu est dépourvue de sens, car les sujets en communication parlent inévitablement de choses différentes. En somme, le résultat est stupéfiant : Dieu existe nécessairement, mais il n’est nécessairement pas un sujet, et il ne peut pas non plus être l’objet d’une discussion qui ait un sens. La question « de quelle manière faut-il raisonner sur Dieu pour que les raisonnements aient un sens pour quelqu’un d’autre que le raisonneur lui-même ? » reçoit une réponse prouvée : « Aucune ».
Dans la vie réelle, nous ne considérons bien sûr pratiquement jamais notre monde entier comme un système. C’est une système tellement étrange — un système dont les frontières sont impossibles à concevoir (pour penser une frontière, comme le disait Wittgenstein, il faut penser aux choses des deux côtés de la frontière, or toutes les choses pensables sont déjà à l’intérieur). Dans toute activité pratique, la frontière du sujet est tracée par le sujet lui-même quelque part à l’intérieur du monde. Ici, c’est moi, et là-bas, ce n’est déjà plus moi. La frontière est dépendante de la situation, mais néanmoins, chaque fois que nous voulons agir sur le « non-moi » à l’aide de ce qui est désigné comme « moi », elle doit être établie. Et chaque fois, la source de sens de ce que nous laissons à l’intérieur en traçant la frontière doit être quelque chose qui est resté à l’extérieur. Tracer la frontière de son propre « moi » à l’intérieur de son propre monde nous permet de parler de notre propre objectif externe.
Liberté de choix
Dans la vie des sujets agissant de manière ciblée, il peut survenir une très grave mésaventure, à savoir qu’ils peuvent cesser d’être des sujets agissant de manière ciblée. Je ne vais pas aborder le cas banal de la « mort », lié à la destruction du système, non pas parce que cela fait peur, mais parce que ce n’est pas intéressant. Avec la mort, tout est déjà clair. Deux autres options (que nous désignerons comme«perte de subjectivité») beaucoup plus intéressant :
- Perte de la définition des objectifs externes.Chose terrifiante. Crise existentielle. Perçue subjectivement comme « je ne veux rien », « rien ne peut changer », « il n’y a pas de raison de vivre », « il n’y a plus d’espoir », « maintenant, peu importe ». L’une des causes typiques des suicides. Un sujet sans objectif externe ne peut pas agir de manière ciblée, et donc même s’il a peur de quitter la vie de son plein gré, il se transforme assez rapidement en une coquille vide qui existe simplement comme un objet inanimé. Heureusement, un objectif externe peut se rétablir, et alors le sujet retrouve à nouveau la capacité d’agir de manière ciblée et redevient lui-même. Ou pas. Comme on peut le souhaiter.
- Esclavage.Lorsque la seule source de la détermination des objectifs d’un sujet est un autre sujet, l’infortuné devient l’instrument de son maître. Une propriété entièrement possédée. Peu importe à qui ou à quoi le sujet est asservi — en tant qu’entité autonome, il n’a déjà plus besoin d’être considéré. En interagissant avec un tel non-sujet, il faut comprendre que le véritable sujet de l’interaction, dans ce cas, est le maître, tandis que l’esclave n’est qu’un élément technique, simplifiant ou compliquant l’interaction. Le plus grand malheur dans la vie d’un esclave est la perte de son maître. Dans ce cas, il se retrouve dans une situation de perte de la détermination externe des objectifs, perdant ainsi même cette subjectivité illusoire qu’il avait.
L’esclavage à notre époque éclairée n’est pas si souvent total parmi les gens. On rencontre plus souvent l’esclavage temporaire, lorsque l’individu vend son temps pour subsister (en réalité, une partie de sa vie, puisque le temps et la vie ne sont qu’une seule et même chose) et devient un rouage du système. « Nous ne décidons rien ici », « je ne fais que suivre les ordres », « dans la prise de décisions, je dois me conformer uniquement aux instructions de poste et à la lettre de la loi » — tout cela sont des signes caractéristiques de l’esclavage. Oui, en terminant sa journée de travail et en retirant sa casquette, l’esclave cesse d’être esclave et devient un mari aimant, un père attentionné, un excellent camarade et un citoyen engagé, mais cela n’annule en rien le fait que, lorsqu’il est « en service », il n’est pas un sujet autonome agissant de manière délibérée, mais simplement un mécanisme exécutif du maître.
Un sujet agissant de manière intentionnelle, qu’il s’agisse d’un être humain, d’un animal ou d’une plante, est toujours un être qui, depuis son « ici et maintenant », s’étend vers l’avenir en créant des déterminations, transformant un avenir inexistant en un présent existant. En réalité, on peut parler d’un flux global d’actes de création qui constituent l’essence de chaque « ici et maintenant » de chaque être. Cependant, la transformation d’un avenir inexistant en un présent existant n’a lieu que si l’activité du sujet n’est pas déjà une détermination créée. Un mécanisme exécutif, « simplement en train d’exécuter un ordre » ou « suivant exactement les dispositions d’une instruction », ne produit aucune création. Il n’est qu’un moyen de mise en œuvre d’une détermination mécaniste déjà lancée. Ainsi, la liberté de volonté n’est pas seulement souhaitable pour un sujet agissant de manière intentionnelle, elle est une condition absolument nécessaire pour que l’on puisse parler d’un être en tant que sujet. Nous sommes nous-mêmes seulement dans la mesure où, dans les aspects de notre existence, nous construisons notre propre avenir. C’est-à-dire lorsque nous sommes libres.
Il peut sembler que la nécessité de la liberté entre en contradiction logique avec le théorème de la détermination externe des objectifs. Ce n’est en aucun cas le cas. En effet, la perte de subjectivité à travers l’esclavage ou la perte totale de la détermination externe des objectifs, ou l’esclavage, n’est heureusement pas une liste exhaustive des états de vie des sujets.
Considérons la situation du « valet de deux maîtres ». Supposons qu’une femme consacre toute sa vie entre son travail, où elle est la fidèle esclave de son patron, et son foyer, où elle est la fidèle esclave de son mari. L’esclavage se manifeste tant au travail qu’à la maison, avec des pauses pour dormir et des trajets en transports en commun. La situation change-t-elle lorsque, au lieu d’un seul maître, le sujet en a deux ? Dans les deux cas, notre malheureuse est simplement un outil exploité, les séances d’exploitation étant simplement réparties dans le temps. Tant que notre modèle tourne simplement selon un ordre établi, comme un écureuil dans sa roue, aucune liberté n’émerge. Mais dès qu’elle commence à ajuster un peu ses priorités (si une urgence survient au travail, alors…résoutrester une petite heure, et si le soir c’est le grand ménage, alorsrésoutAu travail, en se relaxant un peu, une petite échappatoire se forme, par laquelle notre protégée obtient sa propre liberté de choix. Son mari est bien sûr choqué que sa servante ait osé lui prendre une heure entière de sa propriété. Le patron fronce également les sourcils, mais ne sait pas encore s’il doit menacer de châtiments divins pour la baisse de productivité, ou s’il doit attendre un peu. Oui, les sources de fixation des objectifs restent les mêmes, elles sont toujours au nombre de deux et continuent de fonctionner comme auparavant, mais la gestion des priorités n’est plus aussi rigide. Un esclave qui commence à gérer le volume de son appartenance à son maître n’est déjà plus tout à fait un esclave.
Une personnalité pleinement développée, que personne n’oserait qualifier d’esclave, n’est pas celle qui n’a pas d’objectifs externes (ce qui est impossible selon le théorème), mais celle qui a des dizaines, voire des centaines de sources d’objectifs. La nécessité de gérer en permanence des priorités complexes et interférentes crée l’illusion, y compris pour le sujet lui-même, qu’il définit toutes ses objectifs uniquement par lui-même. Et il y a une part de vérité dans cela, car le maître du processus de gestion des priorités ne peut être que le sujet lui-même. Ainsi, la nécessité de la liberté ne contredit en rien le théorème sur les objectifs externes.
Considérons maintenant la situation non pas du point de vue de l’esclave, mais de celui du maître. La motivation d’avoir un esclave est simple et évidente. En observant les choses intéressantes que des sujets agissant de manière délibérée accomplissent de leur propre volonté, le potentiel maître désire que tout cela se produise pour son propre bénéfice. En concentrant la détermination des objectifs des sujets sur lui-même, le maître ne reçoit pas simplement un morceau primitif d’un mécanisme sans âme, mais un outil d’une complexité inimaginable, qui vient de démontrer des merveilles de création. Mais presque immédiatement, après avoir acquis un esclave, le nouveau maître reçoit une « surprise » : les merveilles cessent de se produire. La transformation d’un futur inexistant en un présent existant est une fonction de la libre volonté, et lorsque toute la détermination des objectifs d’un sujet se concentre sur une seule source, la libre volonté cesse d’exister.
En rêvant de créer une intelligence artificielle, nous espérons que la technologie atteindra un tel niveau de développement qu’il nous sera possible d’obtenir des esclaves artificiels capables de résoudre de manière autonome des tâches complexes et non standard. Non seulement d’exécuter une prédisposition programmée à l’avance, mais aussi de prendre des décisions par eux-mêmes dans des situations difficiles. D’aborder de manière créative la tâche de satisfaire notre insatiable besoin de confort. Mais un esclave dont la source de détermination des objectifs est entièrement centrée sur son maître n’est capable ni de créer l’avenir, ni encore moins de prendre des décisions. La tâche est auto-contradictoire. Soit nous obtenons un être capable d’agir de manière ciblée, mais dans ce cas, nous ne sommes pas les seuls à déterminer ses objectifs, soit nous avons une nouvelle version d’une calculatrice programmable. Un choix complexe. En réfléchissant au problème de la création d’une intelligence artificielle, il ne faut pas négliger cet aspect qui s’est soudainement révélé.
Bilan du chapitre
Dans ce chapitre, les catégories philosophiques les plus complexes se sont entremêlées : la causalité, le temps, la prédestination et la liberté de choix. Il est utile de revisiter la structure logique qui en résulte :
- Le concept de « causalité » s’est divisé en deux types de causalité interconnectés mais fondamentalement différents :
- Causalité mécaniste, fonctionnant selon des lois d’inévitabilité. Elle se caractérise par le fait que, dans ce type de causalité, la cause coïncide entièrement avec l’effet dans l’espace et le temps. Les marqueurs de la causalité mécaniste sont les formulations « pourquoi… » et « parce que… ».
- Causalité téléologique, engendrée par la volonté libre. Dans ce type de causalité, la cause précède toujours l’effet. Les marqueurs sont les formulations «pourquoi…» et «afin de…».
La distinction du concept de « causalité » en deux types se justifie par une justification dépendante de la situation : il existe des situations où, pour un même phénomène, il est nécessaire de répondre dans le style « parce que… » ou dans le style « afin de… », et ce sont des réponses fondamentalement différentes.
- Mode de fonctionnement d’un sujet actif— agir dans son « ici et maintenant » sur l’ensemble des causes pour créer une prédisposition à l’atteinte des objectifs dans le futur.
- La direction de la flèche du tempsDu passé au futur, il s’est avéré que c’est le résultat d’une différence logique entre l’existence et la non-existence. Le temps désigné comme « maintenant » est l’ensemble de ce qui existe, tandis que le temps désigné comme « futur » est l’ensemble des choses qui n’existent pas encore.
- Le temps ne s’écoule pas.C’est logiquement impossible.
- Lien entre la contrôlabilité et la détermination.Ce qui est contrôlable est tout ce qui n’est pas prédéterminé, et ce qui est prédéterminé est tout ce qui n’est pas contrôlable.
- La gestion est impossible sans un sujet et sans qu’il dispose d’informations.sur les relations de cause à effet de type mécaniste. Cette affirmation contient des réponses à deux questions : « pourquoi l’information ? » et « pourquoi les sciences naturelles doivent-elles ignorer la téléologie ? ».
- Un sujet agissant de manière ciblée est impossible sans la présence d’objectifs.
- Théorème de la détermination externe des objectifsLa source de la définition des objectifs de tout système, à l’intérieur duquel le concept d’« information » est applicable, est toujours complètement transcendant par rapport au système.
En appliquant le théorème, n’oublions pas que nous pouvons considérer comme système n’importe quel morceau objectivé de la réalité qui possède la propriété de systématicité (voir dans chapitre 4 ) avec une seule exception : dans ce cas, nous ne devons pas considérer l’ensemble du contenu de la combinaison spatiale comme un système unique. - Méthodesperte de subjectivité: perte de l’orientation externe et esclavage. Et, bien sûr, la mort physique.
- Sur soi-mêmeliberté de choixOn peut et doit parler du sujet lorsque l’on ne peut pas indiquer une source unique de détermination externe des objectifs. C’est-à-dire dans une situation que l’on peut qualifier de « serviteur de deux maîtres ». Plus il y a de sources de détermination externe des objectifs, qui entrent en contradiction les unes avec les autres et se réalisent à travers l’activité du sujet, plus celui-ci possède sa propre liberté.
- Avec la perte de la liberté de choix, le sujet cesse d’être un sujet.
Chapitre 6. Créatures
Jusqu’à présent, en parlant des sujets, nous avons implicitement sous-entendu nous-mêmes, des représentants de l’espèce biologique homo sapiens dotés de pensée et de libre arbitre. Mais si l’on examine attentivement le matériel abordé, on peut remarquer qu’aucune des réflexions ne suggère que le sujet doit nécessairement être un humain. Un système peut être n’importe quoi (pourvu qu’il y ait lieu). systématicité ). Combinaison signal et contexte — une construction abstraite qui ne contient pas l’exigence d’être nécessairement incarnée sous la forme d’un cerveau humain. Même la situation du « valet de deux maîtres », qui engendre à l’intérieur du système sa propre… liberté de choix , ne doit pas nécessairement se limiter aux personnes.
Il est évident que la première chose qui vient à l’esprit lorsqu’on se pose la question de la recherche de nos frères en liberté de choix, ce sont les animaux. Mais c’est un exercice trop simple pour nous. Essayons de chercher des êtres plus exotiques.
Souris.
Je me permets une petite exploration linguistique.
Les pronoms personnels (« je », « tu », « il », « elle » et « on ») ont un pluriel (« nous », « vous » et « ils ») qui peut être utilisé de deux manières fondamentalement différentes :
- Pour décrire les caractéristiques personnelles des personnes (ou pas nécessairement des personnes) qui font partie de l’ensemble désigné. Par exemple, «nous., les gens ont généralement deux bras et deux jambes » ou « chezнас.«Les hommes, contrairement aux femmes, commencent à avoir des poils qui poussent dans les oreilles avec l’âge.» On examine de nombreux objets possédant certaines propriétés, et lorsque nous parlons de ces propriétés, nous désignons le pluriel à l’aide d’un pronom. Dans ce cas, le pronom «nous» est une forme plurielle honnête de «je». Rien d’intéressant.
- Pour désigner une action collective. «Nous.«Nous avons discuté et décidé…», «nous.«nous avons joué au préférenç»нас.«Un enfant est né». Cela désigne une certaine action ou un événement et met l’accent sur la participation collective. Si je dis «j’ai consulté», la question «avec qui ?» se pose immédiatement. Il est impossible de consulter soi-même. Si l’on consulte soi-même, ce n’est plus «j’ai consulté», mais «j’ai réfléchi». Avec ces «nous» collectifs, il y a un aspect intéressant : le locuteur n’est pas nécessairement tenu d’avoir participé personnellement à l’action qu’il attribue à son «nous». Par exemple, je peux avec fierté affirmer que «nous avons été les premiers à envoyer un homme dans l’espace», en entendant par «nous» la communauté qui existait autrefois, l’«Union soviétique». Cela dit, personne, y compris moi-même, n’est gêné par le fait qu’à l’époque où Youri Gagarine a volé, je n’étais pas encore né.
De ce que nous devons très souvent désigner une entité collective, sans laquelle les événements décrits n’auraient même pas commencé, on peut, en utilisant une méthode justification dépendante de la situation , conclure que les entités de groupe existent. Et puisque elles existent, il est logique de savoir en parler.
La première chose que l’on peut dire sur les entités composées que nous désignons par les mots « nous », « vous » et « ils » est qu’elles sont des systèmes. Il y a une décomposabilité, et, par conséquent, la présence d’effets systémiques. Parfois, la situation est telle que les contributions des participants se contentent de s’additionner. Par exemple, Ivan et Vassili tirent un bateau de l’eau sur la rive à l’aide d’une corde. Supposons qu’un seul participant n’ait pas assez de force pour cela, mais qu’à deux, ils y parviennent. Nous avons un passage banal de la quantité à la qualité, mais à y regarder de plus près, la situation s’avère plus complexe qu’il n’y paraît. On peut commencer par le fait qu’Ivan ne se rendra pas sur la rive pour tirer le bateau s’il ne sait pas que Vassili y va aussi. Et Vassili n’ira pas s’il n’a pas l’information qu’Ivan y va. Les participants doivent être capables de se mettre d’accord entre eux. Définir un objectif commun, répartir les rôles, planifier l’événement. Il s’avère que l’addition simple des vecteurs de force F observée au départ…Ivan.и F.Vassilin’est que la partie émergée de l’iceberg, sous laquelle se cachent des choses plutôt non triviales, y compris la capacité à négocier, l’historique des relations et les projets pour une utilisation future du bateau.
La topologie «1+1» est la topologie la plus simple d’une entité composite. Supposons qu’à Ivan et Vassili s’ajoute Elena, qui ne tirera pas le bateau, mais s’occupera de la préparation des repas pendant que les hommes sont occupés à un travail lourd. L’apparition d’un troisième participant complique immédiatement la situation de manière radicale. Nous avons la compagnie «I+V+E», mais le système «I+V» ne disparaît pas pour autant (c’est lui qui est parti tirer le bateau). De plus, si Ivan et Elena s’apprécient, il est pertinent de parler du système «I+E». Il ne faut pas non plus négliger le système «V+E», car tout peut arriver. En outre, puisque les systèmes «I+E» et «V» existent, des relations peuvent tout à fait s’établir entre eux, engendrant une systématicité propre. Autrement dit, la construction «(I+E)+V» est également valable. Surtout s’il y a un triangle amoureux. Et pour la symétrie, ajoutons les systèmes «I+(V+E)» et «(I+V)+E». En tout, dans une compagnie de trois amis partis en pique-nique, nous observons la présence de dix systèmes :
И, В, Е, И+В, И+Е, В+Е, И+(В+Е), (И+В)+Е, В+(И+Е), И+В+Е
Supposons que Maria se joigne soudainement à ses amis. Je ne vais pas m’atteler à énumérer toutes les combinaisons possibles. Puis vient Nicolas, et nous avons une explosion combinatoire. Tout cela avec seulement cinq sujets. N’oublions pas que des options comme «(I+V+N)+(E+M)» (qui représentent les relations entre le sujet composé «tous les garçons» et le sujet composé «toutes les filles») ont également leur sens.
L’exemple avec cinq amis a été donné uniquement pour démontrer l’émergence d’une avalanche de complexité, qui se produit même avec un nombre relativement restreint d’éléments soigneusement isolés du monde extérieur. La réalité est, bien sûr, encore plus cauchemardesque. Lors de la discussion sur la systématicité, il est apparu que la présence de tous les participants dans une même zone spatio-temporelle n’est pas du tout nécessaire pour l’existence d’une entité composite. Par exemple, les relations d’Elena avec les garçons peuvent être considérablement influencées par un facteur tel que « que dira maman ? ». Autrement dit, le sujet composite « Elena + sa maman » est également présent dans la situation. Si l’on considère que tous les participants au pique-nique connaissent la mère d’Elena, cela devient triste. Il est probablement temps de cesser d’ajouter des gens à la compagnie. À moins de ne pas oublier de prendre en compte que Nicolas est musulman, Vassili est chrétien, Ivan est supporter du club Spartak, et Maria est supportrice du CSKA. Il s’est ainsi naturellement avéré que de grandes entités composites telles que « musulmans », « chrétiens », « supporters de Spartak » et « supporters du CSKA » se sont également intégrées dans la joyeuse compagnie.
Et voilà, nos amis ont terminé toutes les tâches essentielles pour le pique-nique, ils sont assis autour du feu et discutent comme si de rien n’était. Mais que signifie « comme si de rien n’était » ? En réalité, nous assistons à une séance de mise en relation des objectifs, des plans et des solutions constructives au cours d’une interaction directe qui échappe même au décompte du nombre de sujets composant ce groupe spontanément formé « I+V+E+M+N ».
Peut-être (et probablement, cela doit) se poser la question de savoir s’il est possible de se passer de sujets composés ? Tout devient trop compliqué lorsque la combinatoire entre en jeu. Peut-être suffit-il d’examiner des individus séparés et, en tenant compte de leurs particularités et de leurs motivations personnelles, de comprendre ce qui se passe ? Le réductionnisme exige avec insistance d’agir de cette manière. C’est possible, mais alors un grand nombre d’effets qui se manifestent resteront inexpliqués. Imaginez que vous essayez de comprendre le fonctionnement d’un mécanisme d’horloge, mais que vous décidez d’examiner le fonctionnement de chaque petite pièce séparément, sans tenir compte de la façon dont elles s’imbriquent. L’exclusion des sujets composés fera immédiatement éclater l’image globale en fragments séparés se comportant de manière inexplicable.
L’un des phénomènes inexplicables dans ce cas sera sans doute l’humour. Les amis rassemblés autour du feu racontent des histoires drôles et rient ensemble. Du point de vue d’un individu, l’humour est une chose complètement absurde. Pourquoi avons-nous en nous un mécanisme qui nous pousse à chercher des informations très spécifiques, et une fois que nous les avons obtenues, nous commençons à effectuer des exercices de respiration spécifiques et à en tirer un plaisir caractéristique ? Si notre corps a besoin d’exercices de respiration, il nous envoie des soupirs profonds, des hoquets ou des bâillements. C’est simple et utilitaire. Le rire, c’est tout autre chose. Il élève, humilie, purifie et nous plonge dans la boue. Le rire peut être utilisé à la fois comme une arme mortelle et comme un remède. Celui qui fait une bonne blague devient le roi du moment, tandis que celui qui rate sa blague est immédiatement poussé vers la sortie. Il est évident que les choses sont beaucoup plus subtiles et complexes que de simples exercices de respiration.
L’hypothèse la plus plausible sur ce qu’est réellement le rire me semble être celle selon laquelle le rire est l’un de nos mécanismes de communication naturels innés. Les vaches meuglent, les chats miaulent, les chiens aboient, et les humains rient. Si un habitant des jungles amazoniennes me parle dans sa langue, je ne comprendrai rien, mais s’il rit, cela signifiera exactement la même chose que pour n’importe quel membre de ma culture. Cela signifiera qu’il trouve quelque chose de drôle. Nous avons tous une compréhension implicite claire de ce que signifie « drôle », mais lorsque nous essayons de le décrire avec des mots, cela devient absurde. Drôle, c’est quand on dit « ha-ha-ha », quand on dit « oh, je ne peux pas », quand on dit « je vais me faire mal au ventre ». Avec une description explicite du sens du rire, cela devient un peu comique. En parlant de nos mécanismes de communication naturels innés, on peut également évoquer les pleurs, les cris de terreur, les cris de douleur et les appels. La finalité de ces mécanismes est claire, le sens des signaux transmis et reçus est évident (ce qui signifie que nous avons un contexte propre pour eux). Dans ce contexte, le rire, dont la finalité est un peu floue, se distingue un peu. Si nous ne comprenons pas,Pourquoi.Il faut du rire («prendre du plaisir» n’est pas une réponse), donc les véritables bénéficiaires de ce qui se passe ne sommes pas nous. Mais si ce n’est pas nous, alors qui ? Nos corps transmettent ces signaux spécifiques, mais nos personnalités ne sont en réalité que partiellement leurs véritables émetteurs et récepteurs.
À plusieurs reprises, différents auteurs ont exprimé l’opinion que le sens du rire n’existe pleinement pas au niveau des individus, mais au niveau des collectifs. Un collectif ne peut exister tant que ses membres ne se sont pas mis d’accord sur certaines choses. Par exemple, sur quel comportement dans ce collectif doit être considéré comme inacceptable. Avec chaque blague réussie, le groupe acquiert de plus en plus d’intégrité, et nos mécanismes naturels internes reconnaissent que nous participons à quelque chose de très juste, nous récompensant par une bonne humeur. Un renforcement positif. Une blague ratée divise le groupe, et c’est une mauvaise idée, et celui qui a dit une bêtise a envie d’être puni. Si dans le groupe il y a des blagues et de la bonne humeur, cela signifie que le groupe est vivant, en bonne santé et se développe de manière dynamique. Si dans le groupe les blagues ont complètement cessé, cela signifie que quelque chose de monstrueux devient la norme de la vie, et le groupe est probablement condamné.
Dans le contexte de ce récit, la question « à quoi sert le rire » est intéressante non pas tant en elle-même, mais comme exemple d’un mécanisme structurant. Un mécanisme qui se manifeste dans la construction des parties composantes du système, mais dont la fonction ne se révèle qu’au niveau du système dans son ensemble.
Dans l’ensemble, une situation similaire se présente avec l’argent. Il a été mentionné précédemment que l’argent est un objet d’information, ce que souligne le fait qu’il peut être transmis par Internet. Cependant, nous ne considérons pas l’argent comme de l’information, mais uniquement comme une ressource matérielle (?). Si un compte bancaire affiche mille dollars, nous percevons ce fait comme un certain volume de matière spécifique qui peut être échangé contre quelque chose. Mais l’argent n’est pas de la matière. C’est de l’information.
Il peut sembler que tout le contenu informationnel de l’argent se résume à des données sur leur quantité, mais en y regardant de plus près, on réalise que la quantité d’un objet et l’objet lui-même sont tout de même des choses différentes. On peut avoir des informations sur la quantité d’eau, et même transmettre ces informations par Internet, mais il est impossible de transmettre l’eau elle-même par Internet. En revanche, l’argent, oui.
Si l’argent est une information, alors il doit y avoir un contexte dans lequel la sémantique du signal se révèle. Nous ne sommes pas capables de considérer l’argent comme une information (je souligne encore une fois que nous le voyons comme une ressource matérielle), par conséquent, ce n’est pas notre information. Tout comme dans le cas du rire, on peut supposer que l’essence informationnelle de l’argent se révèle au niveau des structures interpersonnelles. En réalité, l’argent est une information interne de l’économie de marché. Le fait que nous ne les percevions pas comme une information, mais comme une ressource matérielle, est un élément très important du jeu dans lequel nous participons en tant qu’agents économiques.
En plus du rire et de l’argent, il est bien sûr essentiel de parler de l’amour. C’est une chose merveilleuse, qui absorbe complètement l’individu dans le but unique de former un système transpersonnel à deux, capable de créer le miracle de la naissance et de l’éducation d’une nouvelle vie. La complexité, l’importance et l’ampleur de cette tâche sont telles qu’il est approprié d’utiliser, selon notre nature, les renforcements les plus puissants, qu’ils soient positifs ou négatifs. Le thème de l’amour aurait pu être abordé dans le chapitre précédent, lorsqu’il était question de la définition des objectifs externes, mais à ce moment-là, nous n’avions pas encore un élément important. Nous n’avions pas compris ce qui pouvait, dans ce cas, être la source de la définition des objectifs externes. Il peut sembler qu’un garçon éperdument amoureux devient l’esclave de sa bien-aimée, et qu’une fille amoureuse devient l’esclave de son élu. Mais cela ne peut pas être vrai, car dans ce cas, le scénario le plus favorable (la réciprocité totale) devient une boucle absurde et contre-productive. Tout s’éclaire seulement si l’on suppose que la source de la définition des objectifs est quelque chose de tiers. Il est évident que dans ce cas, ce quelque chose de tiers ne peut être que le sujet composite « garçon + fille ». La famille. Une famille naissante, mais déjà une famille. Lorsque nous regardons un couple en train de se chuchoter des mots doux, nos yeux ne voient que les personnes qui le composent, et il peut nous sembler qu’il n’y a personne d’autre. Mais ce n’est qu’une illusion d’optique. L’entité composite « famille », bien qu’elle n’ait pas de manifestation physique distincte (rappelons-nous le thème… «réification» ), mais il existe sans aucun doute en tant que système.
Dans un mode normal, chacun de nous peut être considéré comme une incarnation corporelle d’un nombre inimaginable de « nous ». Même en nous adonnant à une contemplation totalement détachée du monde extérieur, nous ne réduisons pas notre conscience à un point, mais au contraire, nous élargissons au maximum, dans la mesure du possible, notre regard intérieur sur cette magnificence que l’on peut appeler notre monde, et, en même temps, notre propre « moi ». En effet, non seulement nous faisons partie de ces étranges êtres composites (appelons-les les NOUS), mais en se rencontrant en nous, ils deviennent eux-mêmes des parties de ce système que nous désignons par la lettre « je ».
Une petite remarque avant de continuer : nous ne faisons pas partie des MYShek uniquement avec des semblables. Le symbiose inter-espèces est un phénomène courant dans la nature. Il y a de sérieux soupçons qu’une part significative des MYShek se cache dans les profondeurs de notre propre biologie, et nous n’avons même pas conscience de leur existence.
Raison.
Un sujet particulier de la fierté humaine est notre précieux esprit humain. En observant cette chose incroyable en nous, nous nous plaçons sans hésitation au sommet de l’univers. Nous nous appelons « Homo sapiens ». Quoique nous soyons faibles, lents, maladroits et sensibles, nous avons l’esprit, et c’est ce qui fait de nous les maîtres de la nature. De toute la nature. Sans exception.
Prenons le temps de réfléchir calmement : est-ce vraiment une chose si unique dans cette nature dont nous nous sommes autoproclamés les maîtres ?
Imaginez des astronautes arrivant dans un lointain système planétaire. Ils se posent sur une planète. Un désert pittoresque sous un ciel de couleur étrange, baigné par des mers de liquide toxique. Le vent. Des pierres aux formes étranges. Nous cherchons des traces d’activité intelligente. Pas de vestiges de constructions, aucun objet inhabituel qui pourrait laisser penser qu’il a été fabriqué pour un but précis. Nous notons dans le journal de bord : « Aucune trace d’activité intelligente détectée ». Nous continuons notre route. Sur la planète suivante, tout est complètement différent. Une dense urbanisation. Diverses productions automatiques. Dans les carrières, des machines ingénieusement conçues extraient le minerai, des complexes incroyablement complexes en fabriquent quelque chose. Un système de transport incroyable, à la fois à la surface de la « terre », sous celle-ci et dans les airs. Partout, quelque chose est en construction. Ce qui est vétuste est démonté et envoyé au recyclage. Rien n’est clair, tout ne peut être que deviné. Les propriétaires de toute cette magnificence (des petits hommes verts avec de grandes têtes) sont invisibles, personne à qui poser des questions. Que devrions-nous écrire dans le journal de bord ? Encore « Aucune trace d’activité intelligente détectée » ?
Bien sûr, il n’est pas nécessaire de voyager loin pour voir cela. On peut, par exemple, simplement entrer dans une forêt et, en retirant les œillères de la satisfaction de soi, regarder autour de soi. On peut observer une goutte d’eau de marais au microscope. On peut aussi examiner une goutte de son propre sang au microscope. Partout, il y a des mécanismes d’une complexité inimaginable, chacun clairement conçu pour accomplir une certaine fonction. Où allons-nous chercher les petits hommes verts à grandes têtes, pour qui une racine d’herbe s’enfonce dans la terre ? Pour qui un moustique, cette incroyable merveille volante de l’ingénierie, se construit-il à partir de ces déchets inimaginables dont il est fait ? Qui dirige la construction de cette structure d’une complexité étonnante que nous voyons dans le miroir comme un poil à raser ?
Si j’étais religieux, je répondrais « Dieu » à toutes les questions, je citerais quelques passages des écritures sacrées, et ainsi la discussion pourrait se terminer. « Dieu » est la réponse universelle à toutes les questions « comment ? », « pourquoi ? » et « pour quoi faire ? ». Une réponse dénuée de sens, mais universelle. Si la pensée est complètement bloquée, mais qu’il faut donner une réponse, n’hésitez pas à tout mettre sur le compte de la volonté divine. Comme vous l’avez probablement deviné, nous ne prendrons pas ce chemin si simple.
Il s’avère donc que, d’une part, nous avons sans aucun doute des traces d’activité intelligente tout autour de nous, mais d’autre part, nous ne pouvons attribuer cette activité intelligente ni à nous-mêmes, ni à d’autres êtres humanoïdes. Ainsi, il ne nous reste rien d’autre que de renoncer à notre monopole exclusif sur l’intelligence. L’homme n’est pas le seul être intelligent dans l’univers. Il n’est même pas le seul être intelligent sur Terre. L’activité intelligente est l’une des choses les plus ordinaires dans notre monde, et nous ne sommes qu’un parmi une multitude d’êtres capables de l’accomplir. Cela peut sembler un fait plutôt triste à certains, mais personnellement, je n’y vois rien de déprimant. De plus, la possibilité de se sentir partie intégrante d’un grand processus de création, qui se déroule partout en ce moment à tous les niveaux de la réalité imaginable, peut être considérée comme une source inépuisable d’inspiration.
En biologie, il est généralement admis que toutes ces merveilles fascinantes dont j’ai parlé sont le résultat d’un processus évolutif. On peut le dire ainsi, mais cela ne change rien. En somme, il n’y a pas de différence particulière dans les mots que l’on utilise pour désigner ce qui se passe. Ce qui importe, c’est qu’il existe effectivement une activité intelligente qui ne peut être attribuée ni à l’homme ni à d’autres êtres anthropomorphes. Le concept d’« évolution » est extrêmement précieux pour nous, ne serait-ce que parce qu’il permet de déplacer la discussion sur la création des êtres vivants du domaine des contes de fées vers une perspective beaucoup plus utile. Mais nous devons comprendre que l’évolution n’est pas un sujet unique qui remplacerait Dieu, mais qui n’est pas Dieu. L’« évolution » n’est qu’un terme générique pour un ensemble de principes dont le fonctionnement à grande échelle et sur le long terme engendre l’auto-organisation de systèmes présentant tous les signes d’une activité intelligente.
Il serait maintenant bon de donner une définition de la raison, mais étant donné que ce sujet est actuellement très mythologisé, il serait sage de ma part de ne pas donner de définition, mais plutôt de tourner un peu autour du concept de « raison » et d’essayer de le relier à ce dont nous avons déjà appris à discuter. La première chose que l’on peut dire est que la raison est soit un outil de toute activité orientée vers un but, soit, en réalité, cette activité elle-même. C’est-à-dire que partout où se pose la question non seulement «pourquoiтак?», но и «Pourquoi.Ainsi ? Nous avons une raison à laquelle nous devons nous référer pour formuler une réponse à la question. Il n’est pas surprenant que, lors de la recherche d’un sujet auquel attribuer une activité raisonnable, nous rencontrions immédiatement des difficultés. Il se peut qu’il n’existe pas de sujet raisonnable, existant dans l’espace comme un tout. Mais cela ne devrait pas nous inquiéter outre mesure. Nous venons à peine de nous familiariser avec les sujets composés à travers les exemples de collectifs humains, et il serait absurde de s’étonner maintenant que l’on puisse également réfléchir aux collectifs d’autres êtres (y compris les écosystèmes et les espèces biologiques) comme à des êtres composés. Si un mécanisme d’adaptation n’a de sens que dans le contexte d’une communauté, alors nous pouvons parler de la communauté comme d’un être possédant un comportement raisonnable. Ces êtres ont-ils une conscience de soi propre ? Il est difficile de répondre à cette question de manière définitive. Si la communauté trouve utile, pour exercer son activité raisonnable, de manipuler le concept de sa propre identité, il n’est pas exclu qu’elle possède une certaine forme de conscience de soi. La conscience de soi d’autres êtres ressemble-t-elle à la nôtre ? En général, ce n’est pas nécessaire, mais si un être est un organisme localisé dans l’espace, menant une vie semblable à la nôtre, alors sa conscience de soi est probablement construite sur les mêmes principes que la nôtre.
Lorsqu’il s’agit du contact entre des êtres intelligents, il convient de garder à l’esprit que la communication qui nous est familière a une structure de transmission d’informations, c’est-à-dire une interaction par le biais de signaux basée sur une communauté de contexte. Si nous partageons un contexte commun avec un être quelconque, alors l’interaction est possible. En revanche, si le contexte commun fait défaut, l’interaction informationnelle devient impossible.
Moins nous partageons de contextes avec un autre être, plus cet être nous semble irrationnel. Nous considérons les chats, les chiens, les chevaux, les corbeaux et les dauphins comme des animaux très intelligents, mais, bien sûr, pas aussi intelligents que nous. Nous jugeons les poissons et les reptiles comme étant complètement stupides. Nous voyons les insectes comme des automates primitifs. Nous refusons même de considérer les plantes comme des êtres animés. En examinant des phénomènes tels que les symbioses, les écosystèmes et les espèces biologiques, nous ne sommes généralement pas capables d’objectiver de manière adéquate l’être en question. Il n’y a rien d’étonnant à ce que, sous l’emprise de l’illusion, nous nous positionnions comme le sommet de la création. Il est temps de se débarrasser de cette illusion. Dans l’univers, il n’y a ni haut ni bas. L’univers est isotrope. Oui, sans aucun doute, nous savons plus que tous les autres êtres, mais nous savons plus qu’eux uniquement ce qui se trouve à l’intérieur de notre scaphandre informationnel. Du point de vue de notre scaphandre informationnel, tout autre être est limité, mais il est essentiel de comprendre que le scaphandre informationnel d’un autre être dépasse les limites de notre monde, et sur cette zone qui se trouve au-delà, nous ne pouvons dire un mot.
Peut-on considérer comme des êtres raisonnables ces entités composées dont nous faisons partie ? Autrement dit, les « NOUSs ». Auparavant, nous avons établi que les sujets composés existent indéniablement. Ils ne peuvent exister que comme des systèmes. Par conséquent, ils possèdent des propriétés émergentes. Si une propriété émergente est un comportement orienté vers un but, dont la source de la finalité n’est pas entièrement centrée sur les sujets qui composent l’entité, cela nécessite… théorèmes sur la détermination des objectifs externes ), alors l’entité composite peut être considérée comme une entité raisonnable logiquement distincte des sujets qui la composent. Et, ce qui est important, cette entité peut jouer le rôle de source de détermination externe des objectifs pour les sujets qui la composent.
La nature et la manière d’exister d’un sujet composite ne peuvent pas être les mêmes que celles des sujets qui le composent. Il est donc possible d’affirmer que le monde intérieur du sujet composite (l’ensemble des concepts avec lesquels il opère en tant qu’entité unique) ne coïncide pas avec le monde intérieur des sujets qui le constituent. Cela implique que la communication entre un sujet et le sujet composite dont il fait partie est impossible. Nous, les humains, pouvons communiquer avec nos semblables. Mieux encore, avec d’autres personnes. Mais nous ne pouvons pas communiquer avec des collectifs de personnes. En nous adressant à un public rassemblé, nous prenons bien sûr en compte les caractéristiques de l’auditoire en tant qu’entité unique, mais la communication se fait précisément avec des individus, et non avec le collectif. De la même manière, en tant qu’êtres composites, nous ne pouvons pas communiquer avec les neurones, dont l’activité (la communication entre eux) produit un effet systémique que nous percevons comme notre propre esprit. Et il ne s’agit pas du tout du fait qu’un neurone isolé soit un être unicellulaire stupide. La raison principale est que ce monde étrange dans lequel vit un neurone et le monde dans lequel nous vivons nous-mêmes sont des mondes complètement différents. De même, on peut dire que les mondes dans lesquels existent des collectifs (familles, entreprises, sociétés, peuples, humanité) et les mondes de nous, êtres humains individuels, sont également des mondes différents. Nous pouvons influencer les collectifs. Nous pouvons même les créer et les détruire. Nous pouvons les étudier. Mais les comprendre comme ils se comprennent eux-mêmes, et communiquer avec eux de la manière et dans les langues qu’ils utilisent entre eux, nous ne le pouvons pas.
Personnel et public
Mon enfance et ma jeunesse ont coïncidé avec la période de vieillissement et de mort de l’URSS — un système politique qui proclamait la priorité inconditionnelle des intérêts collectifs sur les intérêts personnels. L’esprit de collectivisme imprégnait toute la propagande, depuis l’éducation des enfants dans les crèches jusqu’à la politique d’information de tous les médias sans exception. Cependant, il est possible de constater comme un fait évident que, malgré des efforts colossaux, le résultat a été une destruction profonde et à grande échelle des institutions sociales. En paroles, nous étions « tous ensemble », mais en réalité, il y avait une monstrueuse atomisation de la société. Chacun pour soi, l’homme est un loup pour l’homme. Comprendre les raisons d’un tel écart entre le souhaité et le réalisé est intéressant non seulement d’un point de vue historique (le passé est déjà passé), mais aussi parce que les erreurs logiques qui ont conduit à un résultat aussi désastreux n’ont pas disparu de la conscience collective, y compris dans les pays qui, dans un passé récent, n’ont pas souffert du totalitarisme.
Considérons les relations entre le sujet et la société dans laquelle il vit. La société, comme nous l’avons établi, peut être considérée comme un sujet collectif, doté de sa propre raison. Étant donné que l’homme fait partie de la société, il ne peut pas être pour celle-ci une source de détermination des objectifs. Le théorème sur la détermination externe des objectifs l’interdit. En revanche, la société peut et, semble-t-il, doit être une source de détermination des objectifs pour l’homme. Jusqu’à présent, notre raisonnement a été entièrement ancré dans cet esprit communiste qui n’a pas résisté à l’épreuve du temps. Puisque dans le calcul de la direction de la détermination des objectifs, il ne peut y avoir d’erreurs (comme le stipule le théorème), cela signifie que les erreurs apparaissent lorsqu’on essaie de déduire et d’appliquer dans la pratique les conséquences de ce raisonnement.
La première erreur est de tenter de remplacer la raison suprapersonnelle par la raison personnelle.
Comme cela a déjà été mentionné à plusieurs reprises, nous ne pouvons reconnaître l’existence de l’intelligence que chez des êtres similaires à nous. Nous souhaitons, et ce n’est pas sans raison, que la vie sociale soit organisée de manière rationnelle, mais nous ne pouvons pas percevoir l’intelligence chez des entités transcendantales. Cela nous désole beaucoup lorsque quelque chose qui dirige notre destin n’a pas de tête, et c’est pourquoi nous ressentons immédiatement le désirprendre la têteprocessus. Nous savons (ou, du moins, nous pensons savoir) comment tout devrait être organisé correctement. Nous avons la science, à laquelle nous avons appris à faire confiance, car elle donne, en général, des résultats prévisibles. Nous voulons tout faire selon la science et, en conséquence, obtenir de manière prévisible le résultat souhaité. Nous espérons trouver parmi les gens le plus intelligent, le plus honnête, le plus juste, le plus noble, afin qu’il dirige la société. Qu’il devienne sa tête, son cerveau, le point de prise des décisions les plus importantes.
En conséquence, la source de la détermination des objectifs pour l’entité suprapersonnelle « société » devient une de ses parties constitutives, ce qui, du point de vue du théorème sur la détermination externe des objectifs, est impossible. Une société dont la détermination externe des objectifs a été remplacée par une détermination interne cesse d’être un sujet d’action orientée vers un but. Elle perd sa propre raison. Tout se termine par le fait que cette détermination externe des objectifs, que le nouveau dirigeant recevait de la société, cesse également d’exister, et tout le monde découvre avec étonnement que ces merveilleuses qualités humaines, qui étaient observées chez le prétendant à un poste élevé, se sont évaporées après sa prise de fonction.
Après que la subjectivité propre de la société a été détruite, il n’est plus possible de parler de mythiques intérêts collectifs qui devraient primer sur les intérêts personnels. Un être mort n’a pas et ne peut avoir d’intérêts.
L’effet décrit ici s’est manifesté de manière particulièrement évidente lors de l’effondrement économique qui a eu lieu dans les dernières décennies de l’existence de l’URSS. Un pays doté de ressources naturelles luxueuses pour l’agriculture ne parvenait pas à se nourrir. Il n’y avait pas de grande guerre, pas de catastrophes naturelles, pas même de sabotage conscient. Simplement, une économie dirigée de manière centralisée avait cessé d’être un système vivant, nourrissant les citoyens du pays avec les fruits du travail de ces mêmes citoyens.
En conséquence, l’architecture de gestion dans laquelle une partie du système définit les objectifs et les tâches de développement de l’ensemble du système n’est viable que dans la mesure où elle ne gêne pas l’évolution naturelle de la situation. Autrement dit, dans la mesure où le système de gestion construit selon cette architecture n’est pas exploité.
Il faut dire que la question même de la priorité des intérêts publics sur les intérêts personnels, malgré toute sa correction théorique, est d’une rare perversion. En tant qu’êtres humains, nous pouvons facilement formuler notre propre intérêt, tandis que la formulation de l’intérêt d’un être fondamentalement différent (et non humanoïde) ne peut même pas être exprimée dans un langage humain. Il en ressort que seule une système suprapersonnel, fondé sur les principes de l’égoïsme raisonnable, est efficace et vivant : les gens s’occupent de leurs affaires, les systèmes suprapersonnels des leurs, et la bonne répartition des rôles n’est nulle part violée.
La deuxième erreur est le remplacement des mécanismes structurants par des mécanismes inadaptés à la structuration.
Supposons que nous ayons compris que le commandement unilatéral sur des entités suprapersonnelles conduit systématiquement à des résultats désastreux. À bas l’autoritarisme, vive la démocratie. Tout le pouvoir au peuple. Cette fois-ci, vraiment, et non pas de manière fictive, comme c’était le cas sous les communistes. La première (et malheureusement la dernière) chose qui vient à l’esprit lorsqu’on aborde la question de la prise de décision collective, c’est le vote. Supposons même que nous ayons compris que les élections (la désignation d’un dirigeant par le biais d’un vote) ne constituent pas un pouvoir populaire, mais sont simplement une forme d’autoritarisme soigneusement déguisée, qui détruit la subjectivité des entités suprapersonnelles aussi efficacement que n’importe quelle autre méthode de détournement de l’objectivation des objectifs. Donc, la démocratie directe. Toutes les décisions importantes concernant la vie de la société sont soumises à des référendums. La procédure et le soutien technique des référendums sont organisés de manière à exclure toute manipulation. Le bonheur viendra-t-il ? Essayons d’analyser.
L’entité suprapersonnelle est un système composé de personnalités. Comme tout système, elle est quelque chose de plus que la simple somme de ses parties. En réalité, ce qui en fait un système ce sont les effets systémiques qui se produisent en plus du résultat de l’opération de simple addition. Tout vote est une opération de simple addition. Par conséquent, on ne peut en aucun cas parler du résultat d’un vote comme d’une décision prise par un système suprapersonnel. Le vote est une procédure par laquelle la source de la détermination des objectifs pour la société devient une simple formule mathématique. Ainsi, ce que l’on appelle la démocratie directe détruit la subjectivité des entités suprapersonnelles aussi efficacement que l’autoritarisme.
La résolution des questions par le vote peut être recommandée comme un outil dans les situations où il est nécessaire de détruire rapidement et efficacement une entité suprapersonnelle. En effet, les entités suprapersonnelles ne sont pas toujours bienveillantes, positives et agréables sous tous les aspects. Parmi elles, on trouve des entités particulièrement répugnantes, que l’on ne peut qualifier autrement que de parasites, voire de prédateurs. Si les mécanismes de défense intégrés de la société ne réagissent pas à temps et qu’un processus inflammatoire à grande échelle commence, avec un risque substantiel de décès, l’application de la démocratie directe peut devenir le moyen de détruire la subjectivité du parasite, après quoi il sera possible, dans un cadre calme, de restaurer rapidement et sans douleur les destructions qu’il a causées. Le vote est une méthode simple à mettre en œuvre et efficace pour clore les discussions publiques. Si une question doit être fermement close, en obtenant une décision que personne ne sera vraiment pressé d’exécuter (puisque la discussion est close et archivée), alors le vote est le mécanisme le plus efficace.
Si la tâche n’est pas de détruire des entités transpersonnelles, mais de les cultiver, il faut apprendre à travailler avec des mécanismes qui ne détruisent pas la systématicité, mais qui la forment.
Liberté et société
On dit qu’il est impossible de vivre en société et d’en être libre. Ce n’est pas seulement un mensonge. C’est une formulation monstrueusement déformée de la question, qui aboutit à une réponse extrêmement destructrice à une question importante.
La liberté est l’un des concepts les plus soigneusement calomniés. Le mensonge sur l’inadmissibilité de la liberté repose sur une substitution de l’essence et de l’application de ce concept. Chaque fois que la liberté est mentionnée, l’accent est mis sur le fait de soustraire le sujet à l’exécution de ses obligations. C’est incorrect. L’accent devrait être mis sur l’élimination des obstacles à l’exécution des obligations. La liberté, c’est avant tout non«liberté de…», a.«liberté pour…»Il n’est pas nécessaire de parler de «libération» du sujet par l’élimination de ses sources d’objectifs externes. L’essence même de la liberté de volonté réside dans la concurrence de nombreuses sources d’objectifs au sein du système désigné comme «sujet».
La pluralité, la multidimensionnalité et la force créatrice de la société reposent sur le fait qu’elle est composée de sujets qui, par leur activité intentionnelle, façonnent l’avenir. Un être qui a perdu son orientation externe vers un but n’est pas capable de créer l’avenir. Un esclave dont toute l’orientation vers un but est entièrement centrée sur une seule source n’est pas non plus capable de créer l’avenir, même si cette source est la société elle-même.
Formulation correcte :Il est impossible de vivre dans une société etне.être libreдля.него..
Les conclusions du chapitre
- Sujets composés— ce n’est pas un mythe. Leur existence se justifie facilement par une justification situationnelle. Chaque fois que nous désignons notre activité au sein d’un groupe, nous introduisons nécessairement dans la réflexion une entité suprapersonnelle (sujet composite) « nous ».
- Même avec un nombre relativement restreint de sujets, on observe une explosion combinatoire du nombre de sujets composés.
- Un sujet composite est physiquement une simple somme de ses sujets constitutifs, mais logiquement, il ne l’est pas. La systématicité du sujet composite réside précisément dans le fait que le résultat diffère de la simple somme des éléments constitutifs.
- Pour qu’ils soient des parties d’un sujet composite, il n’est pas nécessaire que les sujets soient présents dans une même zone de l’espace. Lorsque nous parlions de systèmes dans… chapitre 4 la exigence selon laquelle les éléments du système devaient nécessairement interagir entre eux a été jugée superflue.
- Il existe une série d’effets (en particulier, l’humour, l’argent, l’amour ont été examinés) dont une réflexion approfondie nécessite de postuler l’existence d’un sujet composite.
- Un sujet composite peut être une source de détermination externe des objectifs pour un sujet qui en fait partie.
- Une partie d’un sujet composite ne peut pas être une source de détermination externe des objectifs pour celui-ci.
- Le comportement intentionnel (raisonné) ne devrait pas être considéré comme un monopole exclusif des êtres humains et des animaux « supérieurs ». L’intelligence est un phénomène beaucoup plus répandu dans notre monde qu’on ne le pense généralement.
- La conception habituelle de l’oligarchie (sous toutes ses formes, de la monarchie à la « démocratie » élective) semble contenir une contradiction logique irréductible.
- La conception habituelle de la démocratie directe, réalisée par le biais du vote, semble être extrêmement destructrice pour la société et doit être considérée uniquement comme un outil efficace utilisé pour détruire la systématicité suprapersonnelle.
- On ne peut pas vivre en société sans en être libre.
Chapitre 7. Formation des systèmes
Ce chapitre a un caractère purement appliqué, et aucune nouvelle conception fondamentale ne sera introduite ici.
Auto-organisation
En résumé, la question de la formation des systèmes peut être formulée de la manière suivante :Quelles sont les raisons de l’apparition et du bon fonctionnement des acteurs agissant de manière ciblée ?
Toute question sur les raisons, lorsqu’elle passe du domaine de la simple curiosité à celui de l’intérêt pratique, se divise automatiquement en deux questions particulières concernant la création et la prévention. Dans ce cas, les questions peuvent être formulées ainsi :
- Que faut-il faire pour que, selon notre souhait, des entités agissant de manière ciblée apparaissent et fonctionnent avec succès là où leur présence est souhaitable pour nous ?
- Que faut-il faire pour prévenir l’apparition et/ou le bon fonctionnement de ces acteurs ciblés que nous ne souhaitons pas ?
La première question est beaucoup plus intéressante que la seconde, car la réponse à la première question contient en grande partie la réponse à la seconde.
Il se trouve que l’examen du problème de l’auto-organisation commence traditionnellement à partir de la position « à partir de zéro », c’est-à-dire avec la tentative de trouver des moyens de transformation spontanée du chaos mort en un ordre vivant et auto-entretenu. Il y a sans aucun doute un certain intérêt théorique à cela, mais en y regardant de plus près, il s’avère que cet intérêt n’est pas aussi grand qu’on le pense généralement. Cela est principalement lié au fait que dans les questions commençant par les mots«Que faut-il faire pour que…»Il est déjà a priori supposé qu’un certain ordre vivant a émergé du chaos mécaniste initial. Ne serait-ce qu’à travers nous.
Nous créons et soutenons.
En parlant de la création de systèmes, partons du principe qu’il existe déjà un sujet (par exemple, nous, pensants et existants) qui a une intention externe (sinon, cela n’existe pas) et qu’il y a une certaine situation de départ. Le résultat souhaité n’est pas directement atteignable, dans le style « venir et prendre ». Schématiquement, cela peut être représenté ainsi :
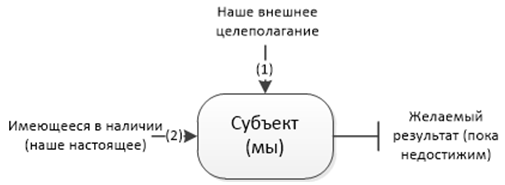
État initial pour la formation de systèmes
En ce qui concerne l’information, « ce qui est disponible » est un ensemble de signaux entrant par la flèche (2), tandis que « la détermination des objectifs externes » est le contexte entrant de l’extérieur par la flèche (1). En se combinant, ils fournissent de l’information, et cette information est pour l’instant peu encourageante.
La notation constructiviste est similaire à la notation IDEF0, et ce n’est pas surprenant. En effet, elle suppose également que le résultat est obtenu par la combinaison des données d’entrée, représentées par une flèche entrant dans le bloc à gauche, et du flux de contrôle, représenté par une flèche venant du haut. Idéalement, cette approche s’accorde assez bien avec la construction « signal + contexte ».
Je remarque tout de suite que dans ce schéma, le sujet n’est pas nécessairement un être vivant dans toute sa plénitude. Les prémisses de départ, la définition des objectifs et le résultat souhaité peuvent très bien n’être qu’un aspect particulier de cette plénitude que nous appelons notre vie.
La première chose qui vient à l’esprit dans une telle situation est de trouver un outil inanimé approprié et de résoudre le problème avec. Un marteau, une hache, une pelle, des allumettes, une calculatrice, une feuille de papier, ou autre chose. En fonction du problème à résoudre. Voici ce que ça donne :

Acquisition de l’outil
Un sujet élargi est apparu, qui ne diffère fondamentalement en rien du sujet initial. Un marteau comme prolongement de la main, une feuille de papier comme dispositif de mémoire externe. L’image ne rappelle pas seulement fortement la construction « sujet contrôlant / objet contrôlé » adoptée en cybernétique au 20ème siècle, elle en est en réalité une. Le sujet est le système de contrôle, l’outil est l’élément contrôlé, la flèche (3) représente le signal de contrôle, et la flèche (5) indique le retour d’information.
Idéalement, une flèche devrait également partir du sujet vers le résultat souhaité (par exemple, pendant qu’une main enfonce un clou avec un marteau, l’autre main tient ce clou), mais elle a été omise pour ne pas compliquer le schéma.
Si au lieu d’atteindre un résultat par le biais d’un outil insensible, nous décidons de résoudre le problème en asservissant quelqu’un, alors le tableau sera le suivant :
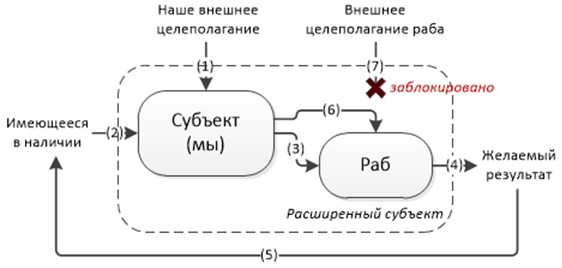
L’acquisition d’un esclave
Pour éviter les malentendus, je tiens à préciser tout de suite que l’esclave n’a pas nécessairement à être un être à deux jambes. Un esclave peut être un quadrupède, une plante, un organisme unicellulaire, ou même quelque chose d’incorporel (comme un écosystème), ou tout autre chose. Cela ne change rien à la nature de ce qui se passe. De plus, l’esclavage peut ne pas être total, mais temporaire, de huit heures à cinq heures avec une pause déjeuner.
La situation est globalement similaire à celle de l’utilisation d’un outil inanimé, sauf que nous devons maintenant non seulement commander notre outil (flèche 3), mais aussi le motiver (flèche 6). Autrement dit, nous devons lui organiser un objectif externe. Et n’oublions pas de bloquer l’objectif externe qu’il avait par nature (flèche 7). Si nous laissons un peu de l’objectif naturel de l’esclave, le résultat souhaité sera une interférence de deux objectifs. Nous n’attendons pas cela d’un outil qui exécute sans réserve notre volonté et seulement notre volonté.
Si l’esclave est un système artificiel, alors il n’a aucun objectif « naturel » et il n’y a rien à bloquer.
Puisque dans la construction obtenue, il ne reste que notre objectif en tant qu’élément actif, il n’est pas question de l’apparition d’un sujet composite, et il n’y a toujours qu’un sujet élargi.
De la même manière que dans le schéma précédent, la flèche allant du sujet au résultat souhaité n’est pas représentée, alors qu’elle sera toujours présente si le sujet et l’esclave travaillent ensemble sur le résultat désiré.
Le scénario de « l’acquisition d’un esclave » ne doit pas être confondu avec l’aide volontaire. Dans le cas de l’aide volontaire, il n’est pas nécessaire de bloquer l’objectif existant de l’employé, et donc, bien que la situation de bénévolat puisse formellement ressembler à l’utilisation d’une personne comme un outil, elle ne constitue pas une situation d’esclavage.
On peut remarquer que l’esclavage est une occupation plutôt pénible. Il ne suffit pas seulement de commander un esclave, il faut aussi s’occuper de sa définition des objectifs. Peut-être que le processus pourrait être automatisé d’une manière ou d’une autre ? Par exemple, si un esclave bien éduqué et parfaitement formé pouvait lui-même recevoir nos objectifs et agir correctement ? Une option intéressante serait de créer soit un sujet entièrement artificiel, c’est-à-dire d’amener l’automatisation de l’exécution des tâches à la perfection. Ou bien de créer une structure suprapersonnelle (l’esclave n’a pas nécessairement à être un être multicellulaire vivant, il peut tout à fait être une « souris » bien éduquée), qui garantirait une satisfaction acceptable des besoins pour tous. Résultat :
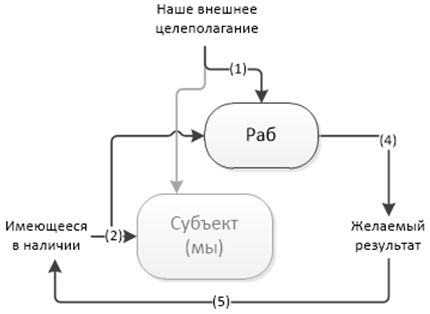
Délégation de tâche
Processus entièrement automatique. Nous avons bien travaillé, créé l’esclave idéal, et maintenant nous obtenons le résultat souhaité sans fournir d’efforts supplémentaires. La vie est belle. Ou peut-être pas tout à fait ? On a l’impression d’avoir dû sacrifier quelque chose. En particulier, soi-même. Nous sommes passés de sujets d’action déterminés à observateurs paisiblement contemplatifs. Peut-être vaut-il la peine de se rappeler que nous sommes aussi capables de faire quelque chose, de faire pousser une flèche du côté droit et de diriger… vers où ? Vers le résultat souhaité — ce n’est pas nécessaire. Nous avons un très bon esclave, et il s’en sort très bien tout seul. Peut-être devrions-nous diriger la flèche vers l’esclave ? Mais pourquoi faire ? Il a toutes les données de base, ainsi que la capacité de se fixer des objectifs. Nous ne pouvons rien ajouter à ce que l’esclave possède déjà. Avec nos « instructions précieuses », nous ne ferons que le gêner. Sur tous les critères formels, tout va bien (nous avons obtenu et continuons à obtenir le résultat que nous recherchions), mais en réalité, nous avons cessé d’exister.
Un esclave, fatigué de lutter seul contre ses problèmes, engage un autre esclave, et cela donne une telle image :
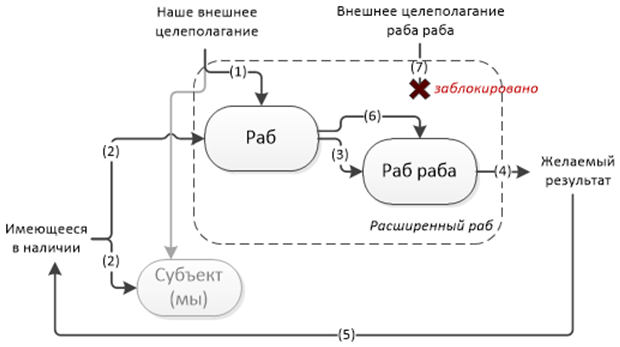
Un agent de police protège la tranquillité des citoyens.
Oui, c’est exactement ça. Un agent de police, protégeant la tranquillité des citoyens. Dans le rôle de l’esclave se trouve le gouvernement que nous avons créé, et dans le rôle de l’esclave de l’esclave se trouve l’agent de police. Nous avons délégué la responsabilité de notre sécurité au gouvernement, et nous avons obtenu ce que nous voulions. Maintenant, dans le cadre de l’objectif « sécurité », nous avons cessé d’être des sujets. Dans ce schéma, il est intéressant de noter qu’il représente l’image de ce qu’elle serait si tout était fait de manière absolument correcte et fiable. En réalité, le gouvernement, en plus de la délégation des objectifs, a également un certain volume d’objectifs supplémentaires, que l’on peut qualifier de « intérêts corporatifs ». De plus, l’objectif propre de l’agent de police n’est jamais complètement bloqué. En conséquence, nous, citoyens, obtenons quelque chose d’inconnu, en payant un prix monstrueux pour cela.
Il convient de noter dès le départ que la formation des États, autant que je sache, n’a jamais suivi le scénario du «délégation». Partout où les gouvernements déclarent servir soi-disant «le peuple», il y a une bonne dose de duplicité. Les relations entre le peuple et l’État se construisent selon d’autres scénarios, qui seront examinés ci-dessous.
La deuxième chose intéressante dans cette image est que le « esclave élargi » n’est constructivement pas différent du « sujet élargi » dans l’image « La découverte de l’esclave ». Par conséquent, la situation tend à évoluer vers une délégation de tâches, où l’esclave perd sa subjectivité, et le seul acteur devient l’esclave de l’esclave. Nous avons une structure auto-copiante. L’asservissement est remplacé par la délégation, la capture de la subjectivité et le passage au cercle suivant. Le système acquiert de nouveaux esclaves et éjecte les anciens maîtres du processus, leur retirant la capacité de fixer des objectifs. Certains sujets sont entraînés dans le système, tandis que d’autres sont expulsés. On peut supposer que les anciens maîtres expulsés sont les meilleurs candidats pour devenir de nouveaux esclaves. N’ayant pas complètement oublié la finalité perdue, ils accepteront plus facilement que d’autres êtres la nouvelle finalité de substitution de leur nouveau maître.
Je préférerais ne pas porter de jugement moral sur ce qui se passe. Il est simplement nécessaire de comprendre que le scénario décrit se produit et qu’il fait partie des schémas de développement de situation assez répandus. On peut même supposer que nous sommes en grande partie le résultat d’une chaîne complexe, longue et multi-étapes de délégations, qui s’est déroulée à travers de nombreux aspects de la vie. Mais la logique du schéma auto-réplicant est telle qu’après avoir été au sommet du processus et avoir apporté notre contribution subjective, nous risquons de devenir nous-mêmes des spectateurs du processus, devenus d’anciens maîtres de la vie. Et ensuite, la perspective est soit l’oubli, soit le retour à l’esclavage. Les habitants des pays développés ont déjà avancé plus loin que les autres sur le chemin de la délégation des tâches. La production de nourriture, l’aménagement domestique, la formation des notions de bien et de mal (cela s’est produit même avant beaucoup d’autres choses), la sécurité, le soin de sa propre santé, et même la procréation ont déjà été délégués. Il ne reste que des fragments épars de l’initiale visée extérieure naturelle, temporairement non interceptés par les serviteurs que nous avons créés. Les auteurs de science-fiction nous ont effrayés en disant que l’intelligence artificielle que nous avons engendrée mènerait une guerre d’extermination contre nous. Mais une telle issue est extrêmement peu probable. Il est beaucoup plus probable que la Matrice satisfera tous les besoins avant même que l’homme n’ait le temps d’y penser, et que Skynet éliminera tout inconfort avant même qu’il ne se manifeste. C’est confortable. C’est pratique. C’est rassasiant. On n’a pas envie de revenir à un endroit où il fait faim, froid et dangereux. Et de ma part, ce serait un immense manque de respect d’appeler à ramener l’humanité à un mode de vie primitif pour que tout le monde ait la possibilité de se divertir avec la pauvreté, les maladies et les guerres.
Heureusement, les stratégies de « servitude » et de « délégation » ne sont pas les seules manières de former des systèmes. De plus, il est facile de constater que ces stratégies ne conduisent pas à la formation de sujets composés, incluant le sujet qui existait à la première étape. Au maximum, ce qu’elles permettent d’atteindre, c’est l’émergence d’un sujet élargi. Un sujet composé apparaît là où la coopération se manifeste.
Considérons d’abord, dans un certain sens, le cas dégénéré — une situation dans laquelle les sujets travaillent pour un résultat commun, mais sans interagir informativement entre eux :
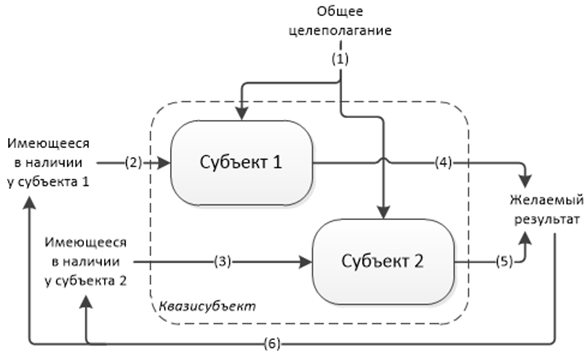
Stratégie «si tout le monde…» (ou, en variante, «si personne…»)
Dans ce cas, le résultat souhaité n’est pas atteignable par un seul acteur, mais il est facilement réalisable grâce aux efforts de deux acteurs. L’acteur 1, guidé par l’objectif (1) et ce qu’il a à sa disposition (2), apporte sa contribution (4) à l’effort commun et en tire un profit (6). L’acteur 2 agit de la même manière. Tout le monde est satisfait, le résultat est atteint. Pour un observateur extérieur, regardant l’ensemble « acteur 1 + acteur 2 », il peut avoir l’impression que le système fonctionne. En principe, il n’est pas très éloigné de la vérité. Ce « boîte noire » produit certainement un effet systémique, et il n’y a rien d’étonnant à cela. Bien que les acteurs n’interagissent pas directement entre eux, il y a tout de même une interaction à travers le résultat souhaité et le retour d’information. Du point de vue de l’acteur participant au processus (acteur 1 ou acteur 2), la systématicité de ce système n’est pas si évidente. Il sait que chacun agit de son côté.
Les problèmes liés à une telle organisation des affaires sont généralement au nombre de deux :
- De tels systèmes ne parviennent pas à se former. Le sujet 1, en entrant sur le terrain, évalue sobrement ses capacités et conclut que le résultat est inatteignable. Dans ce cas, son activité ciblée devient donc inutile. Il en va de même pour le deuxième sujet. Ces systèmes peuvent en principe se former lorsque l’ampleur du problème augmente progressivement. Au début, le premier sujet qui arrive s’en sort, puis, lorsqu’il n’y parvient plus mais n’a pas encore pris la décision d’abandonner, un deuxième sujet apparaît.
- De tels systèmes sont instables. Dès que l’effort requis pour atteindre un objectif commence à dépasser les capacités d’un des participants, il abandonne presque immédiatement cette tâche désespérée, et le processus de désintégration s’accélère alors de manière exponentielle. Un autre danger pour un tel « système » est la diminution temporaire des besoins en efforts. Dès que quelqu’un réalise que tout fonctionne sans lui, il s’éloigne pour s’occuper d’autres affaires, et lorsqu’il revient après un certain temps, il découvre avec étonnement qu’il est parti pour rien et qu’il est revenu trop tard.
Chaque fois que nous nous abandonnons à des rêves oisifs sur ce que ce serait bien si tout le monde agissait correctement, nous comptons sur une formation systémique selon le scénario décrit ici. En vain. Même si cela se produit, c’est pour très peu de temps. « Si tout le monde nettoyait derrière lui et ne jetait pas de déchets… », « si tout le monde respectait le code de la route… », « si personne ne volait… », « si tout le monde votait pour le bon candidat… », « si tout le monde travaillait pour le bien commun… » — ce ne sont que des rêves de formation systémique sans formation systémique. Il est plus simple de reconnaître que cela n’existe pas dans la vie réelle que de perdre du temps à attendre vainement un miracle.
Pour rendre le schéma plus stable, il est nécessaire de faire en sorte que les sujets commencent à communiquer entre eux. Nous ajoutons le transfert de données du sujet 1 au sujet 2 et vice versa :
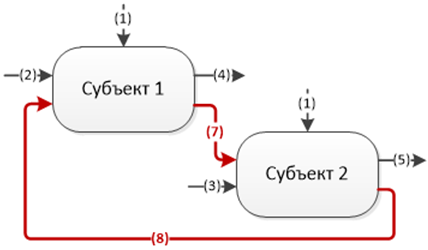
Nous avons établi la transmission de données entre les entités.
Malheureusement, cette nouveauté ne nous apportera rien de concret. Nous avons réussi à transmettre le signal, mais il n’y a pas de contexte pour lui, et par conséquent, le signal ne devient pas une information. Le contexte qui existait auparavant n’est pas adéquat, car il ne concerne pas la communication avec des semblables, mais plutôt le désir d’obtenir un résultat. De plus, il est totalement incompréhensible ce qui pousse le sujet 1 à émettre le signal (7) et le sujet 2 à émettre le signal (8). Pour résoudre ces problèmes, il est nécessaire de fournir aux sujets des contextes supplémentaires :
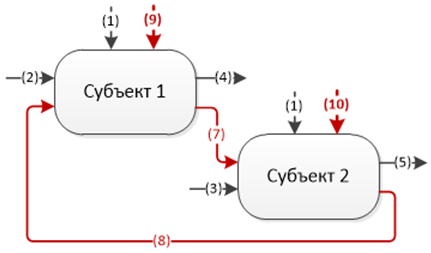
Ajouté des contextes.
Le contexte (9) permet au sujet 1 d’interpréter les signaux (2) et (8) et non seulement de produire le signal (7), mais aussi, en se superposant au contexte (1), d’influencer le signal sortant (4), qui forme le résultat souhaité. De la même manière, le contexte (10) fonctionne chez le sujet 2. Les contextes (9) et (10) peuvent être le même contexte, mais peuvent aussi être différents.
La principale différence entre les flèches contextuelles et les signaux réside dans le fait qu’elles ne proviennent pas de l’extérieur. Un signal est en effet quelque chose qui agit sur le sujet depuis l’extérieur de ses limites, mais le contexte n’est pas un signal, c’est une information qui est à son tour une construction « signal + contexte ». Ainsi, l’arrivée du contexte de l’extérieur est une certaine convention. Du point de vue de la manière dont le sujet lui-même comprend ce qui se passe, le contexte entrant est effectivement quelque chose qui est « donné » de l’extérieur, mais en réalité, le contexte est un élément de la contraction du sujet. Étant donné que l’ensemble de la construction doit finalement fonctionner de manière cohérente, il est nécessaire que les contextes (9) et (10) soient en adéquation. De plus, cela doit se produire deux fois : le signal (7), généré à l’aide du contexte (9), doit être compréhensible dans le contexte (10), et le signal (8), généré à l’aide du contexte (10), doit être compréhensible dans le contexte (9). Le fonctionnement de l’interaction des sujets est un effet systémique des mécanismes qui forment les contextes (9) et (10). Par conséquent, leur ensemble peut être considéré comme un système unique, faisant partie du sujet composite :
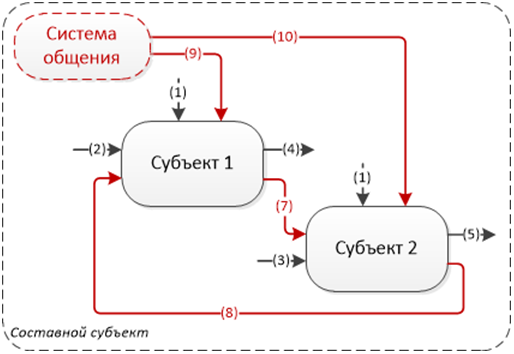
Nous avons ajouté une systématique des contextes d’interaction des sujets.
On pourrait ne pas entourer le système ajouté d’un trait pointillé, car de toute façon, les frontières rigides des sujets et leur localisation, où qu’elles soient, restent toujours une convention.
Il est évident que notre système de communication ressemble à un être imparfait. Les signaux sortants existent, mais d’où peuvent-ils provenir ? Pour que le système émette des signaux cohérents, il est nécessaire qu’il ait un objectif et des données de base. En ce qui concerne les données de base, tout est clair : à part les flèches (2) et (3), il n’y a rien d’autre. En tant qu’objectif, on peut essayer de prendre l’objectif initial des sujets, mais cela ne donnera pas de bons résultats. Cela signifierait que pour le tireur (9), c’est le résultat du travail dans le contexte (1) du signal (2) plus, d’une manière mystique, le signal (3) reçu par le sujet 2. Une telle mystique ne peut exister, car pour obtenir le signal (3) par le sujet 2, nous avons déjà la flèche (8), mais elle ne fonctionnera pas sans le contexte (9). Si le fonctionnement du système de communication nécessite un contexte qui ne peut être obtenu à l’intérieur du système considéré, cela signifie que nous devrons le prendre de l’extérieur. Le schéma résultant du travail collaboratif des sujets interagissant pour un résultat commun :
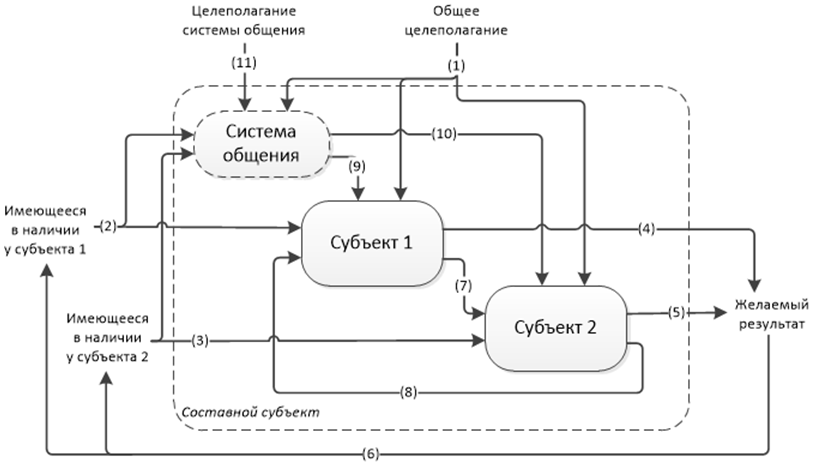
Travail collaboratif pour un résultat commun
Ce qui est intéressant, c’est que ce schéma ne s’effondrera pas si l’on supprime complètement l’objectif commun (1), en déléguant toute l’obtention du contexte externe à l’objectif du système de communication :
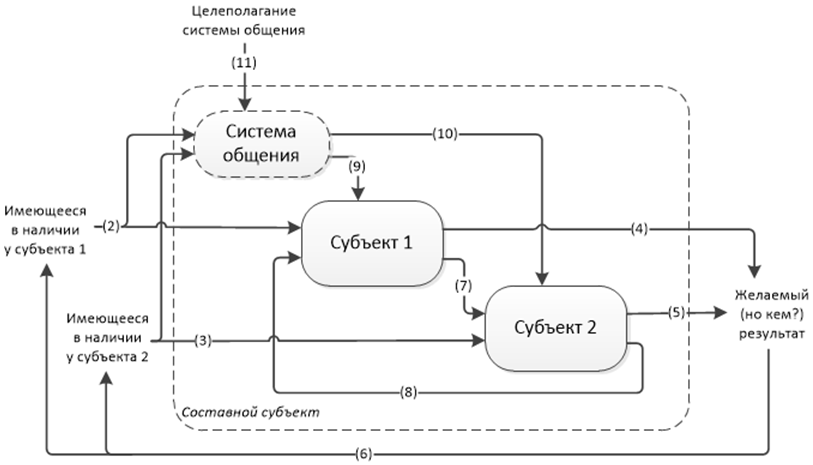
Communication précieuse
Les sujets agissant de manière subjective percevront la situation comme un désir fort d’interagir les uns avec les autres. Peut-être qu’ils inventeront même une explication logique à cela pour se rassurer, mais ce n’est ni nécessaire ni important.
Voyons ce qui se passe si les sujets en interaction ne travaillent pas pour un objectif commun, mais chacun pour son propre résultat. Les sujets restent, mais chacun a son propre objectif. Le système de communication demeure. Les résultats souhaités deviennent deux. Le bénéfice pour les sujets (la motivation à entrer en interaction) peut se réaliser de deux manières :
- Le résultat du travail de chaque sujet n’est pas seulement son propre résultat souhaité, mais aussi le résultat souhaité de son camarade. C’est la situation du « toi pour moi, moi pour toi ».
- Chacun travaille uniquement pour son propre résultat, mais l’obtention du résultat souhaité par chaque individu contribue à améliorer la qualité (et donc l’utilité) de ce qui est disponible non seulement pour lui-même, mais aussi pour ses camarades. La situation « la prospérité de tous est la garantie de la prospérité de chacun ».
La combinaison des options 1 et 2 est caractéristique d’un symbiose harmonieuse bien établie.
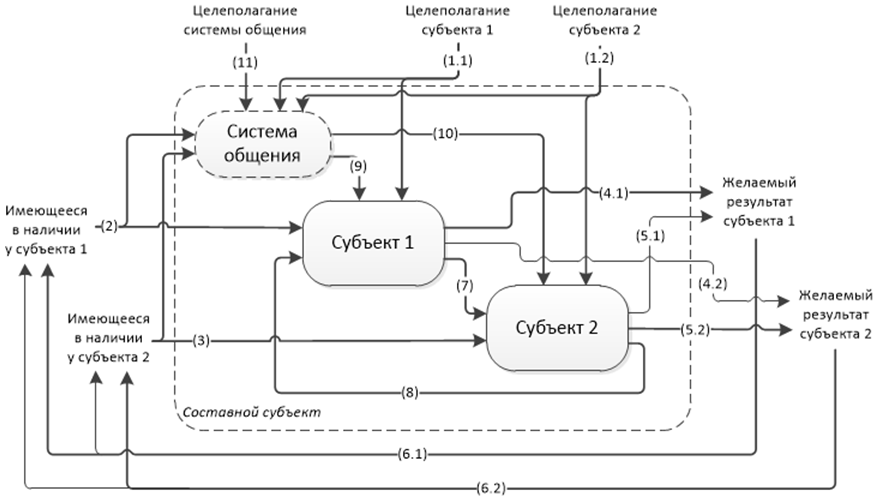
Symbiose harmonieuse
Les résultats ont pu être au nombre de deux uniquement parce que chaque sujet a défini son propre objectif, ce qui a conduit à deux faisceaux de flèches entrants au lieu d’une seule flèche (1) : (1.1) et (1.2).
Contrairement au scénario «Si tout», les scénarios «Communication auto-valorisante» et «Symbiose» ne sont pas particulièrement sensibles à l’absence temporaire de la possibilité d’obtenir les résultats souhaités. Les sujets ne sortent pas du processus, mais continuent à communiquer (flèches 7 et 8). En principe, le système peut rester stable pendant des siècles, à travers la vie de nombreuses générations. Par exemple, les partisans de certaines religions attendent année après année l’accomplissement d’une prophétie, s’y préparent assidûment, et ne s’inquiètent pas vraiment du fait qu’elle ne se réalise pas.
Le résultat du symbiose peut (et doit) être considéré comme un sujet composite, qui possède un ensemble d’objectifs, un ensemble de ressources et des résultats atteignables. Par la suite, ce sujet composite peut déjà, en tant qu’entité autonome, s’intégrer dans une formation systémique selon l’un des scénarios examinés ici.
Il est évident que le schéma s’est avéré trop complexe pour émerger spontanément dans son intégralité à partir de rien. Cependant, l’existence de symbioses harmonieuses est un fait observé partout dans le monde vivant, et il ne nous reste d’autre choix que de déterminer comment de telles constructions complexes peuvent émerger à partir de plus simples. Prenons par exemple comment une symbiose peut naître de l’interaction entre un prédateur et une proie. Au début du processus, nous avons une proie potentielle et un prédateur affamé (les flèches sont numérotées de manière à obtenir ensuite une image similaire au scénario « Symbiose ») :
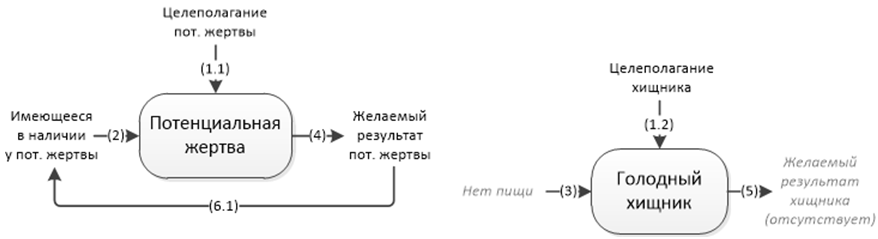
Victime potentielle et prédateur affamé
Trouvant une proie, le prédateur lui prend le résultat :
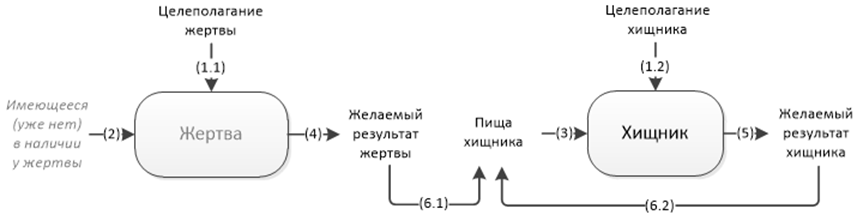
Le prédateur a mangé sa proie.
Le pur prédation n’est pas une stratégie très avantageuse, car la sélection naturelle agit contre le fait que les proies potentielles restent des cibles faciles. Le seul moyen pour un prédateur d’inhiber l’évolution défavorable de ses proies est de cesser de les tuer. Autrement dit, il doit cesser d’être un prédateur pour devenir un parasite :
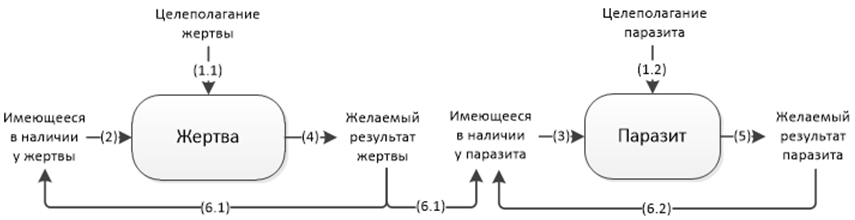
Parasitisme
À ce stade, la victime et l’ancien prédateur se retrouvent face à une tâche à résoudre ensemble : faire en sorte que le parasitisme ne se transforme pas à nouveau en prédation. Le seul moyen d’y parvenir est d’établir un canal de communication par lequel la victime signalera au parasite que la ressource dont elle dispose a diminué de manière critique. Une flèche de signalisation (7) se forme de la victime vers le parasite, ainsi qu’un contexte nécessaire à l’interprétation du signal (10). Et comme l’interaction informationnelle unidirectionnelle est inefficace, un canal de retour apparaît (flèche 8) ainsi que le contexte qui lui est associé (9). En ayant des contextes informationnels synchronisés pour la victime et le parasite, nous sommes contraints de constater la formation d’un système de communication et d’un sujet composite. Résultat :
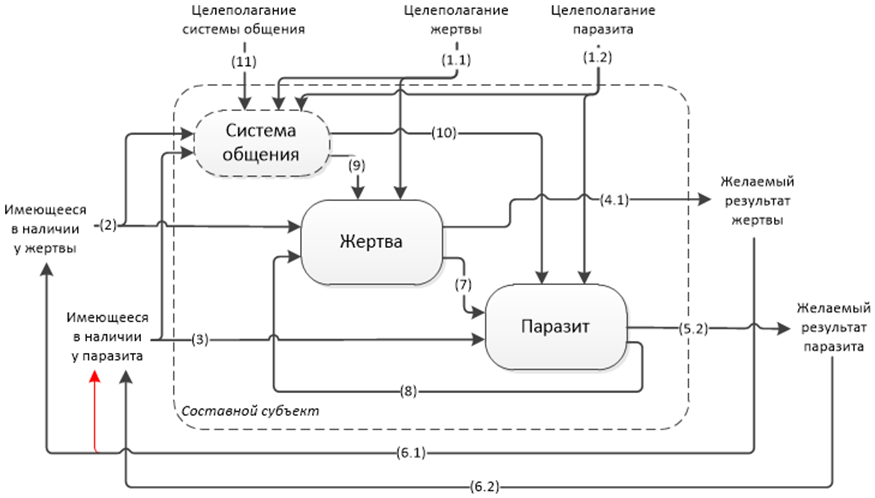
Parasitisme éclairé
La flèche, pour laquelle tout cela a été entrepris, est mise en évidence en rouge. Avant d’atteindre le symbiote, il reste à faire en sorte que le résultat de l’activité du parasite devienne bénéfique pour la victime et/ou à inclure un travail collaboratif sur les résultats souhaités. Lorsque cela se produit, il ne faut plus parler des participants au processus comme de victimes et de parasites. Ils deviennent des symbiontes.
Si l’on examine les relations entre la société civile et l’État, il est évident que dans ce cas, l’État apparaît toujours d’abord comme une bande de voleurs prédateurs, et ce n’est qu’au fur et à mesure que la situation évolue que le processus se transforme en un parasitisme plus ou moins tranquille. Certains des États les plus développés que l’on observe actuellement ont déjà réussi à surmonter leur propre avidité et à adopter un modèle de parasitisme éclairé, avec des éléments de relations symbiotiques.
En principe, le processus inverse est également possible — du symbiose au parasitisme, puis à un pur prédation. Mais on peut affirmer qu’en général, le vecteur de développement dominant tend vers la symbiose, car d’un point de vue de la sélection naturelle, cela est plus avantageux. À long terme, si la valeur des résultats souhaités cesse d’être évidente pour les symbiontes eux-mêmes, le scénario « Symbiose » pourrait se transformer en un schéma de « Communication auto-valorisante ».
Dans les schémas présentés, les entités les plus mystérieuses et donc les plus intéressantes sont sans aucun doute les systèmes de communication. Bien qu’ils se réalisent physiquement sous la forme de sous-systèmes d’acteurs interagissant, nous avons néanmoins tout à fait le droit de les considérer comme des systèmes possédant une intégrité. En outre, il y a toutes les raisons de supposer que pour les systèmes de communication dotés de la fonction d’auto-reproduction, il est courant de recruter des acteurs dans des relations symbiotiques. Ou même, pas tant de recruter que de les cultiver de manière ciblée.
Du point de vue du sujet participant à des relations symbiotiques (c’est-à-dire de l’intérieur du système), le fonctionnement du système de communication apparaît comme la présence d’une finalité supplémentaire, étroitement liée à la satisfaction de la finalité initiale pour laquelle le système a été créé. En particulier, un exemple frappant de relations symbiotiques est l’économie de marché. Lorsqu’un sujet entre dans des relations marchandes, il commence à désirer non seulement des biens matériels (la motivation initiale des sujets), mais aussi de l’argent, qui ne peut pas être considéré comme un bien matériel, ne serait-ce que parce qu’il est immatériel (comme cela a été souligné précédemment, il peut être transféré par Internet). Mais la nature informationnelle de l’argent nous échappe, à nous, participants aux relations de marché. En recevant un billet de cent dollars, nous croyons sincèrement avoir acquis de la valeur, alors que, si l’on y réfléchit, il devient évident que la valeur d’usage de cet artefact est à peu près nulle. Le billet de cent dollars est un support matériel d’un signal, dont le sens est que le détenteur de cet objet éprouve le désir de s’en débarrasser de manière raisonnable, et qu’il existe d’autres sujets qui souhaitent acquérir cet objet pour ensuite, à leur tour, s’en débarrasser de manière raisonnable. Cela crée un réseau de transmission de données que nous connaissons depuis notre enfance, dans lequel nous, sujets économiques, jouons le rôle de milieu de transport. Mais si des signaux sont transmis, il est évident qu’il doit y avoir des expéditeurs (quelqu’un doit bien coder l’information dans le signal) et des récepteurs. On peut supposer que, dans ce cas, l’échange monétaire est un processus d’information interne de cette mystérieuse entité suprapersonnelle que l’on peut désigner comme « système de communication de l’économie de marché ». Et pour nous, sujets économiques, il est tout à fait suffisant d’avoir une finalité externe, exprimée par le désir d’obtenir l’argent qui nous manque et de dépenser l’argent que nous avons.
Malgré toutes les critiques, un système économique de marché purement symbiotique s’avère systématiquement plus avantageux et plus humain que tout autre système basé soit sur l’esclavage, soit sur un scénario « si tout le monde ». Comme une cuillère de goudron dans ce grand pot de miel, il y a bien sûr toujours des phénomènes de parasitisme et même de prédation qui apparaissent là où, pour une raison quelconque, l’équilibre de l’intérêt mutuel des symbiotes est perturbé.
En ce qui concerne les systèmes symbiotiques sociaux, ce qui est le plus problématique n’est pas l’apparition de la prédation et du parasitisme, mais le fait que, dans de tels systèmes, l’élément qui détermine l’essence et l’orientation des processus en cours n’est pas quelque chose de concret, de visible et de tangible, mais une sorte d’entité virtuelle incompréhensible et suprapersonnelle. Dans cette situation, nous nous sentons mal à l’aise, et il naît un désir naturel de matérialiser le lien structurant du système. Par exemple, il est naturel de désigner une personne concrète comme responsable de ce qui se passe. Mieux encore, soi-même. Ou, si cette idée n’est pas bien accueillie par tous, un Dieu anthropomorphe mythique, et se désigner comme son principal prophète. Si cela réussit, le scénario de « symbiose » se transforme en scénario de « servitude ». Si nous ne voulons pas réaliser le scénario de « servitude », nous devons apprendre à renoncer à l’idée d’usurpation ainsi qu’à celle de l’incarnation des systèmes de communication.
Prévenir et détruire
Il est parfois utile non seulement de créer des systèmes, mais aussi de les détruire. Même un système apparemment idyllique, comme le symbiose harmonieuse, peut devenir indésirable. Nous pouvons vouloir le briser, ne serait-ce que pour créer à sa place un autre système symbiotique plus adapté aux circonstances changeantes.
En parlant de la rupture des systèmes, il est souvent utile de souligner si nous agissons de l’intérieur ou de l’extérieur du système. La motivation à rompre de l’intérieur peut évidemment résider dans le fait que le sujet n’est plus satisfait de son implication dans le processus. La motivation à rompre de l’extérieur est plus variée, mais elle est également évidente.
Le moyen le plus radical de briser des systèmes est, bien sûr, l’élimination des sujets qui y participent, mais nous ne considérerons pas cette option, non seulement par souci d’humanisme, mais surtout parce que notre objectif est différent : nous ne parlons pas de l’élimination des éléments des systèmes, mais de la destruction même des systèmes.
Déconstruction du scénario « utilisation de l’outil »
Je rappelle le schéma :

Le motif de la déconstruction d’un tel système peut être que l’utilisation d’un outil spécifique, en plus d’apporter des résultats positifs pour le sujet, entraîne également des effets secondaires indésirables. Par exemple, si le résultat souhaité est d’atteindre un confort mental, et que l’outil utilisé est une seringue avec de l’héroïne.
Dans une telle situation, simplement retirer l’outil à l’individu n’est pas une déconstruction efficace. Privé de cet outil, l’individu subit une privation du résultat souhaité et, avec un objectif qui ne disparaît pas, il trouve un moyen de retrouver un outil similaire. La solution efficace consiste à remplacer le scénario « utilisation de l’outil » par tout autre scénario qui permet à l’individu d’obtenir efficacement le résultat désiré.
Déconstruction de l’esclavage
Schéma :
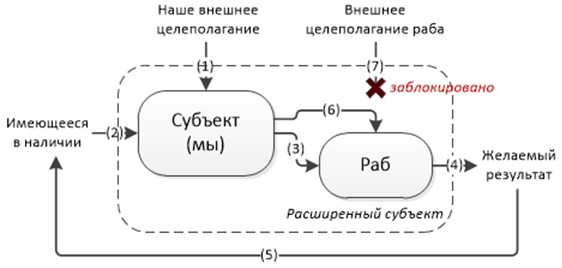
Le système esclavagiste fonctionne grâce aux esclaves, et c’est pourquoi les premiers ennemis lors des affrontements avec de tels systèmes sont les esclaves eux-mêmes. Cependant, il est important de comprendre que les esclaves dans ces systèmes sont une ressource renouvelable, et bien que la perte d’esclaves soit désagréable pour le système esclavagiste, elle n’est pas mortelle pour lui. Après avoir subi des pertes et s’être replié sur des positions préalablement fortifiées, le système retrouvera ses forces et tentera de prendre sa revanche. C’est pourquoi les grandes batailles épiques, bien qu’elles fournissent un matériau incomparable pour la mythologie, la littérature et le cinéma, ne peuvent pas être considérées comme un moyen efficace de déconstruction des systèmes esclavagistes. Une approche plus appropriée serait la neutralisation du sujet-esclavagiste, mais la difficulté réside dans le fait que, d’une part, le sujet est généralement bien protégé et, d’autre part, il n’est pas toujours facile de l’identifier correctement. Ayant l’habitude de personnifier le sujet, nous désignons traditionnellement comme sujet-esclavagiste celui que nous pouvons voir de nos propres yeux : le roi, l’empereur, le dictateur, le président ou, en option, un cercle restreint de personnes. Mais même après avoir définitivement triomphé dans la guerre et éliminé le maître personnifié, nous pouvons, après un certain temps, découvrir avec étonnement que cela n’a pas non plus constitué une blessure mortelle pour le système. Le système, non complètement éradiqué, parvient à se doter d’une nouvelle élite, à compenser la perte d’esclaves, et se présente à nouveau devant nous sous une forme renouvelée et rajeunie.
Le point le plus faible de l’esclavage n’est pas les esclaves ni les maîtres, qui sont des sujets évidents, mais la nécessité de bloquer la propre visée externe de l’esclave. Par conséquent, la base de la méthode pour se libérer de l’esclavage peut être le déblocage du canal obstrué. Dès que l’esclave commence à comprendre que le sens de son existence n’est pas seulement de servir son maître, il cesse d’être un esclave efficace, et le système commence à se fissurer. Lorsque la visée externe des esclaves est complètement débloquée, le système esclavagiste cesse d’exister simplement parce que les anciens esclaves ne réagissent plus aux influences de contrôle (signal 3 dans le contexte 6) et s’en vont chacun de leur côté.
Ce qui est intéressant, c’est que la situation de déblocage de la détermination des objectifs des esclaves est appelée chez nous « corruption ». Actuellement, la corruption est considérée comme un phénomène strictement négatif, contre lequel il faut absolument lutter de toutes ses forces. Tactiquement, on peut probablement considérer la corruption comme quelque chose de non souhaitable, mais sur le plan stratégique, la corruption des esclaves est précisément l’outil qui détruit le plus efficacement les systèmes esclavagistes. À propos, dans les systèmes où le scénario « esclavage » n’est pas utilisé, le concept de « corruption » s’avère tout simplement inapplicable. La corruption n’est rien d’autre que le comportement naturel des sujets dans une situation où il est jugé inacceptable au nom de « l’intérêt général », des « traditions séculaires » ou de toute autre grande tromperie.
La clé pour comprendre comment un système esclavagiste spécifique peut être déconstruit et transformé en quelque chose de plus approprié réside dans la recherche de la réponse à la question : « Que peut-on changer dans ce qui se passe pour que le concept de « corruption » devienne tout simplement inapplicable ? »
Déconstruction de la délégation
Schéma :
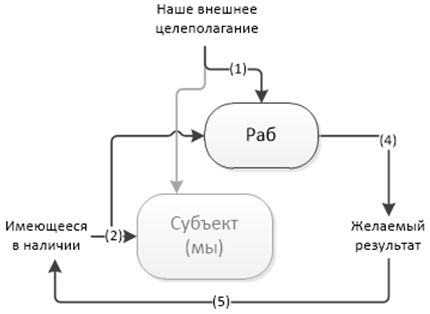
Une situation très triste, surtout pour le sujet lui-même, qui est passé d’un sujet actif à un non-sujet inactif. La seule chose que l’on puisse proposer ici est de serrer les dents et de s’engager dans le processus, malgré tous les coûts et toute l’apparente absurdité de sa propre participation à l’obtention du résultat souhaité. Si le serviteur créé a une protection efficace contre la capture de son champ d’activité, on peut essayer d’entrer en symbiose avec lui, mais pas par le biais du scénario apparemment logique de « l’esclave de l’esclave », mais par un chemin naturel et correct. Par exemple, d’abord à travers le parasitisme et la prédation.
Déconstruction du scénario « Si tout »
Ce scénario n’a pas besoin de déconstruction, car il n’existe nulle part dans le monde réel sous une forme fonctionnelle.
Déconstruction du symbiose
Le symbiose est une chose bonne et positive. C’est même dommage de briser cette idylle. Mais si cela doit être fait, il nous faudra savoir comment le faire correctement. Je rappelle le schéma :
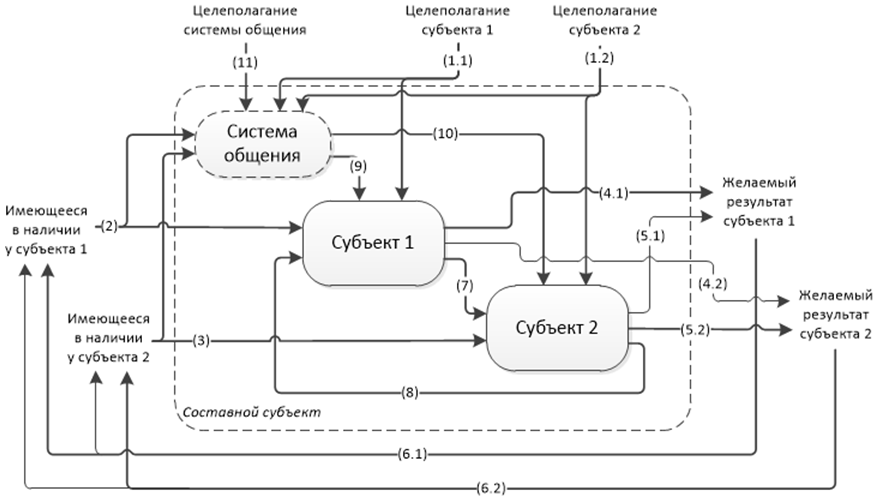
L’élément clé du système symbiotique est le système de communication qui établit les contextes (9 et 10) pour les liens d’information horizontaux (7 et 8). Par conséquent, pour détruire le symbiose, il faut faire en sorte que les signaux circulant dans le système cessent d’être interprétés de manière adéquate. Dès que les symbiontes ne parviennent plus à se comprendre, le système se dégrade rapidement en un mode de prédation ou d’esclavage beaucoup moins viable.
Les scénarios de « travail collaboratif pour un résultat commun », de « communication auto-évaluative » et de « parasitisme éclairé », qui sont des cas particuliers de symbiose, sont déconstruits de manière similaire, c’est-à-dire à travers la neutralisation du système de communication.
Remarque générale sur la déconstruction des systèmes
Tout système en fonctionnement est un moyen de résoudre un problème. Si, avant de commencer la déconstruction, nous n’avons pas créé au moins un moyen alternatif tout aussi efficace de résoudre ce même problème, notre déconstruction ne sera pas réussie. Ainsi, un élément nécessaire à la résolution du problème « prévenir et détruire » devient la réussite de la tâche « créer et maintenir ».
Conclusion
La pensée centrale de toute philosophie de l’information, pas seulement celle exposée ici, peut être exprimée en trois mots :cesser la réification de l’informationTant que nous essayons de parler de l’information comme de quelque chose d’objectivement existant indépendamment de la conscience, nous ne parlons pas d’information.
En nous interdisant la réification, nous nous retrouvons immédiatement dans une situation assez délicate, car, d’une part, nous ne pouvons plus ignorer la nécessité d’apprendre à parler des choses immatérielles, et d’autre part, nous devons d’une manière ou d’une autre rétablir l’intégrité du monde.
La solution à ces problèmes a été grandement facilitée par l’approche instrumentale à la philosophie mentionnée dès l’« Introduction ». Sans son application, nous n’aurions pas pu progresser au-delà des discussions du type « l’information (ainsi que les systèmes, les sujets, la causalité, le temps, etc.) existe-t-elle réellement, ou n’est-ce qu’une illusion ? ».
Dans le cadre de la résolution du problème de renonciation à la réification de l’information, il a été possible de :
- Construire une méthodologie justification dépendante de la situation , permettant d’établir une connaissance fiable là où cela n’avait pas été pratiqué jusqu’à présent.
- À l’aide de la construction «signal-contexte» établir un pont entre les mondes matériel et immatériel, les reliant ainsi en un tout unifié.
- Préciser le concept de « matière » и. expulser «l’information» de la physique Il y a de l’espoir que cela ait une influence bénéfique non seulement sur l’informatique, mais aussi, à terme, sur la physique.
- Clarifier le concept «système» des exigences superflues, cristallisant ainsi l’essence.
- Apprendre à manipuler le concept. «identité» et appliquer cette compétence à la résolution de l’énigme jusqu’alors inaccessible de la conscience de soi.
- Profiter de la beauté de l’idée de l’essentiel. unité du sujet et du monde , dans lequel il vit.
- Avec étonnement, découvrir que dans notre monde fonctionnent deux causes complètement différentes par leur nature ..
- Apprendre à parler non seulement des connaissants, mais aussi de en vigueur sujets.
- Regarder l’énigme sous un angle intéressant. temps ..
- Formuler et prouver théorème de la détermination externe des objectifs ..
- Apprendre à raisonner sur liberté de choix et comprendre dans quels cas et comment elle se manifeste.
- Enfin, il est temps de clore cette question qui a assez agacé. reproductibilité de la pensée calculateur déterministe.
- Apprendre à raisonner sur sujets composés ..
- Découvrir que l’humain raison. n’est pas le seul esprit dans l’univers. Obtenir une justification claire que toute théorie de supériorité, sans exception, ne peut avoir aucun fondement.
- Réconcilier l’idée liberté individuelle avec l’idée de bien public.
- En tant que bonus supplémentaire, apprendre à réfléchir sur les voies et les moyens de la systématisation des entités transpersonnelles.
Il est possible que certains attendaient de la philosophie de l’information une recette pour établir un contrôle total sur tout ce qui se passe. En fin de compte, il s’est avéré que c’était tout le contraire. Il s’est révélé que l’établissement d’un contrôle total n’est possible qu’à travers la destruction complète de sa propre subjectivité. Comprendre cette réalité pourrait, à terme, influencer un changement de direction dans le développement social, passant d’une quête de centralisation maximale à une aspiration à une liberté bien et harmonieusement organisée.
Ce qui est particulièrement précieux et ne peut que réjouir, c’est que dans le système métaphysique ainsi créé, tout ce qui peut être rattaché d’une manière ou d’une autre à la mystique — dieux, démons, matières subtiles, mondes d’outre-tombe et autres choses similaires — a été relégué au rang de «entités superflues dont on peut et doit apprendre à se passer». Dans les idées proposées en remplacement — que ce soit dans la construction «signal-contexte», dans les systèmes, dans les identités, et même dans les sources interpersonnelles terriblement variées de la détermination externe des objectifs — il n’y a pas une once de surnaturel. Tout ce qui est évoqué est accessible à l’observation, à la compréhension et à une utilisation productive.
Dans mon récit, je me suis soigneusement abstenu d’aborder l’aspect moral et éthique de toutes les questions examinées. Ce n’est pas que le sujet ne m’intéresse pas, mais parce que mélanger la métaphysique avec l’axiologie est le meilleur moyen d’obtenir un produit inacceptable de part et d’autre. Sans aucun doute, du point de vue axiologique, le sujet traité ici doit également être soigneusement étudié, mais je préférerais que cela soit fait par ceux qui s’y connaissent mieux que moi.